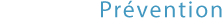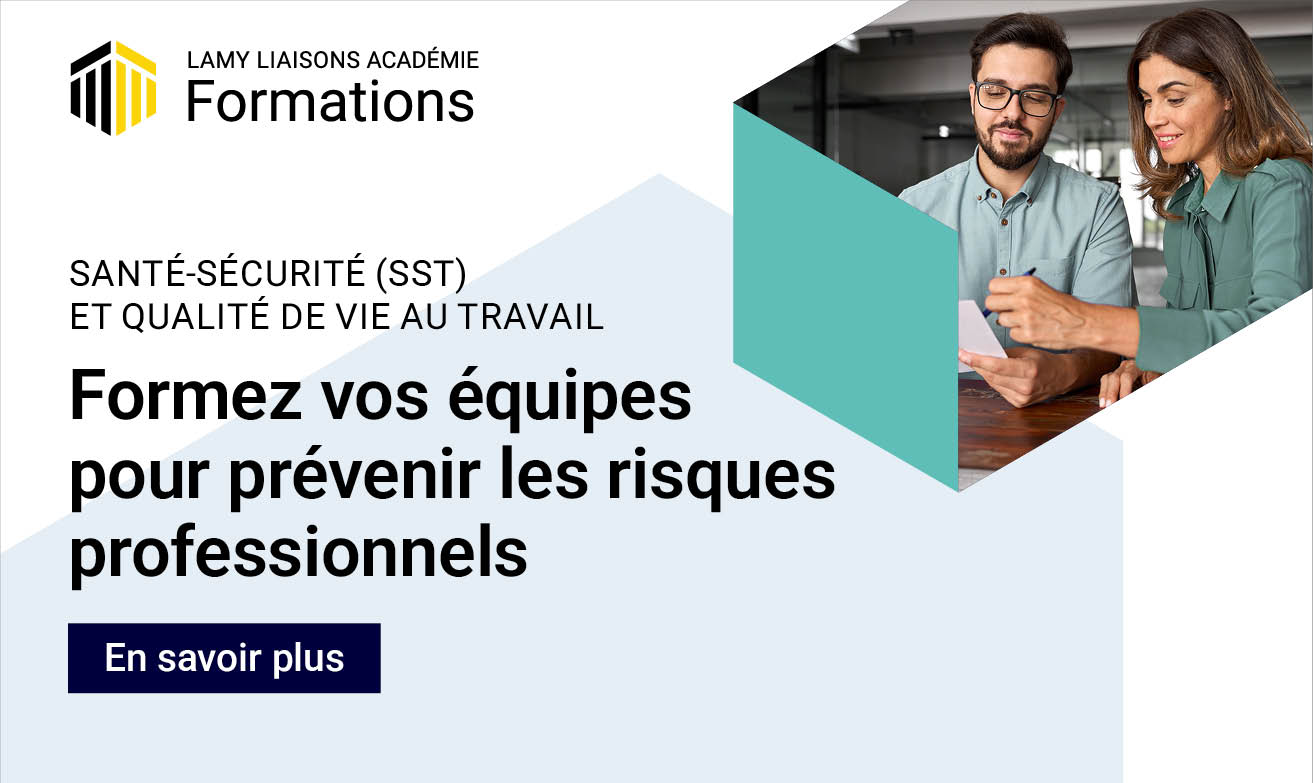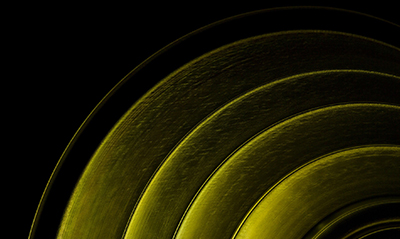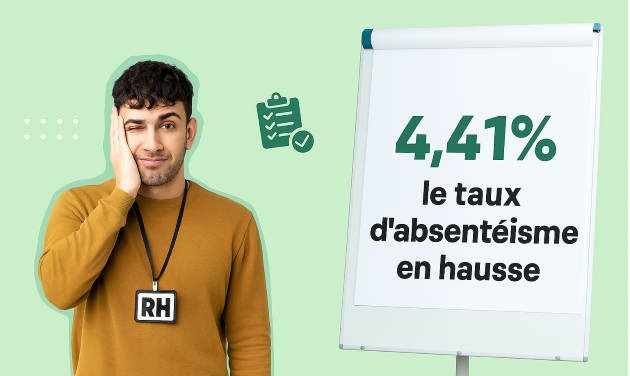De la responsabilité environnementale à la responsabilité sociétale
Sous la pression des associations et des pouvoirs publics, les entreprises cherchent à créer un cercle économique vertueux par de meilleurs rapports avec la société dans toutes ses composantes.
La question de la responsabilité environnementale des entreprises s’inscrit dans la problématique plus vaste de leur responsabilité sociale ou sociétale. La prise de conscience de la fragilité de l’environnement et des dommages engendrés par nos modes de vie ont conduit à donner naissance au principe de développement durable, formulé la première fois dans le rapport Brundtland, soumis à l’assemblée générale des Nations Unies en 1987. Le principe est ensuite consacré lors du deuxième sommet de la Terre de juin 1992 à Rio de Janeiro. Sous l’impulsion de la communauté internationale, les questionnements éthiques vont ainsi faire leur apparition dans les préoccupations économiques. La responsabilité sociétale des entreprises (RSE) constitue une synthèse de ces questionnements sur des sujets qui sont l’essence même de la vie sociale : protection environnementale, gouvernance, participation des salariés, choix économiques... Dans un article du Figaro du 27 octobre 2003, Bertrand Collomb, président de Lafarge, remarque que les entreprises, souvent sous la pression des associations, cherchent à créer un cercle économique vertueux dû à un meilleur rapport avec la société, dans toutes ses composantes. La responsabilité sociétale sous-tend un fonctionnement des marchés plus respectueux des exigences du développement durable et une responsabilité globale de l’entreprise dans un contexte d’économie responsable, reposant sur de bonnes pratiques : droits de l’Homme, préservation de l’environnement, droits sociaux, hygiène et sécurité, lutte contre la corruption... Elle implique pour les entreprises d’intégrer cette problématique à sa stratégie, ses modes de fonctionnement, la conception de ses produits et de ses services.
La responsabilité sociale apparaît ainsi comme une préoccupation des entreprises, au regard de la pression sociale également impulsée par les pouvoirs publics, à de nombreux échelons. À l’échelle internationale, le plan d’action adopté au sommet de la Terre à Johannesburg en 2002 promeut la responsabilité sociale des entreprises, en vue d’une mondialisation plus équitable. Le Livre vert « Promouvoir un cadre européen pour la responsabilité sociétale des entreprises » rendu public par l’Union européenne en juillet 2001 et la communication de la Commission sur le même sujet en juillet 2002 ont jeté les bases d’une réfl exion à l’échelon communautaire. Le Parlement européen a ensuite adopté en mars 2003 une résolution, en faveur de la promulgation d’une cadre de la RSE et d’une obligation de « reporting ». Au regard de cette impulsion internationale, une évolution juridique se dessine à travers la législation des différents pays. En France, plusieurs lois introduisent la responsabilité sociétale parmi les préoccupations fi nancières notamment la loi du 19 février 2001 relative à l’épargne salariale, la loi du 15 mai 2001 concernant les nouvelles régulations économiques et les investissements socialement responsables, la loi du 17 juillet 2001 instituant un fonds de réserve pour les retraites, la loi de sécurité financière du 1er août 2003...
Cela dit, le concept de responsabilité sociétale est-il réellement efficient ? Même si une panoplie d’orientations et d’instruments a été défi nie, il est encore diffi cile d’apprécier leur application et leur effi cacité. Avant tout principe politique, il est mis en oeuvre de manière très différente selon les entreprises et les pays. La loi française du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques, dite loi NRE, a conduit à souligner le débat sur le besoin de validation ou de certification des données RSE, contenues dans les rapports de développement durable. Il faut savoir que Nike a fait l’objet de poursuites sur la base de la loi californienne relative à la compétition déloyale et de la loi sur la publicité mensongère, pour avoir publié des informations erronées sur les conditions de travail auprès de ses sous-traitants (Kasky v. Nike, Cour suprême de Californie, 27 CAL 4th 939, SO87859, 2 mai 2002). La pression sociale constitue donc un facteur non négligeable d’une part de mise en application de la responsabilité sociétale des entreprises et d’autre part de contrôle de celle-ci.
La responsabilité sociétale incluant la question de leur responsabilité environnementale constitue à l’heure actuelle un sujet incontournable pour les entreprises, dans un marché concurrentiel mondialisé, de plus en plus sensible aux questions éthiques.
Valérie Godfrin
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.