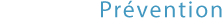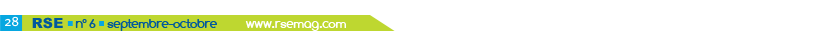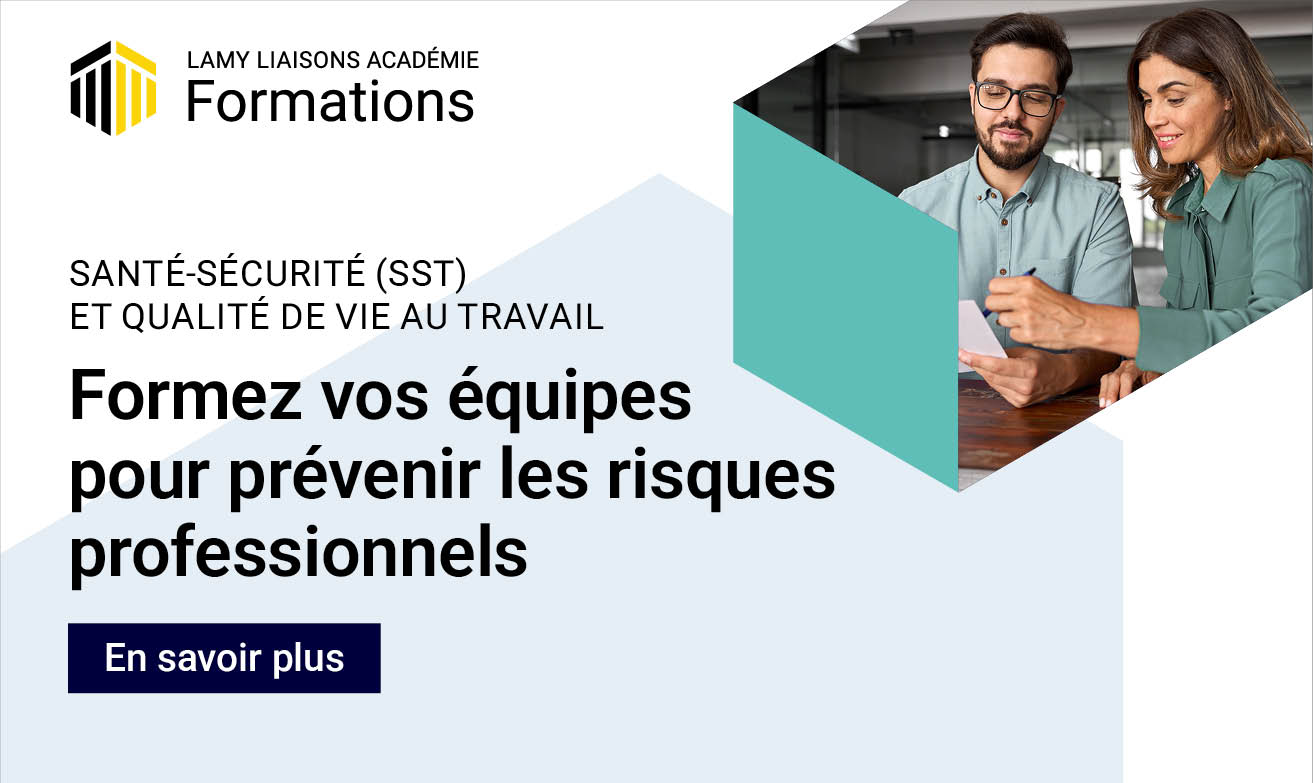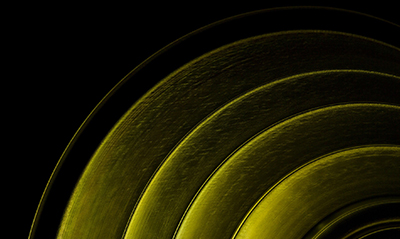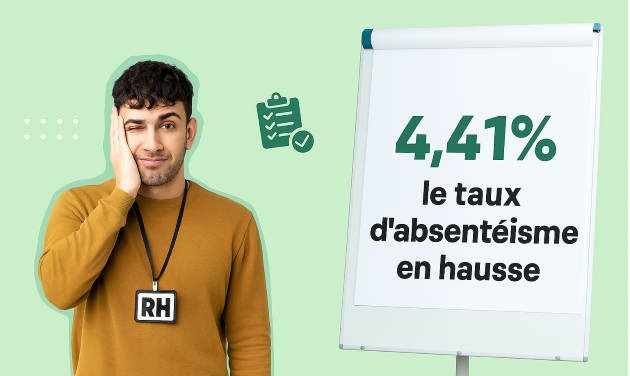Le droit de l'environnement peut-il se désintéresser du droit à l'indemnisation des victimes personnes physiques d'un accident industriel ?
On ne le présente plus... Le célèbre avocat répond pour nous à une triple interrogation : pourquoi le droit de l'environnement semble-t-il se désintéresser de l'indemnisation des dommages causés aux personnes physiques à la suite d'un accident industriel ? Cette affirmation correspond-elle réellement à l'évolution du droit positif, ou doit-elle être nuancée ? Dans quelle mesure cette situation est-elle susceptible d'évoluer, sur la base de quels facteurs et dans quelle perspective ?
Valére Godfrin vient de relever le paradoxe selon lequel d'un côté les victimes directes (les employés) d'un accident industriel bénéficient d'un engagement assez favorable de la responsabilité de l'auteur du dommage (c'est le régime des accidents du travail et des maladies professionnelles) mais d'un autre, n'obtiennent qu'une réparation assez faible, alors que les victimes extérieures à l'établissement obtiennent plus difficilement l'engagement de la responsabilité, mais une meilleure indemnisation.
Il ne s'agit pas de contester ici le bien fondé de cette analyse qui, en l'état du droit positif, paraît reposer sur des bases sérieuses, mais d'apporter des éléments à la réflexion sur la raison d'être de cette situation et les perspectives d'évolution.
Nous serons donc dans un premier temps conduits à rechercher les raisons pour lesquelles le droit de l'environnement semble se désintéresser de l'indemnisation des dommages causés aux personnes physiques à la suite d'un accident industriel. Puis, dans un deuxième temps, nous vérifierons si cette situation correspond bien à l'évolution du droit positif et si la proposition ne doit pas être quelque peu nuancée. On recherchera enfin en troisième lieu dans quelle mesure cette situation pourrait être susceptible d'évoluer, sur la base de quels facteurs et dans quelle perspective.
La logique juridique induite par le droit de l'environnement
Il est tout à fait logique que le droit de l'environnement ne s'intéresse pas, a priori, aux personnes ; telle était, du moins, sa perspective première lorsqu'il est apparu dans les années 1970. Son objet premier était de s'occuper de la protection de la nature et des biens (et non des personnes), que ceux-ci soient appropriés ou non, qu'ils soient propriété privée ou propriété publique. Il aura fallu environ vingt ans après l'apparition des grandes lois sur l'environnement datant des années 1975/19761 pour que la protection de l'environnement inclue une perspective humaine. Mais comme on l'a dit au début de cette période, il était bien singulier que la nature « soit présente partout sauf en l'Homme ». Réciproquement, il eût été anormal que la protection de la nature exclue la protection de l'homme.
C'est sous la double impulsion de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et de la loi sur l'air du 30 décembre 1996 modifiant le droit des études d'impact, dont l'objet fut de rendre obligatoire la prise en considération des effets sur la santé d'un projet déterminé d'installation classée, industrielle ou minière, qu'a été adoptée la perspective de la protection individuelle par le biais précisément de la prise en considération du facteur santé humaine.
La jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, qui s'est développée dans les années 1990, a fait du droit de l'environnement un droit de l'homme, c'est-à-dire non plus un droit objectif à l'environnement mais ce qu'on pourrait appeler un embryon de droit subjectif2.
Le second facteur d'explication de la relative indifférence du droit de l'environnement à l'égard de la protection des personnes réside dans les perspectives dans lesquelles ont été d'abord combattues les règles de la responsabilité civile aux fins d'adaptation à une véritable prise en compte de la responsabilité environnementale.
La jurisprudence des tribunaux s'est d'abord préoccupée uniquement des questions relatives au lien de causalité à la responsabilité objective, ou à la responsabilité sans faute, et puis rapidement à celle de l'indemnisation des dommages écologiques.
Commencée avec l'affaire dite de la pollution des Boues Rouges de la Montedison dans les années 1970/1980, la reconnaissance du dommage écologique s'est vu consacré par l'arrêt de la cour d'appel de Paris3 rendu dans l'affaire de l'Erika. Dans cette affaire qui a suffisamment défrayé la chronique, les collectivités publiques, comme les associations de droit privé, se sont vues octroyer des dommages et intérêts pour des atteintes directes et indirectes à l'environnement.
Enfin, la troisième et dernière raison tient, pour nous surtout, au fait que la perspective même du droit de l'environnement n'est pas une perspective nécessairement liée à la réparation des dommages. La perspective adoptée par le droit de l'environnement, aussi bien dans l'Union européenne que dans la Charte de l'environnement de 2005, qui contient l'obligation à réparation (ou ce qu'il est convenu d'appeler à tort le principe pollueur/payeur), n'est qu'une partie du sujet. Viennent à côté, et surtout en priorité, le principe de prévention, le principe de précaution et le principe de la transparence et de l'information du public4.
Le droit de la réparation n'est que l'un des quatre piliers du droit de l'environnement, et non son pilier fondamental
Réparer un dommage à l'environnement, c'est en définitive constater un certain échec du droit et admettre que le dommage est inéluctable alors que la fonction première du droit de l'environnement doit être préventive et anticipatrice ; ceci explique par ailleurs le développement des procédures ISO, en particulier les procédures ISO 14000 comme les procédures dites de gouvernance écologique que l'on retrouve dans la dernière loi Grenelle en cours d'adoption par le Parlement.
On peut donc dire à ce stade de l'analyse que le droit de la réparation n'est que l'un des quatre piliers du droit de l'environnement et non le pilier fondamental de celui-ci, même s'il a pu s'affirmer et progresser grâce au droit de la responsabilité civile ou pénale. En d'autres termes, il doit être bien clair que le droit de la responsabilité, qui était indispensable pour sa naissance et son éclosion, n'est plus pour le droit de l'environnement aujourd'hui sa perspective finale.
Il n'en reste pas moins qu'au travers de l'évolution la plus récente du droit s'amorcent des évolutions jurisprudentielles importantes qui ont montré un certain changement de perspective.
L'inflexion du droit positif par la jurisprudence, ou la lente prise en considération de la personne comme sujet du droit de l'environnement
Le progrès est venu à la fois de l'évolution de la jurisprudence de la chambre criminelle de la Cour de cassation et des juridictions judiciaires à propos de laquelle on peut relever trois éléments utiles à notre réflexion.
Tout d'abord, de façon prétorienne, la Cour de cassation a considéré que constituait un élément constitutif du délit d'homicide ou de blessure involontaire le fait qu'une installation classée ne soit pas régulièrement autorisée. Nous faisons ici référence à un arrêt de la chambre criminelle sur lequel un accident était survenu dans une installation qui n'avait pas fait l'objet d'une extension régulière au titre de la législation des installations classées, comme l'a montré le professeur Robert dans le commentaire sous cet arrêt5.
Le deuxième effort de la chambre criminelle réside dans une jurisprudence rendue dans une affaire Société Metalblanc6. Il s'agissait en l'espèce d'un contentieux lancé pour méconnaissance d'un certain nombre de prescriptions environnementales issues de la législation installations classées dans lesquelles il était démontré que l'absence de précaution prise par l'entreprise avait mis en péril la santé des habitants au voisinage de l'entreprise défaillante.
Le troisième effort vient des décisions de tribunaux du 1er et 2e degrés qui admettent
aujourd'hui la réparation du préjudice aux troubles causés au voisinage des entreprises et naturellement aux salariés, victimes potentielles de l'amiante. Est ainsi indemnisé le préjudice lié à la crainte légitime du fait de l'exposition aux dangers et aux dommages des fibres d'amiante, même si les dommages corporels ne se sont pas manifestés.7
C'est ainsi qu'il faut comprendre certaines décisions assez isolées au demeurant, comme la décision rendue par la cour d'appel de Versailles8 dans une instance civile liée à la crainte des troubles engendrés par l'émission de signaux radioélectriques provenant des installations dites antennes relais ; c'est moins le principe de précaution qui a été appliqué, ou une conception assez élargie du risque engendré et surtout la crainte de ce risque, les conséquences de ce risque sur les personnes qui fondent le nouvel horizon du droit de la réparation environnementale, celle-ci étant alors assise sur la théorie des troubles de voisinage. Mais on n'est plus là dans la perspective de l'accident mais celle du risque.
On peut donc constater une certaine évolution des perspectives sur le plan de la responsabilité civile directe liée à l'application de la théorie des troubles de voisinage ou à la prise en considération de la protection des personnes pour des dommages liés à des infractions commises au titre de la législation environnementale.
Il n'en demeure pas moins que si le concept de responsabilité a été élargi, l'indemnisation des personnes dans ce type d'affaires reste toujours très faible et peu étendue même si elle est affirmée dans son principe.
Comment envisager, dans ces conditions, une réforme des perspectives de la réparation intégrale à appliquer dans le cadre d'accidents industriels ?
On peut citer, parmi les projets de réforme, le rapport présenté par Corinne Lepage à Jean-Louis Borloo9 dans le cadre du Grenelle de l'environnement qui vise une relecture de l'article 1382 du Code civil mais l'on se trouve encore ici dans le cadre d'une réparation des dommages aux biens environnementaux au sens large du terme. De même, les projets de rapports concernant la modification du Code civil repris par le Sénat ne paraissent pas aller beaucoup plus loin dans la perspective recherchée10. Mais deux éléments, à notre sens, devraient être pris en considération.
Le premier facteur est celui de l'évolution générale de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui, précisément, a pour but de stigmatiser les insuffisances de la législation relative à la protection de l'environnement dans le cadre d'accidents industriels ; à cet égard, l'arrêt Tatar / Roumanie rendu le 21 janvier 200911 est tout à fait symptomatique de la volonté de la Cour d'avancer sur la liaison santé-environnement et législation adéquate12. La Cour a reproché en effet à la Roumanie de ne pas avoir suffisamment fait avancer ses lois dans le cadre de la prévention et de la précaution. Mais là encore, l'indemnisation reste insuffisante.
De son côté, le Conseil d'État en France semble montrer la voie lorsqu'il dénonce par une décision importante rendue dans le domaine du sang contaminé, certes adjacent du droit de l'environnement, ou celui, plus proche de nos matières, de l'amiante, l'insuffisance des législations et des réglementations pour protéger la personne.
La théorie de la faute ou la théorie de la rupture d'égalité de tous devant les charges résultant du service ou de l'insuffisance du service public sont des théories qui se sont développées devant les tribunaux administratifs.
L'État a été condamné, par exemple par le tribunal administratif de Rennes13, pour insuffisance de vigilance en ce qui concerne la défaillance de la puissance publique et l'application de la réglementation dans le domaine des porcheries et les risques d'atteinte à la santé humaine liés aux mesures exigées par les juridictions qui ont imposé dans certains cas aux sociétés de distribution d'eau potable de compenser le dommage subi aux habitants du fait de la privation temporaire ou non d'accès à l'eau potable et des risques pour leur santé par l'achat de bouteilles d'eau minérale.
Mais la relation reste encore assez indirecte avec notre objectif, même si ces décisions permettent de mieux comprendre les conditions dans lesquelles la responsabilité peut être envisagée, ainsi que la légitime demande de réparation de l'intégralité du dommage au profit des victimes.
L'extension de la prise en considération des dommages causés aux personnes peut venir de directions qui n'ont pas encore été clairement envisagées jusqu'alors.
La jurisprudence aux États-Unis est par exemple très différente de la jurisprudence française. Elle a créé des difficultés qui ont été heureusement surmontées dans l'affaire de l'Amoco Cadiz14, au sujet de la réparation des dommages causés aux services publics lors d'un accident dès lors que ceux-ci interviennent ou même lorsqu'ils cherchent simplement à recouvrer les coûts des dépenses qu'ils ont effectuées pour limiter le dommage et assurer la réparation ou éviter des dommages plus grands aux personnes.
La théorie de la gratuité des services publics est actuellement battue en brèche ; plusieurs arrêts de la Cour de cassation ont eu l'occasion d'affirmer le droit à réparation, notamment en cas d'accident des services départementaux d'incendie et de secours15.
Une autre question a été discutée mais reste parfaitement envisageable : c'est l'indemnisation des bénévoles en cas d'accident maritime ou d'accident causé par les hydrocarbures qui sont les exemples les plus fréquents de pollution des plages, que celui-ci soit lié à une fausse manoeuvre (affaire de Donges) ou à un accident maritime (affaire de l'Erika par exemple).
La théorie juridique fait que la réparation apportée par le bénévole et les dommages qu'il risque de subir devraient être réparés par le pollueur ou par l'auteur de l'accident s'il y a exposition par exemple au titre de l'atteinte à l'intégrité corporelle des bénévoles.
Tel était le cas soulevé dans l'affaire de l'Erika puisque le pétrole ramassé sur les plages n'était pas du pétrole brut mais bien du fuel lourd n° 2 chargé de produits chimiques et de substances particulièrement dangereuses, véritables résidus de fonds de cuves de distillation du pétrole brut.
La cour d'appel de Paris ne s'est pas prononcée directement sur ce sujet mais le problème aurait pu se poser dès lors qu'un certain nombre de parties civiles auraient pu se manifester en ce sens.
En principe, il ne devrait y avoir aucune difficulté à ce que les bénévoles obtiennent réparation dans des hypothèses de ce genre, que ce soit à la suite de l'accident de marée noire ou même à la suite de l'accident industriel, dès lors que limitant l'obligation de réparation de l'auteur du dommage, ils accomplissent effectivement ce que celui-ci aurait dû être condamné à réparer. Mais encore faut-il qu'ils se présentent en justice...
Il s'agit d'une question en définitive assez classique qui a été tranchée depuis un certain temps par la Cour de cassation sous d'autres aspects, dès lors que celle-ci a accepté de réparer par exemple les coûts exposés par la victime pour réparer le dommage causé.
Il résulte donc des considérations qui précèdent que si le droit de l'environnement n'a pas vocation lui-même à assurer l'indemnisation intégrale de tous les dommages corporels parce que ce n'est pas son optique première, la situation devrait pouvoir évoluer par référence à son rattachement à un véritable droit de l'homme perspective adoptée par la Charte de l'environnement.
Néanmoins, le droit de l'environnement s'est tourné vers une autre perspective qui est d'abord celle de la seule réparation des dommages causés aux biens (qu'ils soient appropriés ou qu'ils soient des dommages des biens collectifs ou non parce que sa relation a été établie avec le droit de la protection de la santé), et surtout est ensuite celle de la prévention et de la précaution.
Le problème est qu'en France, sauf la récente évolution de l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 30 mars dernier dans l'affaire de l'Erika, les indemnisations sont généralement très basses par rapport à ce qui est convenu de pratiquer dans les pays de droit anglo-saxons16.
Dans tous les cas de figure, « précaution » « prévention » « réparation intégrale » sont trois termes indissociables et il n'y a aucune raison d'affaiblir l'un pour renforcer les autres.
1. On citera la loi sur la protection de la nature du 10 juillet 1976 ; la loi sur les installations classées du 19 juillet 1976 et la loi sur les déchets du 15 juillet 1975.
2. Sur cette évolution, voir la jurisprudence et la doctrine citées sous l'article L. 110-1 du Code de l'environnement, Code Litec, Ed. 2010, p. 63 et suiv.
3. Sur l'affaire de l'Erika, voir Mathilde Boutonnet, Environnement et développement durable, n° 7 (juillet 2010), éditions Lexis Nexis.
4. Sur la Charte, voir code Litec 2010 précité, p. 3 et suiv.
5. Note Jacques-Henri Robert, Sciences criminelles octobre/décembre
6. Droit pénal, n° 5 (mai 2008) - Commentaire J.-H. Robert sous Cass. 30 octobre 2007.
7. M.-P. Maître, C. Huglo, C. Lepage, L'amiante au banc des accusés. Environnement et technique (décembre 2006), n° 262.
8. CA Versailles - 14e Chambre - 4 février 2009 RG 08/08775
9. Rapport à Jean-Louis Borloo - document accessible sur Internet.
10. Rapport d'information - Sénat 8 juillet 2009. 1998.
11. CEDH - 27 janvier 2009 Tatar c/ Roumanie n° 67021/01.
12. CE 3 mars 2004, n° 241.151, Ministre de l'Emploi et de la Solidarité c/ Consorts Botella.
13. TA Rennes, 2 mai 2001, n° 97182, Société Suez Lyonnaise des Eaux.
14. Affaire Amoco Cadiz - article C. Huglo - 20 ans après l'échouement de l'Amoco Cadiz ou les trésors juridiques de l'épave, Gaz Pal (24-25 juin 1998).
15. Cour de cassation, 3e chambre civile, 23 mai 2007, n° 06 - 11.647 Environnement n° 7 (juillet 2007), p. 26.
16. Sur l'affaire de l'Exxon Valdez, voir Wanda Mastor, Responsabilité environnementale et dommages punitifs, Revue constitutionnelle, Ed Dalloz, n° 1, p. 144
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.