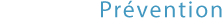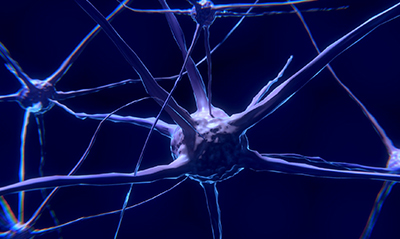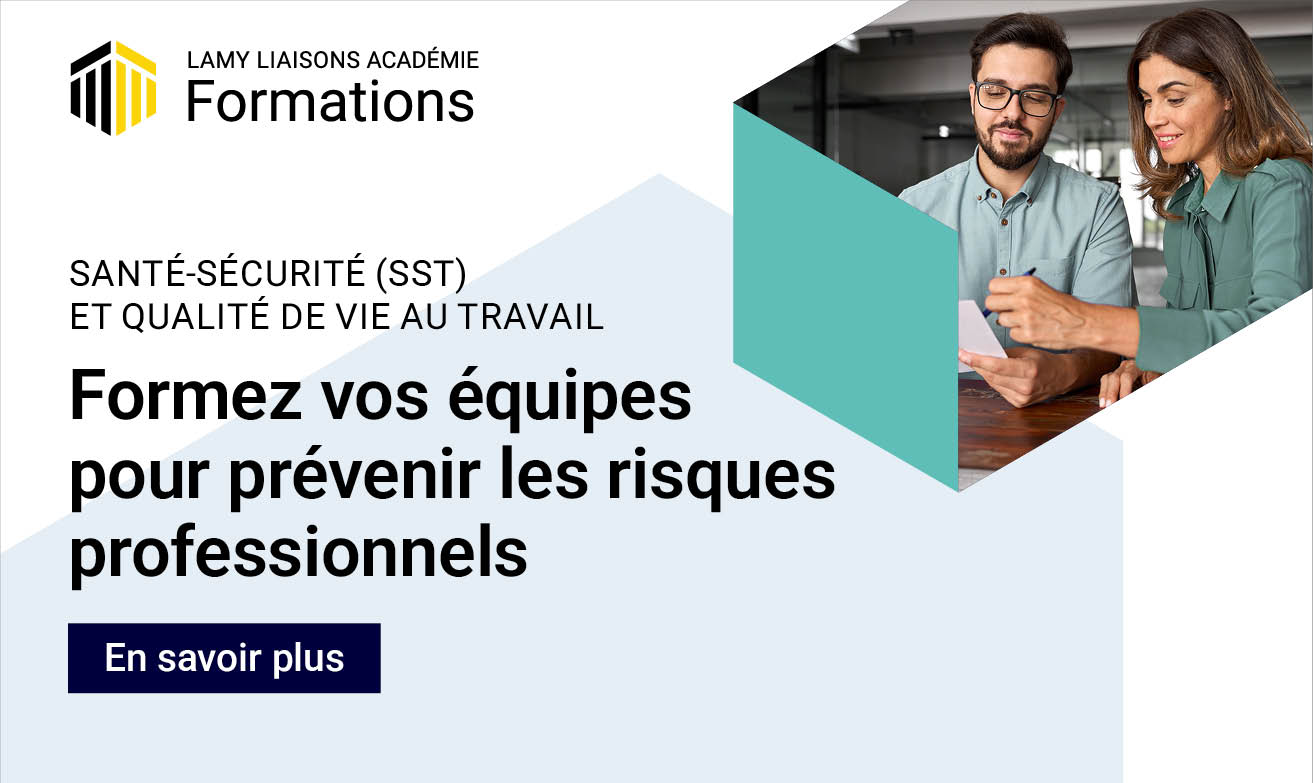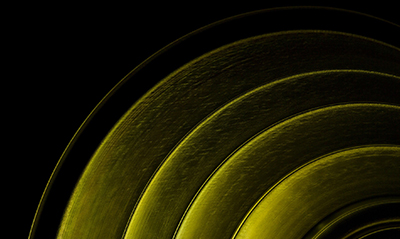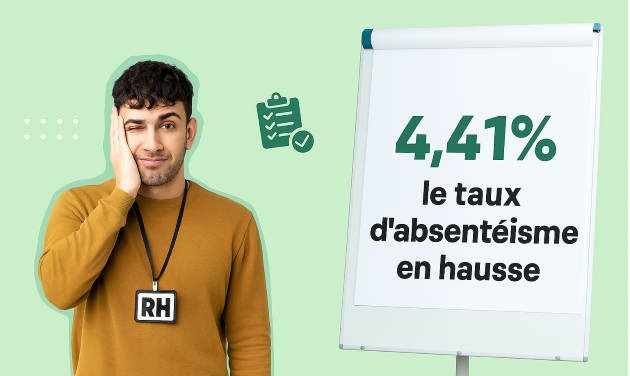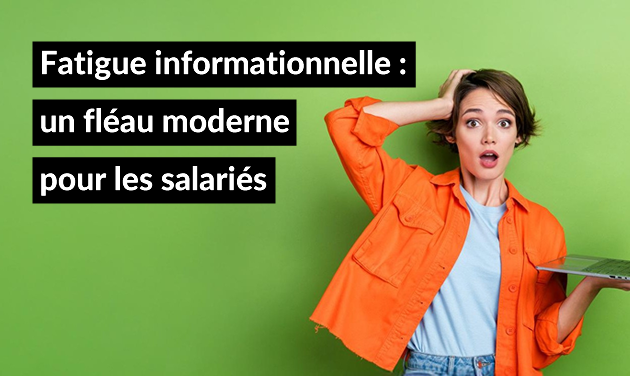
« L’Homme au coeur de la sécurité industrielle », un think tank de GrDF
Ingénieur en électrotechnique, entré chez EDF-GDF en 1982, Patrick Bonneau est aujourd’hui membre du comité exécutif de GrDF et directeur des régions Manche-Mer du Nord et Est. Il est également administrateur de la société italienne Italcogim (Groupe GDF Suez).
Embauché à EDF-GDF Services Versailles en 1982, Patrick Bonneau a ensuite occupé des fonctions managériales et d’appui dans le domaine des ressources humaines, puis des relations avec la clientèle et les collectivités locales, qui l’ont mené successivement en Savoie et en Corse. Lorsqu’en 2000, il est nommé directeur d’EDF-GDF Services Alsace, Gaz de France lui confie aussi la mission de délégué régional Alsace.
Sollicité dès 2003 pour intégrer l’équipe dirigeante en charge de la construction du distributeur de gaz naturel GrDF, en réponse à l’évolution législative adaptant les directives européennes d’ouverture du marché de l’énergie, il assure la direction des ressources humaines de la nouvelle entité jusqu’en 2007. Membre de l’équipe de direction de GrDF, il est déjà directeur opérationnel de toutes les unités de GrDF de la région Manche-Mer du Nord, lorsqu’en août 2009, il est aussi chargé de superviser les unités de la région Est. Depuis, il est à la fois membre du COMEX de GrDF et directeur des régions Manche-Mer du Nord et Est, assurant la responsabilité de la distribution du gaz naturel au sein des régions Basse-Normandie, Haute-Normandie, Picardie, Nord-Pas-de-Calais, Lorraine, Alsace, Franche-Comté et Champagne-Ardenne, soit 8 des 22 régions françaises qui pèsent d’un poids important dans l’activité gazière nationale. Patrick Bonneau est aussi administrateur de la société italienne Italcogim (Groupe GDF Suez). Il ne cache pas son attrait fort pour la Toscane en particulier et l’Italie en général (que son engagement dans Italcogim confirme), un nécessaire ressourcement régulier en montagne et une grande croyance dans la capacité des hommes à relever les défis, à quelque niveau qu’ils se situent ; pour lui, « il n’y a pas de petite ou grande réussite dès lors qu’il y a engagement fort ».
GrDF est une entreprise industrielle qui assure la distribution du gaz naturel pour le compte de tous les « commercialisateurs », auprès de plus de 11 millions de clients consommateurs.
L’entreprise exploite un réseau de près de 190 000 km de canalisations, dans plus de 9 200 communes en France. Filiale du Groupe GDF Suez, GrDF a repris, depuis le 1er janvier 2008, l’activité exercée jusqu’alors par Gaz de France.
Bénéficiant du passé industriel de l’opérateur historique, GrDF s’est attaché à développer son activité en consolidant à la fois son rôle de gestionnaire d’actifs (les composants du réseau : canalisations, postes de détente, organes de manoeuvre...) par une meilleure connaissance de son patrimoine et des investissements réguliers de renouvellement, et son rôle d’opérateur de réseau, par un engagement accru en matière de maintenance (détection préventive des fuites ou entretien et manoeuvre régulière des vannes) et une refondation de l’exploitation (conduite et dépannage 24h / 24).
Votre entreprise s’est très fortement engagée dans les questions de maîtrise des risques industriels. Pourquoi ?
Quelques semaines après sa création, GrDF a été confronté à un accident industriel grave consécutif à l’endommagement d’une conduite de gaz lors de travaux de BTP sur la voie publique.
Au-delà du retentissement médiatique d’un tel accident et du risque image qui peut affecter la confiance de nos parties prenantes (clients, « commercialisateurs » et surtout collectivités locales) ; au-delà de l’attention particulière qu’il suscite de la part des pouvoirs publics et du risque réglementaire qui en découle, cet événement a provoqué une forte mobilisation de la direction générale de l’entreprise : notre réseau est vulnérable et malgré l’amélioration constante des actes de maintenance, les dommages aux ouvrages sont le principal point de faiblesse ! En 2008, plus de 6 000 situations dangereuses ont ainsi été créées par des incidents de cette nature, provoquant fuites voire incendies sur la voie publique.
Ce constat cruel a servi de déclencheur à la mobilisation de la société. Il n’est désormais plus acceptable, pour la direction, que le réseau de gaz naturel exploité par GrDF provoque des victimes !
Bien sûr, de très importants investissements avaient été réalisés par GrDF pour rénover le réseau ; GrDF investit ainsi environ 1 million d’euros par jour en sécurité industrielle.
L’analyse des risques, fondée sur l’examen attentif des incidents, avait permis de mieux engager les investissements ; l’organisation de l’entreprise avait été revue à l’occasion de la filialisation, mais il s’agissait désormais d’aller plus loin et d’engager une véritable révolution culturelle pour ancrer la sécurité industrielle au coeur du projet et de l’action de chaque salarié de l’entreprise.
Afin de soutenir cet effort, vous êtes à l’origine de la création d’un think tank sur le thème « L’Homme au coeur de la sécurité industrielle ». Quelles en sont les motivations ?
En réaction à cet accident et afin de soutenir la mobilisation de l’entreprise, nous avons organisé des Assises de la sécurité industrielle, en mai 2008, rassemblant, pour la première fois dans l’histoire de notre société, des dirigeants et des opérateurs techniques de GrDF, mais aussi des représentants des services de secours, des hauts fonctionnaires du MEEDDM ou des DREAL, des entreprises du BTP et des intervenants spécialistes de la maîtrise du risque industriel.
Durant deux jours, les débats, francs et engagés, ont permis d’opérer un constat lucide et partagé.
À la suite de ce séminaire « déclencheur », des actions ont été engagées dans chaque unité opérationnelle pour renforcer la prévention des risques (meilleur traitement des DR-DICT adressées par les entreprises du BTP préalablement à leurs interventions, vérification et renforcement de nos schémas de vannage permettant l’interruption de l’alimentation en gaz en cas d’incident, présence renforcée de GrDF à l’occasion des chantiers à proximité des canalisations les plus sensibles... mais aussi formation en amont des intervenants du BTP ou vérification et amélioration de la qualité de nos bases cartographiques).
Des groupes de travail ont été conduits, à l’instigation des pouvoirs publics pour travailler avec les experts techniques de GrDF à l’évolution de la réglementation. Des modalités nouvelles d’intervention ont été initiées avec les SDIS.
Mais, au-delà de ces réponses nécessaires et des engagements forts de GrDF, nous avons également mobilisé un groupe de réflexion transverse pour développer un autre regard sur la maîtrise des risques industriels. Composé d’une dizaine de participants, dirigeants d’entités opérationnelles apportant leur expérience quotidienne du terrain, mais aussi acteurs du domaine RH et des fonctions d’appui de l’entreprise en charge des démarches de transformation ou de performance, ce groupe informel, sorte de think tank dédié au risque industriel, s’est engagé dans une réflexion ouverte sur le comportement des intervenants, les « moteurs » de l’analyse du risque, la relation entre les opérateurs lors de l’exécution des actes techniques... Par ces réflexions conduites en parallèle des réponses techniques et institutionnelles, il s’agit pour nous de placer l’Homme au coeur de la sécurité industrielle.
Comment ce dispositif original de travail s’est-il organisé ?
En sollicitant l’expertise de Franck Guarnieri de Mines ParisTech pour animer nos travaux, nous avons totalement placé nos échanges sous l’angle de l’influence des facteurs humain et organisationnel dans la gestion du risque industriel. Par son intermédiaire, nous avons accédé aux témoignages précieux de responsables de la sécurité dans de grands groupes industriels comme Rhodia ou le pôle nucléaire d’EDF, favorisant ainsi le partage d’expérience et l’émergence d’idées nouvelles.
Afin de placer nos travaux dans un cadre moins formel que l’univers professionnel, nous avons délibérément installé un rite de fonctionnement : salon « cosy », séquence de travail placée en fin de journée, durant 2 h 30, en table ronde, suivie d’un dîner permettant la poursuite des débats dans un contexte encore plus convivial. Chacune des séquences de travail, conduites à un rythme trimestriel, 5 à ce jour, est tracée et « historisée ». Nous avons associé à ce groupe un jeune doctorant engagé par ailleurs avec GrDF dans le déploiement d’une démarche de REX (élaboration et partage entre techniciens des retours d’expérience suite à incident).
Les débats sont nourris et libérés. Ils permettent, par itération, de mieux mettre en perspective les différentes (et nombreuses) démarches de progrès et de performance déployées dans l’entreprise : démarche prévention-santé-sécurité, analyse des situations dangereuses, démarche performance (application du lean management), démarche facteurs humains et organisationnels... et de les comparer avec les expériences des « grands témoins » ou rapportées par Franck Guarnieri et ses travaux de recherche.
Ces débats, nourris, permettent de mieux mettre en perspective les diff érentes démarches de progrès et de performance déployées dans l’entreprise
Quels principaux enseignements avez-vous retirés de ce dispositif ?
Nos travaux ne sont pas complètement achevés, mais je peux citer quelques initiatives ou idées (simples mais efficaces) issues de nos échanges :
- c’est une évidence, mais la constance de l’engagement de la direction est une condition nécessaire de la réussite des démarches de sécurité industrielle ;
- de même, il ne peut y avoir de différence entre sécurité industrielle et prévention des risques pour les salariés et les sous-traitants. De ce fait, nous avons engagé un rapprochement entre ces deux démarches, pilotées par des responsables distincts. Une première étape a été franchie par la diffusion de communiqués communs ;
- la seconde étape consistera à nous doter d’un même référentiel pour mesurer les progrès, mais surtout garantir leur conformité à nos ambitions...
D’autres initiatives sont actuellement en cours de concrétisation. Elles seront autant de jalons dans notre progression vers une plus grande maîtrise des risques industriels.
Il nous faudra ainsi mieux caractériser comment incarner et faire vivre une culture de sécurité industrielle parmi nos collaborateurs et, avec les managers et les responsables RH, poursuivre notre interrogation sur le rapport à la règle et aux procédures, et le rapport aux sanctions lors des transgressions...
À titre personnel enfin, j’ai beaucoup appris de ce dispositif.
Il est un moment fort de partage, d’ouverture sur d’autres expériences, mais aussi une très enrichissante occasion de placer nos réflexions « hors du cadre ». Je renouvellerai certainement ce dispositif dans d’autres occasions. Je sais que ces impressions sont largement partagées par tous ceux qui ont participé avec assiduité à ces travaux. Dans un contexte professionnel toujours très chargé, cette présence régulière est un signe tangible de l’intérêt porté et de la satisfaction recueillie.
Philippe Zawieja
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.