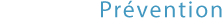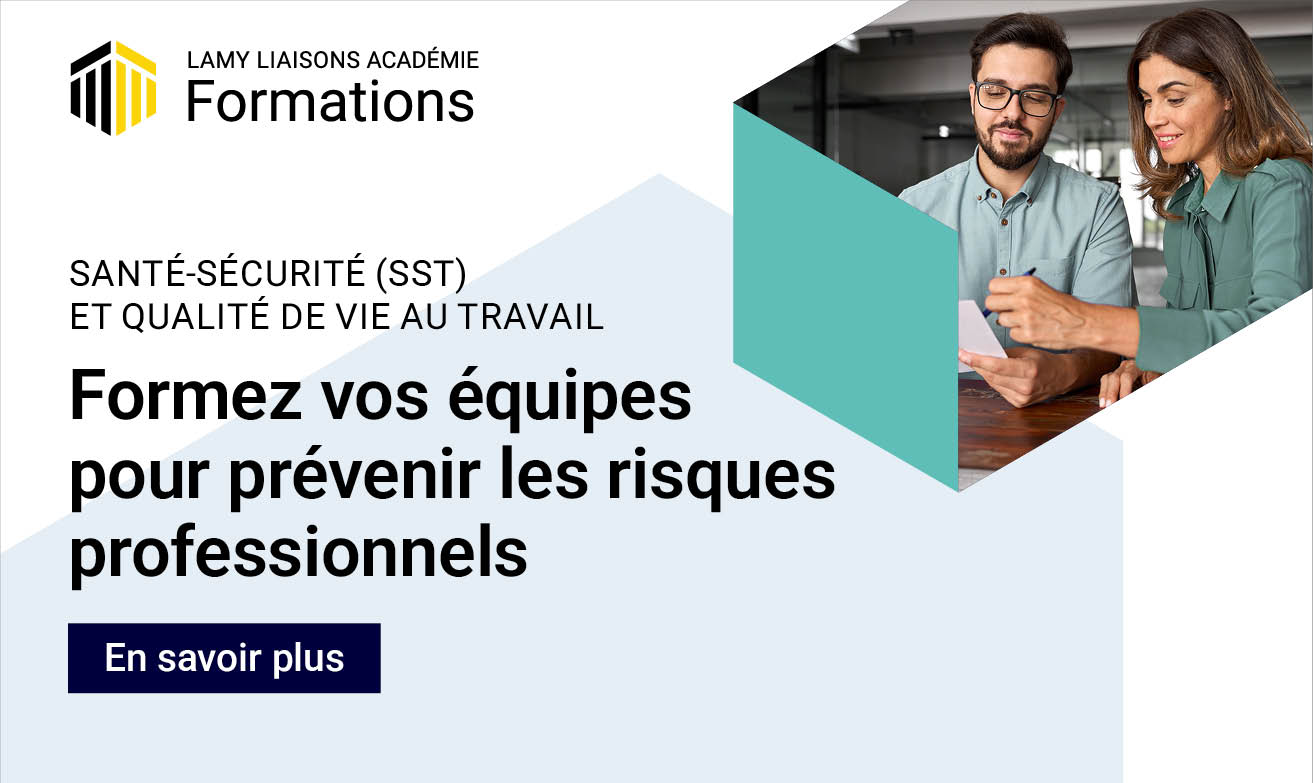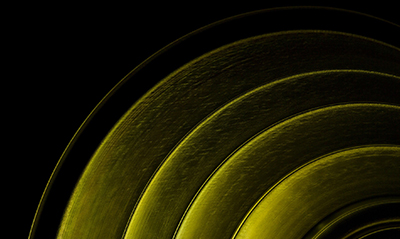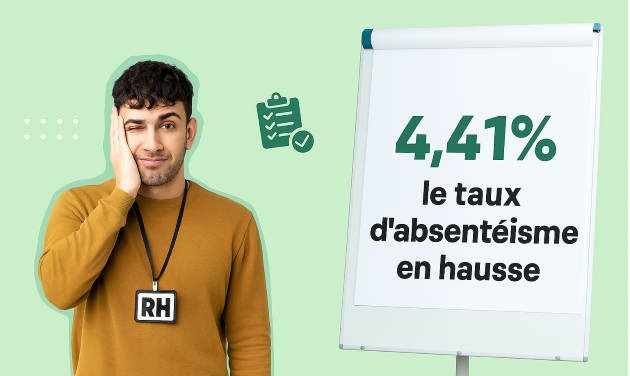La santé et la sécurité au travail est, avec la sureté de fonctionnement, un domaine privilégié d’application des techniques liées au retour d’expérience ; c'est-à-dire la collecte et la mémorisation des accidents et incidents du travail, l’analyse des informations et le traitement des causes les concernant, la capitalisation et le partage des connaissances ainsi acquises, pour mettre en pratique les transferts de savoirs et renforcer les comportements performants en matière de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels.
La santé et la sécurité au travail est, avec la sureté de fonctionnement, un domaine privilégié d’application des techniques liées au retour d’expérience ; c'est-à-dire la collecte et la mémorisation des accidents et incidents du travail, l’analyse des informations et le traitement des causes les concernant, la capitalisation et le partage des connaissances ainsi acquises, pour mettre en pratique les transferts de savoirs et renforcer les comportements performants en matière de sécurité du travail et de prévention des risques professionnels.
Le retour d’expérience est une composante fondamentale de la gestion des risques, car l’analyse méthodique des dysfonctionnements et imperfections de l’existant permet d’ajuster en conséquence la perception des risques et de prendre des mesures qui permettent de réaliser les corrections et améliorations, de réviser les pratiques et procédures de sécurité du travail, afin de réduire les travers observés et d’améliorer toute la chaîne de prévention.
Le retour d'expérience est un outil d'apprentissage pour tous les acteurs de l’entreprise, opérationnels et préventeurs, ou chacun est concerné pour identifier des pistes de progrès et lancer leur mise en œuvre, dans leurs diverses composantes techniques, humaines, organisationnelles.
La nécessité du retour d’expérience pour la sécurité du travail
La sécurité du travail repose sur un système sociotechnique, ensemble géré sur le plan de la sécurité par des mesures de prévention collectives et individuelles destinées à protéger les travailleurs contre les accidents du travail. Or, plusieurs failles au cours du temps sont susceptibles d’apparaître, qui témoignent d’une baisse de niveau de la sécurité, que le retour d’expérience a pour but de redresser systématiquement à l’occasion de l’analyse des pannes, incidents techniques, accidents, et erreurs ayant eu des conséquences sur ce système.
Ces défaillances proviennent de trois grandes catégories de causes (conditions matérielles ou techniques, facteur humain, problèmes organisationnels), interdépendantes pour certaines d’entre elles :
- Absence d’analyse préalable de certaines possibilités d’événements non souhaités, ou mauvaise prise en compte des risques qu’ils induisent, soit pour leur fréquence soit pour leur gravité potentielle.
- Mauvaise appréciation des aléas sur la tenue des composants techniques du fait de l’inévitable évaluation probabiliste de la sécurité.
- Complexité des interactions de multiples paramètres se combinant entre eux de manière exponentielle, générant un éventail innombrable de possibilités.
- Des erreurs de vigilance, de négligence ou d’appréciation des conséquences d'un écart constaté par rapport à la norme ou au fonctionnement normal.
- Analyse comportementale négligée ; les comportements à risque des travailleurs sont pourtant souvent à la source d’accidents, même si le poste de travail possède des dispositifs de sécurité et malgré de bonnes conditions de travail.
- La dimension inter-organisationnelle ajoute encore une série de malentendus, désaccords, ambiguïtés,...préjudiciables à la sécurité du travail : par exemple, certains services minimisent, voire nient le risque de leurs activités en majorant celui des autres et réduisent leurs efforts de prévention en prétendant qu’il s’agit de la responsabilité d’autrui, ce qui hypothèquent gravement les chances de gérer la situation de danger.
Tous les éléments matériels ou techniques comportent une part d’incertitude et de combinatoire qui peuvent très difficilement être tous appréhendés par une analyse a priori, ce qui justifie l’examen a posteriori des événements ayant pu mettre en cause la sécurité du travail, à en rechercher les causes avec les enchaînements et les conjonctions de faits générateurs, à en retirer les enseignements pour mettre en place des actions correctives.
Mais ce sont surtout les éléments mettant en jeu le facteur humain ou ceux liés aux problèmes organisationnels qui ne peuvent pas, par nature, faire l’objet d’une analyse préalable vraiment fiable, car leur compréhension passe beaucoup par l’observation et l’expérience, tellement le comportement observé peut être différent de celui prévu : penser que les comportements de sécurité s'effectueront de manière appropriée n’est pas du tout certain.
Les « erreurs humaines » sont souvent révélées lors des expertises des accidents : ces « erreurs » témoignent très souvent d’une mauvaise perception des risques qui est souvent affectée d’un certain nombre d’illusions perceptives et ces illusions sont susceptibles d’affecter inconsciemment le comportement vis-à-vis de la sécurité et de la motivation à la propre protection du travailleur, ce qui est impossible à prendre en compte dans une démarche a priori. Identifier les comportements à risque les plus fréquemment adoptés par les employés est alors l’apport des observations et des feedback du retour d’expérience.
Sur le plan organisationnel, la présence d'acteurs multiples intervenant dans la gestion à chaque niveau d'organisation ou de pilotage, entraîne de nombreux conflits entre des acteurs de même niveau ou des acteurs agissant à des niveaux différents, très dommageables pour la gestion et le management du processus de danger, d’autant que les problématiques sont toujours transversales, et la dilution des responsabilités est une cause majeure de survenues d’accidents. La démarche de retour d’expérience permet alors de susciter des échanges entre entités organisationnelles indépendantes, entre tous les acteurs partageant les informations dans un cadre commun de référence.
Sur un plan managérial plus général, l'absence d'un système de retour d'expérience induit que l’organisation ne porte pas attention, par une veille appropriée, à tous les signes précurseurs de dangers et de risques apparaissant dans la même profession, la même industrie ou le même secteur technique ou ignore les avertissements sur des pratiques considérées comme dangereuses dans d'autres établissements, ou pire, maintient des méthodes ou procédés qui ont conduit à des accidents dans sa propre structure : la veille interne, par l’écoute du personnel et des lanceurs d’alerte, et externe par la documentation, permet de détecter les signaux avant-coureur ou faibles, alimentant le retour d’expérience.
La mise en œuvre de la démarche du retour d’expérience pour la sécurité du travail
Plusieurs méthodologies ont fait leurs preuves dans la construction d’une démarche de retour d’expérience appliquée à un système sociotechnique. Les démarches de maîtrise des risques se sont développées de façon systématique d’abord sur des objets ou process très complexes (avions, centrales nucléaires....), au travers seulement de l’analyse des défaillances de leurs composantes technologiques, puis sur la totalité du système sociotechnique, en mettant en jeu l’impact des comportements humains.
La disponibilité de solutions informatiques ont accéléré la mise en relation, la communication des informations et facilité le stockage des données : néanmoins, pour recueillir et mémoriser ces données, il faut au préalable avoir défini les événements à signaler comme indésirables, anormaux, dangereux... et désigner et motiver les responsables de leurs repérage et analyse.
Mais, la mise en œuvre du retour d’expérience est toutefois difficile, même si on dispose de suffisamment d’informations statistiques et de données factuelles et historiques stockées dans les banques de données et de modèles explicatifs, en raison de divergences et conflits entre les différents acteurs, notamment entre les experts qui s'affrontent, des protagonistes sous le coup de l’émotion qui ont du mal à analyser sereinement la situation, en privilégiant les jugements hâtifs et subjectifs, en recherchant des boucs émissaires, avec une opinion immédiate souvent bien arrêtée, dans un contexte accusateur et conflictuel face à un accident du travail.
Il convient donc de développer une approche globale du retour d’expérience prenant autant en compte les aspects techniques, que les aspects humains et organisationnels plus difficilement mesurables et modélisables.
- La collecte de l’information
La réussite d’une méthode de retour d’expérience tient en premier lieu à l’exhaustivité, la qualité, la pertinence et l’utilité de l’information collectée sur la situation ou l’événement à analyser.
- Il faut tout d’abord disposer d’une liste d’événements à notifier, qualifiés d’événements graves, significatifs, mineurs... favorisant la généralisation et la capitalisation des expériences. Il s’agit soit d'un accident ou d'une situation d'urgence, soit d’un incident qui aurait pu dégénérer par malchance, d’un dysfonctionnement technique, alarmes se déclenchant indument ...
Il convient de ne pas s’intéresser qu’aux seuls grands accidents mais aussi à tous les petits incidents qui peuvent s’avérer être précurseurs d’incidents plus graves, surtout en permettant de détecter la répétition d’événements identiques ou similaires, symptômes de la dégradation de la situation.
- Ensuite, il faut formaliser des informations recueillies : le retour d’expérience est fondé sur la mémoire non seulement des faits, mais aussi des perceptions et des relations de causalité que les différents acteurs ont acquis lors d’un événement.
La bonne représentation de la connaissance suppose que toutes les informations puissent être comparées et assemblées, avec un cadre conduisant à des réponses aussi complètes et homogènes que possible. On assure ainsi la production de documents normalisée et structurée.
Ceci conduit à disposer dune fiche descriptive d’événement, avec des informations codifiées, pour alimenter une base de données, ce qui permettra ultérieurement des traitements informatiques.
On distingue plusieurs bases de retour d’expérience possibles :
• d’une part, celles liées à la survenue d’événements impactant la sécurité : dans ce cas, les informations ne doivent alors pas se limiter au factuel mais comprendre aussi le contexte et les motivations des acteurs.
• d’autre part, celles liées aux matériaux, machines ou équipements décrivant leurs défaillances, dégradations, avec des données issues de la maintenance, des inspections, des réparations et des statistiques de fonctionnement.
- les opérateurs directement concernés ("en première ligne") sont les principaux acteurs du recueil d’informations, avec le responsable sécurité, les membres du CHSCT, le responsable hiérarchique du secteur.
- Cela prend la forme d’une conduite d'entretiens, d’une animation d'un groupe de travail suivie d’une formalisation des informations recueillies.
- La démarche de retour d’expérience doit être engagée le plus tôt possible (moins d’une semaine) après l’événement pour éviter les oublis et les reconstructions personnelles qui nuisent à l’histoire réelle de l’événement, avec un délai un peu plus long pour les accidents graves afin que les témoignages ne soient perturbés par une charge émotionnelle trop forte.
- Lors des entretiens, l’interviewer doit éviter les attitudes culpabilisantes et accusatrices, les mises en cause personnelles d’autres collègues ou de responsables hiérarchiques ; il convient d’expliquer qu’il ne s’agit pas d’un procès mais d’une démarche d’amélioration de la sécurité au travail, et que cette attitude (pourtant très fréquente) est contre-productive : certains acteurs ou témoins s'abstiennent de toutes déclarations (« je ne n’ai rien vu, cela s’est passé très vite ») ou biaisent les observations qu’ils fournissent afin d'éviter des sanctions éventuelles. La perspective de sanctions vis à vis des manquements aux consignes de sécurité peut ainsi générer des conséquences néfastes comme la dissimulation des sources de dangers. - Le traitement de l’information
Il s’agit d’identifier en détail, la genèse, l'évolution et la gestion de l'événement dans ses diverses composantes.
L'analyse des causes des accidents et incidents suppose de disposer d’une méthode comme celle de l’arbre des causes.
L’arbre des causes est une méthode d’analyse a posteriori d’un accident, pour en obtenir une description objective, reconstituer le processus accidentel, en identifiant tous les facteurs (dont les facteurs humains) et leurs relations ayant concouru à sa survenance, de façon à proposer des mesures de prévention pour qu’il ne se reproduise pas.
Les études probabilistes de sûreté (EPS) sont des méthodes d’évaluation des risques fondée sur une investigation systématique des scénarios accidentels, permettant d’apprécier les risques liés à un système industriel complexe en termes de fréquence des événements redoutés et de leurs conséquences et aidant à déterminer les axes de progrès sécuritaires les plus intéressants : c'est, par exemple, un instrument fondamental d’analyse et de management de la sûreté des centrales nucléaires.
Des formations aux techniques d'analyse des facteurs humains et à l'analyse systémique d'accidents sont proposées par de nombreux cabinets de conseil, qui préparent à l’interprétation des données objectives et subjectives issues de la collecte d’informations.
Cette étape du retour d’expérience permet de réduire les zones d’incertitude liées aux aléas techniques, de mieux appréhender les conséquences des erreurs humaines ou des défauts organisationnels et d’en mesurer les dommages, de critiquer l’efficacité des mesures de prévention antérieures et en tirer les enseignements afin de proposer les mesures correctives adaptées.
Puis, l’archivage de toutes les données relatives aux accidents et incidents sous la forme de données normalisées et structurées permet de réduire les situations d’incertain et d’ambiguïté des multiples effets : l’analyse statistique est alors un outil fondamental qui permet de trouver les fréquences, les répartitions temporelles et spatiales, les corrélations significatives dans les nombreuses causes interdépendantes de tous les événements survenus. Par exemple, le calcul de la durée de vie des composants ou de leur temps moyen entre pannes (MTBF), afin de faire une évaluation prévisionnelle de la fiabilité et d’optimiser les périodes de maintenance préventive est un des apports essentiels de l’étude de la fiabilité des systèmes réparables qui concourent à la sureté de fonctionnement, et par la même à la sécurité des opérateurs, qui consiste en l'aptitude de ce système à ne pas conduire à des accidents du fait de ses défaillances.
Par ailleurs, des méthodes d’analyse quantitative des facteurs humain et organisationnel sont rendues possibles et pertinentes. - La centralisation et la capitalisation de l’information
Sur le plan informatique, il faut développer les méthodes d’accès, de classement et de traitement liées au langage naturel, par extraction du savoir à partir de grandes quantités de données, par des méthodes automatiques de « data mining » : ces méthodes facilitent les possibilités d'analyse discriminante, de corrélation et de consultation directe aux données, dans de vastes référentiels.
L’action de capitalisation se caractérise alors par l’adoption d’une série d’actions de prévention qui englobent et surpassent la connaissance de tous les acteurs. - Le partage des connaissances
Le retour d’expérience ne doit pas se limiter à la remontée d’informations uniquement destinées aux experts HSE et à l’encadrement.
Il s’agit aussi de faciliter la redescente des enseignements du retour d’expérience, de partager les connaissances pour assurer l’information pertinente de tous les acteurs, avec des recommandations concrètes, claires et simples : l’appropriation, la compréhension des outils et de leurs apports par ceux qui conduisent la démarche est un facteur essentiel de succès, et cela passe à la fois par le processus d’animation initial de la collecte puis par celui de la restitution. Les enseignements du retour d’expérience doivent d’abord être profitables aux acteurs « en première ligne », non seulement pour accroitre leur sécurité par des améliorations perceptibles, mais aussi pour conserver une motivation durable des opérateurs de terrain à maintenir la pérennité du recueil des informations nécessaires au retour d’expérience, dans un processus continu d’amélioration constante.
Pour aller plus loin
OFFICIEL PREVENTION : Dossiers Formation > Formation continue à la sécurité : L’arbre des causes d’un accident du travail
Mars 2011
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.