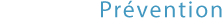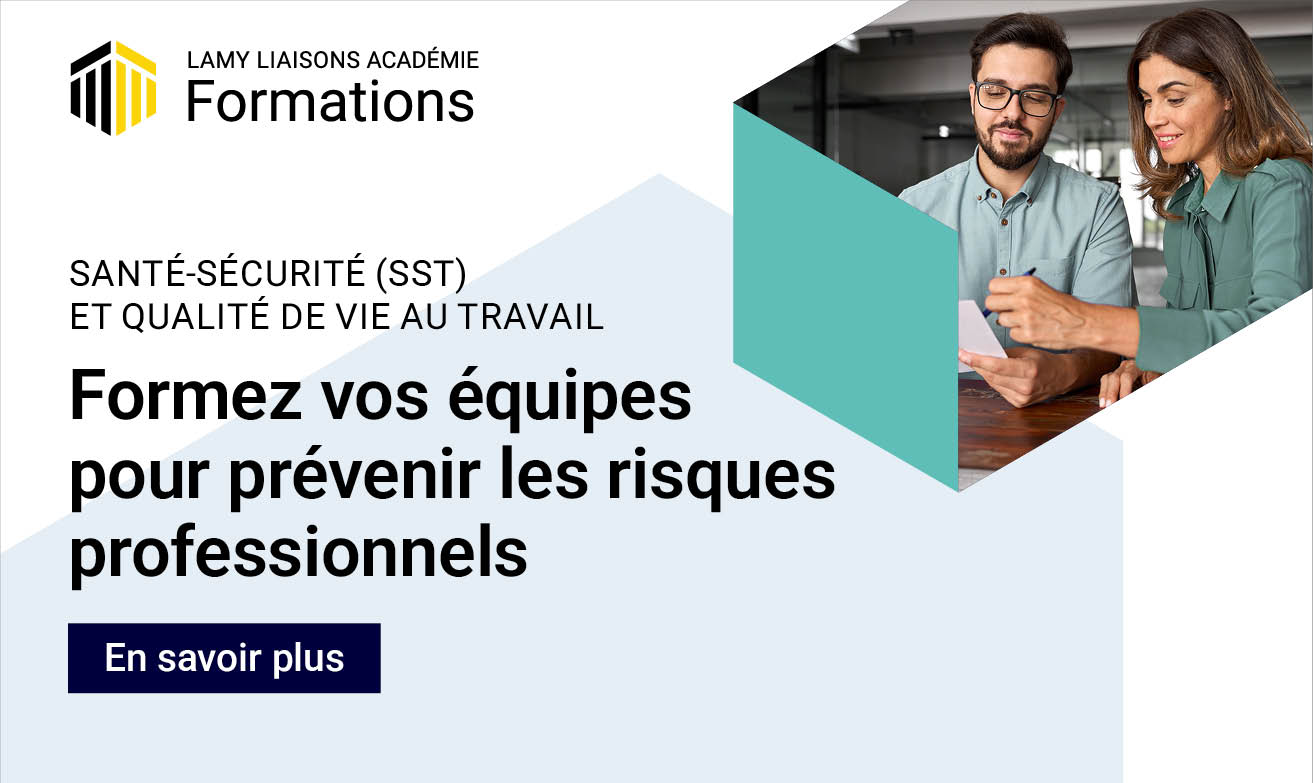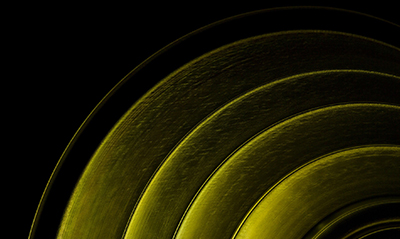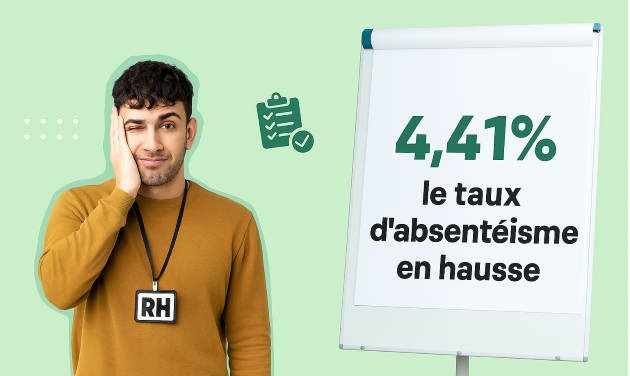Des situations professionnelles variées exposent de nombreux métiers aux risques d’affections fébriles, par suite d’inhalation nocive d’aérosols infectés, de fumées, de poussières allergènes organiques et métalliques : les causes de fièvre professionnelle les plus fréquentes sont les atteintes des voies respiratoires hautes et basses. Les informations concernant l'environnement professionnel d’un patient ayant une fièvre inexpliquée s’avèrent indispensables pour identifier les activités professionnelles éventuellement responsables.
Des situations professionnelles variées exposent de nombreux métiers aux risques d’affections fébriles, par suite d’inhalation nocive d’aérosols infectés, de fumées, de poussières allergènes organiques et métalliques : les causes de fièvre professionnelle les plus fréquentes sont les atteintes des voies respiratoires hautes et basses. Les informations concernant l'environnement professionnel d’un patient ayant une fièvre inexpliquée s’avèrent indispensables pour identifier les activités professionnelles éventuellement responsables.
La fièvre se traduit par une température corporelle interne élevée, supérieure à 38°C, entrainant transpiration, déshydratation, frissons, tachycardie, malaise général. La fièvre est une réaction de l’organisme à des agents infectieux, fongiques, inflammatoires ou allergènes en sollicitant le système immunitaire, par l’intermédiaire de plusieurs cellules : en particulier les cellules macrophages qui vont phagocyter les agents pathogènes et libérer une substance (cytokine) provoquant l’augmentation de la température du corps. La fièvre réaliserait un environnement défavorable au développement des agents infectieux. La fièvre est le plus souvent déclenchée par des agents viraux ou bactériens ou fongiques, mais d’autres agressions extérieures, chimiques, thermiques, de substances allergènes et pyrogènes, provoquent aussi la réaction des cellules à l’origine de la montée en température pilotée par le « thermostat » corporel situé dans l'hypothalamus.
Des antigènes inhalés, très souvent liés à une dégradation de la matière avec développement de bactéries et de moisissures, peuvent entraîner une « alvéolite allergique extrinsèque » qui est une pneumopathie d'hypersensibilité avec fièvre (alvéolite des boues d'épuration, maladie des poumons des fromagers, maladie des poumons du fermier …).
Les fièvres d’origine professionnelle peuvent connaitre une phase aigüe de quelques jours , mais aussi conduire à des phases subaiguës ou des formes chroniques avec plusieurs symptômes graves :
- La « fièvre des métaux » et d’autres fièvres par inhalation de poussières (telle l'inhalation excessive de poussières textiles provoquant la byssinose, resserrement transitoire des voies respiratoires donnant la « fièvre de filature ») disparaissent souvent dès l'arrêt de l'exposition aux poussières pour ne réapparaître soudainement qu'àl'exposition suivante, d'où le terme de « fièvre du Lundi ».
- Par contre, l’évolution de certaines fièvres non traités efficacement, peut entrainer aussi des situations de chronicité avec des complications de toute sorte, cardiologiques, neurologiques, hépatiques, rénales (maladie de LYME, fièvre Q, fibrose pulmonaire des pneumopathies d’hypersensibilité ….).
Les affections fébriles respiratoires présentent une susceptibilité individuelle variable et le tabagisme comme cofacteur aggravant majeur.
La plupart des fièvres d’origine professionnelle peuvent être prises en charge au titre de la maladie professionnelle (exemples : tableau n°66 bis du Régime Général pour les pneumopathies d'hypersensibilité, tableau n°6 du Régime Agricole pour la brucellose …).
La mesures de prévention de tels risques d’exposition, à la base d’une protection efficace, repose sur :
- La prévention technique collective : ventilation du local, systèmes d’aspiration et captage à la source, isolation des procédés et capotage des machines …
- La prévention individuelle : un équipement de protection respiratoire individuelle est parfois indispensable, mais il doit être considéré comme une mesure exceptionnelle et provisoire en matière de protection respiratoire dans les situations d'urgence ou temporaires (travaux d’installation ou d'entretien).
- La vaccination des travailleurs dans le cas des agents viraux ou bactériens.
- Pour les travailleurs exposés, il faut réaliser des visites médicales régulières (spirométrie, radiographie thoracique si nécessaire, épreuves fonctionnelles respiratoires).
- L’information et la formation sont également des éléments nécessaires pour faire prendre conscience des dangers encourus, pour savoir les identifier et mettre en œuvre les moyens pour les prévenir.
Les différentes causes de fièvre d’origine professionnelle
Les travailleurs exposés à un risque biologique causé par l'exposition à des agents pathogènes viraux ou bactériens représentent 10% des salariés environ : certains métiers exposent à un risque évident élevé d'infections (personnel médical et de secours, vétérinaires …), mais d'autres professions font l'objet aussi de risques infectieux dans certaines situations de travail (personnel des agents d’assainissement, des laboratoires, des abattoirs, agriculteurs …) :
- contact avec le corps de malades, blessés, cadavres (hôpitaux, pompiers, autres services sanitaires et funéraires, policiers).
- contact exposant aux liquides et secrétions biologiques (hôpitaux, pompiers, laboratoires d'analyse, blanchisseries).
- relations de promiscuité avec des enfants, des personnes âgées, handicapées ou en situation précaire.
- contact avec des animaux domestiques ou sauvages (éleveurs, forestiers, vétérinaires, fourrières, abattoirs, etc.).
- contact avec des déchets ou ordures ménagères (agents de nettoyage, personnes sur le réseau d'assainissement ou en station d'épuration, égoutiers, ripeurs, employés de voirie, de tri des déchets …).
- contact d'une plaie ouverte avec le sol ou la terre (agriculteurs, forestiers, …) ou sur les objets métalliques rouillés (mécaniciens, ferrailleurs … ).
En cas de grossesse, les risques infectieux zoonotiques concernent aussi le fœtus dans certaines zoonoses (fièvre Q par exemple).
Les maladies professionnelles induites avec apparition d’un état fébrile sont nombreuses et figurent parmi elles :
- HEPATITE A : contamination par les eaux usées et les déchets, pour le personnel des crèches et écoles maternelles, les travailleurs au contact des eaux usées, les employés des services de restauration collective, ….
Gravité variant du syndrome grippal (avec fièvre, céphalées et douleurs musculaires), avec un ictère.
- GRIPPE et COVID-19 : contamination aéroportée entre individus, maladies facilement transmissibles dans la promiscuité des milieux confinés de travail (bureaux en open space etc.), mais ne sont pas spécifiques d’une exposition strictement professionnelle. Tous les locaux industriels, commerciaux et tertiaires plus ou moins confinés et à plus ou moins grande fréquentation sont des lieux propices à la propagation de ces virus respiratoires.
Fièvre, céphalées et courbatures, complications broncho-pulmonaires possibles.
- LEPTOSPIROSE : contamination par des eaux infectées par les urines et déjections des rats, pour le travailleur au contact des eaux usées (égoutiers, personnel de voirie, tec.); dans des lieux susceptibles d'être souillés par des rats (travaux dans les mines et carrières, tunnels, caves, souterrains) ou exposés au contact avec ces animaux ou leurs déjections (abattoirs, laiteries).
Les symptômes associent fièvre, frissons, douleurs musculaires et céphalées, asthénie puis atteintes viscérale, hépatique, rénale si non soignée.
- ENCÉPHALITE À TIQUES : maladie virale transmise par les tiques (qui est différente de la maladie de Lyme, maladie bactérienne), pour le personnel travaillant au contact des eaux usées (égoutiers, personnel de voirie, gardes-pêche, parcs aquatiques);
Fièvre et troubles neurologiques.
- MALADIE DE LYME : causée par une bactérie transportée par certaines tiques qui la transmettent ensuite par morsure. La maladie de Lyme est une préoccupation professionnelle pour les personnes qui travaillent en forêt, dans des zones boisées ou prairies : elle provoque des éruptions cutanées et des symptômes pseudo-grippaux (fièvre, maux de tête, douleurs musculaires ou articulaires) dans les cas bénins et, dans les cas graves non traités précocement, des symptômes très marqués affectant les articulations, le cœur et le système nerveux.
- LEGIONELLOSE : maladie pulmonaire de l’entretien des unités de climatisation, souvent contractée à la remise en route des installations telles que les tours de refroidissements et les climatiseurs dans lesquels les bacilles de légionelles se sont multipliés plus facilement pendant la période d'inactivité. Deux maladies distinctes, la maladie du légionnaire et la fièvre de Pontiac, sont dues à la bactérie Legionella.
Fièvre très élevée (40°C), toux, frissons, nausée, difficultés respiratoires, céphalées, myalgies …, possiblement évoluant vers une pneumonie grave chez les personnes fragiles. Les symptômes de la fièvre de Pontiac sont principalement la fièvre et les douleurs musculaires (mais pas la pneumonie).
- BRUCELLOSE : Les sources les plus fréquentes d'infection sont les animaux d'élevage et les produits laitiers crus. La brucellose est contractée avec contact direct avec les sécrétions et les excrétions d'animaux infectés, l'ingestion de viande insuffisamment cuite, de lait cru, l'inhalation de poussières contaminées en aérosol. La brucellose est une maladie professionnelle touchant les métiers de la viande, les vétérinaires, les exploitants agricoles, les éleveurs.
Frissons et très forte fièvre vespérale (40°C), céphalées intenses, douleurs articulaires et lombaires.
- FIEVRE Q (coxiellose) : maladie infectieuse qui se transmet de l'animal à l'homme. Les bovins, les moutons et les chèvres portent le microbe, qui peut survivre pendant des mois, voire des années dans la poussière ou le sol. La fièvre Q se propage aisément dans les particules transportées dans l'air dans les régions rurales, infectant les personnes qui travaillent à l'extérieur et qui sont exposées à de la terre ou de la poussière infectées.
Fièvre élevée, frissons, transpiration. Possibilité de développement d’une forme chronique grave avec atteinte du foie et du cœur en l'absence de traitement adéquat.
- PSITTACOSE : maladie infectieuse aux symptômes semblables à ceux de la grippe. Cette maladie, zoonose appelée aussi « fièvre des perroquets » ou ornithose, peut être transmise aux humains par les fientes des oiseaux infectés, avec exposition aéroportée (poussières) ou manuportée.
La fièvre persiste parfois pendant plusieurs semaines.
- Les agents allergènes
Les pneumopathies (inflammations non infectieuses du tissu pulmonaire) d'hypersensibilité sont des maladies pulmonaires dues principalement à l'inhalation de poussières organiques provoquant une inflammation des alvéoles du poumon : les pathologies dues à l’exposition aux poussières organiques sont encore largement sous-diagnostiquées avec une épidémiologie souvent mal connue et une dangerosité plus insidieuse, notamment en agriculture.
Les Pneumopathies d’hypersensibilité ou PHS sont également appelées alvéolites allergiques extrinsèques :
- « alvéolite » car inflammation des alvéoles du poumon, petites cavités de la structure interne du poumon
- « allergique » car causée par une réaction allergique
- « extrinsèque » car cause extérieure à l'organisme
Les poussières organiques sont généralement un mélange en proportion variable de poussières végétales (foin, paille, cuticules des grains de céréales, spores, pollens, farine, cellulose du bois et du papier, fibres textiles ...), de particules animales (poils, plumes, fragments d’insectes, fientes et autres déjections et excréments ou urines) et de micro-organismes (acariens, moisissures et microbes et leurs toxines fongiques et bactériennes). Les poussières organiques peuvent contenir aussi des produits chimiques comme des résidus de pesticides, d’hydrocarbures, de solvants (formaldéhyde ...).
Ces poussières se retrouvent souvent en concentrations élevées dans les lieux clos et espaces confinés (zones de stockage, enclos à bestiaux, caves, ateliers ...).
Les poussières organiques en suspension dans l’air sont facilement inhalables, se logent dans la muqueuse nasale et certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et à pénétrer jusqu’aux alvéoles pulmonaires à travers tout l’arbre respiratoire.
Les pathologies, avec « fièvre des poussières », résultant de l’inhalation fréquente et prolongée des poussières organiques sont multiples :
- les pneumopathies d’hypersensibilité ou alvéolites allergiques extrinsèques (par exemple maladie du poumon du fermier, du fromager ...),
- la bronchite chronique : toux et expectoration chronique,
- les rhinites et asthmes allergiques ou non allergiques : éternuements, écoulement nasal, larmoiements, œdème des paupières, picotements laryngés ou épisodes successifs ou le rejet de l'air est difficile et pénible. Ces signes cliniques, immédiats ou retardés, peuvent survenir après sensibilisation du fait des poussières véhiculant les pneumallergènes,
- les broncho-pneumopathies toxiques, dont le syndrome toxique des poussières organiques : syndrome grippal avec toux et dyspnée.
A la phase aigüe plus ou moins intense d’une exposition à l'agent déclencheur, peut succéder une PHS subaiguë récurrente, avec progressivement une toux, une dyspnée, une fatigue, une anorexie, une perte de poids et une pleurésie. La forme chronique entraine l’apparition d’une fibrose progressive avec une perte de capacité pulmonaire, essoufflement permanent et bronchite chronique. Les signes et les symptômes et l‘évolution de la pneumopathie d’hypersensibilité varient d’une personne à l’autre.
De nombreux métiers sont très exposés aux risques d’inhalation nocive de
poussières organiques :
- Les agriculteurs
La manipulation de céréales, de foin, de paille, de compost, de grain
moisi, de fientes exposent les agriculteurs, horticulteurs, maraichers,
arboriculteurs, à des quantités élevées de poussières organiques et de
moisissures, responsable en particulier de la fréquente maladie du «poumon du fermier » (pneumopathie d’hypersensibilité), de la « fièvre des poussières » (syndrome toxique des poussières
organiques ou ODTS Organic Dust Toxic Syndrom), ou de l’aspergillose
pulmonaire suite à l’inhalation d’une très grande quantité de spores de la
moisissure Aspergillus contenues sur de la matière organique en
décomposition répandue.
Les travailleurs des unités de compostage et de tri de déchets organiques
sont aussi concernés par ces affections respiratoires, ainsi que les
champignonnistes.
- Les éleveurs
Les affections des voies respiratoires sont causées par l’inhalation
d’aérocontaminants, agents biologiques, moisissures, acariens et des
endotoxines présents massivement dans l’atmosphère des locaux confinés des
animaux d’élevage. Les bâtiments d’élevage intensif de bovins, ovins,
caprins, porcs et volailles sont des sources de situations d’exposition
intense aux particules organiques : poussières produites par les
nourritures animales et par la litière (contenant des micro-organismes, des
spores), poils et plumes d’animaux, squames et épithélium de gros animaux,
déjections, poussières générées par le paillage et l'affouragement...
Les affections respiratoires dans les animaleries sont souvent provoquées
soit par des poils d’animaux (fièvre du« poumon du fourreur »),
soit des plumes ou déjections d’oiseaux (« fièvre des oiseleurs
»). Ces pathologies de type allergique ou de type inflammatoire sont aussi
observées en pratique vétérinaire.
-
Les meuniers, semouliers, biscuitiers, biscottiers et boulangers
Les farines ou les substances ajoutées au cours de la fabrication (levures,
enzymes ...) ou les parasites (acariens, mites...) ou micro-organismes
(moisissures...) omniprésents dans l’air des ateliers de fabrication
peuvent être responsables de fréquentes réactions allergiques ou de gêne
respiratoire.
Le fort dégagement de poussières est généralement accidentel (débourrage ou
nettoyage d’une machine, ruptures et déversements de sacs...), mais
l’accumulation progressive de poussières très fines sans mesures de
prévention recouvre le sol, les parois des locaux, les chemins de câbles,
les gaines, les canalisations, les appareils et les équipements, notamment
pour tous les volumes morts, les recoins et endroits confinés difficilement
accessibles au nettoyage.
L’exposition aux poussières de farine est particulièrement nocive aux voies
respiratoires, car la farine est une substance très volatile et les
particules en suspension sont aisément inhalées, pénétrant jusqu’aux
alvéoles pulmonaires : les maladies allergiques induites sont l’asthme et
la rhinite avec éternuements, écoulement nasal, larmoiements, picotements
laryngés, avec souvent surinfection provoquant des sinusites et de la
fièvre.
- Les fromagers
Des antigènes inhalés dans des poussières, liés à une dégradation de la
matière avec développement de bactéries et de moisissures lors de
l’affinage des fromages (en particulier Penicillium casei ou Penicillium
roqueforti ou acariens sur les croûtes des gruyères, bleus, cantal...),
peuvent entraîner une alvéolite allergique ou pneumopathie
d’hypersensibilité (maladie des poumons des fromagers) : syndrome
respiratoire (dyspnée, toux, expectoration) et/ou signes généraux (fièvre,
amaigrissement).
- Les brasseurs et malteurs
Les poussières de farine et de céréales, les parasites (acariens...) ou
micro-organismes (moisissures...) omniprésents dans les malteries et
brasseries, peuvent être responsables de fréquentes réactions allergiques.
De nombreux pneumallergènes sont retrouvés dans les poussières de céréales,
particulièrement les endotoxines des bactéries et des toxines fongiques de
spores dont le rôle majeur dans l’inflammation de l’arbre respiratoire
explique l’apparition de bronchites chroniques.
L’exposition aux poussières, notamment dans les aires où les grains secs,
la levure sont manipulés, lors du retournement de l’orge ou lors de son
transfert, est particulièrement nocive aux voies respiratoires, car les
particules en suspension sont aisément inhalées, pénétrant jusqu’aux
alvéoles pulmonaires : les maladies allergiques induites sont l’asthme,
épisodes successifs ou le rejet de l'air est difficile et pénible, la
rhinite avec éternuements, écoulement nasal, larmoiements, picotements
laryngés, avec souvent surinfection provoquant des sinusites, les
alvéolites allergiques extrinsèques.
Les transporteurs et convoyeurs, les aires de chargement et de déchargement
et les abords des silos sont particulièrement concernés par
l’empoussièrement de l’air et des surfaces de travail ou de circulation.
La maladie des poumons des malteurs, ou « fièvre du malt », est
une réaction allergique à l’orge moisi et aux spores aéroportés : les
symptômes de la maladie du poumon du malteur sont des pneumopathies
d’hypersensibilité, avec comme symptômes de la fièvre, des frissons et un
rhume et, à long terme en cas d’exposition continue, un manque chronique de
souffle.
- Les sucriers
De nombreux pneumallergènes sont retrouvés dans les poussières de résidus
fibreux moisis de canne à sucre, particulièrement les endotoxines des
bactéries et des toxines fongiques dont le rôle majeur dans l’inflammation
de l’arbre respiratoire explique l’apparition de bronchites chroniques, de
rhinites avec souvent surinfection provoquant des sinusites.
La forte inhalation de poussière de bagasse provoque des crises aiguës de
bagassose, avec dyspnée, céphalées et fièvre qui peut évoluer à la longue
en fibrose pulmonaire.
- Les menuisiers, ébénistes, charpentiers, papetiers
Les poussières de bois sont nocives par inhalation pour tous les bois, mais
plus ou moins selon les variétés d'essences de bois (feuillus, conifères,
exotiques) et les produits chimiques éventuellement associés (dont le
formaldéhyde). Ce sont les opérations de sciage du bois mais surtout de
ponçage qui sont dangereuses car elles génèrent une quantité importante de
poussières très fines et peuvent entrainer la maladie des scieurs de bois,
également provoquée par les moisissures de la sciure.
L’exposition aux poussières de bois ou de fibres de papier en suspension
dans l’air, produites par actions mécaniques (défibrage...) de fabrication
du papier, est aussi préoccupante pour la santé des travailleurs des
papeteries.
Les opérations de polissage et le ponçage en particulier du cuir génèrent une quantité importante de poussières de cuir très fines et ces poussières de cuir sont aussi nocives que celles du bois.
- Les métiers de la fourrure
En pelleterie (traitement des peaux de fourrure), les poils de fourrure
animale peuvent générer des poussières provoquant le « poumon des fourreurs » qui est une pneumopathie d’hypersensibilité
ou alvéolite allergique extrinsèque, maladie pulmonaire due à une
inflammation des alvéoles du poumon lors de l’inhalation de poussières
organiques des squames animales.
- Les agents d’assainissement
Les micro-organismes présents dans les boues d’épuration se retrouvent dans
la poussière des boues d'épuration traitées à la chaleur, dans les postes
de nettoyage, curage, pompage des boues de fosses de relevage dans le
traitement des eaux usées pouvant provoquer une alvéolite des boues
d'épuration chez les agents d’assainissement les ayant fréquemment et
massivement inhalées.
- Les ouvriers de l’industrie textile
Les fibres textiles naturelles végétales (coton, lin, ...) ou animales
(laine, soie...) sont caractérisées par leur finesse et leur forme très
allongée par rapport à leur épaisseur : la plupart de ces fibres mesurent
entre 10 et 150 millimètres de long pour une épaisseur de 10 à 50 microns.
En ce qui concerne les risques professionnels, les fibres textiles sont
plus épaisses que les fibres d’amiante, de verre ou de céramique
réfractaire, et elles pénètrent moins profondément dans le poumon et y
séjournent moins : de ce point de vue, elles sont donc moins dangereuses,
mais l’inhalation excessive de poussières textiles avec des allergènes
divers (micro-organismes bactériens et fongiques avec leurs toxines,
acariens, pesticides) est néanmoins la cause de certaines maladies
pulmonaires comme la bronchite chronique, la maladie pulmonaire obstructive
chronique (MPOC ou BPCO), l’asthme et la byssinose, resserrement
transitoire des voies respiratoires s’apparentant à l’asthme et donnant la
«fièvre de filature» ou « fièvre du lundi ». Les
opérations préliminaires, ouverture des balles, cardage ou peignage,
étirage, sont les opérations les plus exposantes aux poussières de fibres
textiles.
-
Les travailleurs des systèmes de conditionnement d'air et
d'humidification et les chauffagistes
L'exposition se fait par l'intermédiaire d'aérosols de gouttelettes
libérées des réservoirs d'eau contaminée par des micro-organismes,
moisissures et/ou bactéries qui colonisent l’eau qui stagne dans les
carters des climatiseurs avant d’être remise en circulation vers un système
d’humidification et pulvérisée dans l’air des locaux. Il peut en résulter
une fièvre des humidificateurs ou climatiseurs qui est une forme du
syndrome toxique des poussières organiques (ODTS), ou une pneumopathie
d'hypersensibilité (poumon des humidificateurs) ainsi que des rhinites
et/ou des asthmes.
- D’autres métiers plus spécialisés sont concernés par les PHS (fièvre des écorceurs d’érable ou de sequoia au CANADA , subérose du liège, fièvre du poumon des sériciculteurs …).
- Les agents métalliques
L’exposition permanente des travailleurs à des métaux ou composés métalliques sous forme de fumées ou de particules, de poussières, est responsable de pathologies respiratoires aigües ou chroniques
L'exposition professionnelle aux métaux est très fréquente dans de nombreux métiers très divers (mines, soudage, fonderies, bijouteries, serrureries, tôleries, chaudronneries, traitements de surface, verreries ...) avec notamment l'augmentation importante de l'utilisation de métaux lourds dans les processus et produits industriels.
Les métaux dans les industries se trouvent sous plusieurs formes physiques, dont les poudres fines micrométriques pour moulage par injection de métaux divers (acier inoxydable, tungstène, ...) avec un liant polymère, et les liquides dans toutes les opérations de fusion (métallurgie, fonderie, bijouterie, soudage ...) à très haute température, et pour le mercure à température ambiante. Des fumées de métaux se dégagent des fours lors de la fusion ou lors de la coulée dans des moules, ou dans les opérations de soudure : ces fumées sont constituées de nombreuses poussières et microparticules métalliques. Les métaux peuvent être toxiques sous toutes ces formes chimiques ou physiques car ils peuvent être inhalés (sous forme de poudre ou de poussière).
Les fumées émises par les alliages métalliques liquides peuvent entrainer des pathologies respiratoires (toux, expectoration, essoufflement), particulièrement pour certains alliages avec des oxydes de métaux dangereux pour la santé : la « fièvre des fondeurs », avec des symptômes de type grippal (fièvre, mal de gorge, douleurs musculaires, transpiration), provient d’une forte inhalation d’oxyde de zinc, mais également de fumées à base de cuivre, magnésium ou manganèse.
La « fièvre des fondeurs » causée par l'inhalation d'oxydes de ces métaux est spontanément réversible sans séquelle.
De même, la pneumopathie des soudeurs, aussi appelée «fièvre des soudeurs » ou « fièvre des métaux» ou « fièvre des zingueurs », résulte de l’inhalation de nanoparticules métalliques responsable d’une inflammation des bronches, au cours des opérations de soudage, de brasage ou de découpage.
Ces « fièvres » , souvent élevées, accompagnent un syndrome pseudo-grippal : asthénie, nausées, céphalées avec frissons, forte sudation, larmoiements et des écoulements nasals, goût métallique dans la bouche.
- Les agents chimiques
L’inhalation de polytétrafluoroéthylène (PTFE) par les travailleurs manipulant du PTFE à des températures élevées peut générer la fièvre professionnelle des fumées de polymères (produits de la pyrolyse de composés fluoro-carbonés). Il s’agit d’une maladie pseudo-grippale avec fièvre, frissons, mal de gorge, faiblesse et dyspnée durant quelques jours.
- Les agents thermiques
L’exposition prolongée à des températures supérieures à 37°C peut provoquer des coups de chaleur : le corps n'arrive plus à réguler la température. L'hyperthermie qui en résulte aboutit à une élévation locale ou générale de la température du corps au-dessus de 38°C et peut dépasser 40°C.
La peau est rouge, sèche et chaude, troubles ou perte de conscience, quelquefois convulsions, hypotension, pouls rapide, pupilles dilatées. Décès possible par défaillance de la thermorégulation.
L'exposition à la chaleur extrême se rencontre dans les métiers s'exerçant à l'extérieur (notamment dans le BTP ou l'agriculture, ...) ou bien dans les métiers s'exerçant à proximité de fours ou d'étuves (métal ou verre en fusion, dans les aciéries, fonderies, verreries etc.).
L'effet des contraintes thermiques chaudes sur la santé des personnes au travail est fonction à la fois de facteurs environnementaux, de facteurs liés à la tâche et à l'organisation du travail, et des facteurs individuels : les travailleurs faisant des efforts physiques, ceux souffrant de maladies cardiaques ou prenant certains médicaments, les travailleurs âgés sont plus particulièrement exposés aux risques thermiques ; par contre les travailleurs acclimatés le sont beaucoup moins.
Les mesures préventives des risques de fièvre professionnelle des
poussières organiques
Les risques professionnels des poussières organiques offre un large champ d’application à la prévention : si la vulnérabilité de l’appareil respiratoire est importante, les diverses mesures de prévention techniques et organisationnelles sont efficaces et permettent de fortement réduire la fréquence et la gravité des affections respiratoires professionnelles provoquées par les poussières organiques.
- la prévention technique collective, qui permet la suppression ou la réduction de l’exposition à des niveaux aussi bas que possible, est primordiale, là ou elle est envisageable : diminuer les émissions de poussières, favoriser leur évacuation et développer l’automatisation des tâches, ce qui permet de limiter le contact avec l’ambiance polluée, choix de produits et de modes opératoires les moins émissifs.
- la prévention technique individuelle, qui consiste à utiliser des appareils de protection respiratoire, ne doit être qu’un complément des mesures de protections collectives ou pour pallier une situation exceptionnelle pour laquelle il n’est pas possible de mettre en œuvre des mesures de protection collective.
- La prévention collective des affections respiratoires dues aux poussières organiques
- Réduction de la formation de poussières.
La concentration minimale doit être atteinte en évitant l’émission et l’accumulation de poussières d’une part, en disposant de systèmes de ventilation et d’aspiration d’autre part.
o Capoter les sources d’émission de poussières (par exemple jetées des élévateurs, mise sous aspiration des transporteurs, aspiration efficace des poussières au poste d’ensachage des farines) et relier ces capotages aux circuits de dépoussiérage. Les sources d’émissions de poussières sont fortement dépendantes de la maîtrise de l’étanchéité des installations.
o Confinement des procédés générateurs de poussière sous pression négative (dépression légère par rapport à la pression d'air à l'extérieur de l'espace confiné).
o Equiper toutes les installations d’un système d’aspiration fermé permettant le captage et la collecte des poussières avec asservissement de la marche des équipements à la marche des ventilateurs de dépoussiérage. La récupération des poussières se fait par un circuit de dépoussiérage largement dimensionné comportant des cyclones permettant la récupération des poussières très fines et des filtres.
o Diminuer des possibilités d'accumulation de poussières en évitant les surfaces planes inaccessibles et les aspérités des parois (surfaces lisses, rebouchage de tous les trous des sols et des murs…). Des installations conçues pour permettre facilement leur nettoyage et éviter toute zone de rétention de poussières est une mesure essentielle.
o Réduire la mise en suspension des poussières dans l’air en limitant les hauteurs de chute de produits pulvérulents lors des transferts, en contrôlant périodiquement les attaches au niveau des manches…
o Réduire la concentration de poussières dans l’environnement passe aussi en procédant au nettoyage fréquent par aspiration mécanique centralisée, si possible, ou par des mesures d’hygiène des locaux tel le nettoyage régulier du sol et des parois de l’atelier et des postes de travail à l’aide d’un aspirateur équipé d’un filtre absolu (pas de balayage qui remet en suspension les particules dans l’air) et humidifier les sols.
o La maintenance rigoureuse des systèmes de climatisation, de traitement d'air et des tours de refroidissement est également un impératif pour éviter les risques de contamination bactérienne et virale des réseaux d'eau et d'air et la transmission de pneumopathies provenant d'inhalation d'aérosols contaminés.
o Travailler à l’humide : mélanger les substances en milieu humide, humidifier si possible le matériau avec de l’eau pour éviter la dispersion des fibres dans l’air.
o Délimiter et isoler les zones d'utilisation à risque : pour limiter au strict minimum le nombre de travailleurs soumis au risque en restreignant l’accès des zones où se déroulent les activités poussiéreuses et limiter la durée de travail de ces personnes dans les zones à risque. En particulier, coordonner l’intervention des différents corps de métiers pour éviter leur présence simultanée sur le site, de façon à limiter le nombre de personnes susceptibles d’être exposées.
o D’autres mesures spécifiques, comme par exemple l’emballage du fromage dans du papier d'aluminium pendant la maturation, sont aussi à considérer.
- Les installations de dépoussiérage sont conçues pour assurer une protection collective comme l’aspiration des poussières des machines des ateliers bois et de transformation du cuir, des minoteries …
Elles reposent sur une extraction de l'air chargée de poussière avec un système de collecte par des ventilateurs, avant son rejet à l'atmosphère.
La ventilation mécanique générale doit assurer un renouvellement d'air en permanence par extraction et soufflage : l'air est transporté dans le local par un ventilateur de soufflage et extrait du local par un ventilateur d'évacuation. L’extraction de l'air se fait grâce à un système de collecte par ces ventilateurs et des gaines de diffusion, réseau de conduits jusqu'aux filtres et aux épurateurs dans l'installation d'air soufflé qui permettent de nettoyer l'air, puis de l’évacuer à l'extérieur par rejet dans l'atmosphère (les aires de chargement et de déchargement, sans système d’aspiration localisé, sont particulièrement concernées par une ventilation forcée efficace).
Les composants aérauliques comme les ventilateurs, les conduits doivent être accessibles et faciles d’entretien et de nettoyage. En particulier, les réseaux s’encrassent rapidement avec de filtres hors d’usage, une évacuation des condensats obstruée… L'entretien régulier du système de ventilation (nettoyage des conduits d'extraction, changement des filtres) est une condition indispensable de bon fonctionnement.
Dans le cas d'une installation fonctionnant avec un rejet permanent de l'air dépoussiéré à l'extérieur, elle est dotée d’un système d'introduction d'air neuf destiné à compenser les volumes d'air extraits par l'installation d'aspiration. La compensation peut être naturelle par des ouvertures existantes ou spécialement aménagées à cet effet dans des zones éloignées des postes de travail (cas généralement des petites installations).Dans les cas de moyennes ou grandes installations, la compensation doit être réalisée par une introduction mécanique au moyen d'un ventilateur raccordé à une gaine de diffusion.
Pour les machines portatives, il convient de généraliser le captage localisé des poussières à la source en utilisant par exemple un outillage muni d’un système d’aspiration intégré et s'organiser pour isoler les matériels et postes de travail qui ne pourraient être raccordés au réseau d'aspiration.
L’extraction par le captage à la source doit être réalisée avec un matériel adapté évitant notamment la formation d’étincelles.
Il est important de choisir des ventilateurs de dimensions et de type appropriés afin d'assurer l'efficacité du système de dépoussiérage. Ils doivent permettre d'obtenir une vitesse de déplacement de l'air suffisante pour capter les poussières, les aspirer et les transporter dans le réseau de conduits jusqu'aux filtres et aux épurateurs qui nettoient l'air, puis l'évacuent à l'extérieur.
Les vitesses de l'air dans les canalisations doivent être choisies pour chaque installation en fonction de la nature et des propriétés des poussières. La vitesse de transport est un facteur essentiel pour les réseaux d'évacuation d’air contenant des poussières : elle doit être supérieure à une valeur minimale de façon à éviter une sédimentation des poussières et un bouchage des canalisations. Elle est d'autant plus grande que les particules sont de masse volumique et de dimensions élevées.
Pour prévenir un risque de pollution de l'atelier et les conséquences d'un incendie ou d'une explosion, il faut placer le dépoussiéreur à l'extérieur ou dans un local adapté.
Le respect de l'équilibrage des réseaux et une maintenance rigoureuse (vérification des filtres avec nettoyage ou changement par exemple) sont indispensables au bon fonctionnement de ces installations.
Pour mesurer l’efficacité des installations de ventilation, la mesure périodique par prélèvements d'atmosphère et analyses des poussières est importante.
- La prévention individuelle des affections respiratoires dues aux poussières organiques
Le port d’équipements de protection des voies respiratoires ne doit être
qu’un complément des mesures de protections collectives ou pour pallier une
situation exceptionnelle ou pour laquelle il n’est pas possible de mettre
en œuvre des mesures de protection collective, notamment pour les travaux
en extérieur.
Il convient alors de porter un appareil de protection respiratoire à
ventilation libre de type FFP3 pour les activités les plus génératrices de
poussières comme le ponçage ou lors de l’affouragement du bétail ou un
masque jetable FFP2 pour les activités occasionnelles moins poussiéreuses.
Le masque filtrant contre les poussières ou les grosses particules (pas de
protection contre les gaz), est en papier ou cartonné, léger, jetable. Le
plus souvent, il s’agit de demi-masques prenant le nez et la bouche. Ils
sont relativement faciles à porter et bien acceptés, mais leur durée
d’efficacité est limitée à quelques heures.
Le demi-masque ou masque complet filtrant à cartouche est à utiliser dans les situations d’empoussièrement massif ou pour les travailleurs prédisposés aux affections respiratoires causées par les poussières organiques : ils possèdent une cartouche qui filtre les aérosols solides, les aérosols solides et liquides, les gaz ou combiné contre les gaz et les aérosols, avec cartouche adaptée au risque et pré-filtre poussières. C’est une pièce faciale qui recouvre le nez, la bouche et le menton et les yeux dans le cas du masque complet et qui est réalisée entièrement ou dans la plus grande partie de sa surface en matériau filtrant. Elle comporte des brides de fixation et dans certains cas une ou plusieurs soupapes expiratoires.
- La surveillance médicale
Pour les travailleurs exposés à la poussière, il faut réaliser des visites médicales régulières :
- Tests respiratoires (spiromètre) à l’embauche pour détecter une déficience des fonctions pulmonaires et tous les 2 ans pour dépister l’apparition des troubles respiratoires.
- Radiographie thoracique si nécessaire, épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR).
La détection au plus tôt des irritations respiratoires et l'intervention du médecin du travail permet l'identification des travailleurs prédisposés aux allergies professionnelles et le retirement de l'exposition afin de prévenir une maladie chronique.
En cas d'une allergie établie et invalidante (asthme et pneumopathie notamment), le changement de poste pour une éviction totale de l'allergène concerné peut être demandé par le médecin du travail, qui, conformément à l'article L241-10-1 du Code du Travail, est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé physique des travailleurs qui ne correspondent plus au travail exigé.
- La formation et l’information du personnel
La formation, par un organisme agréé, sur les dangers des produits et procédés utilisés et sur les moyens de se protéger, est indispensable : informer sur le risque potentiel de maladies pulmonaires et sur les moyens de les prévenir, savoir utiliser les masques adéquats, …
Les mesures préventives des risques des fièvre professionnelle des fumées métalliques
Les ateliers utilisant des composés métalliques en fusion, poudres, solutions … doivent faire l’objet d’une analyse poussée des risques pour permettre la rédaction du Document Unique de Sécurité (Décret du 5 novembre 2001) en appréciant à la fois l’environnement matériel et technique (outils, machines, produits utilisés) et l’efficacité des moyens de protection existants et de leur utilisation selon les postes de travail.
Les analyses de risques sont confiées à des spécialistes de la sécurité au travail (hygiéniste, ingénieur sécurité). Les rapports d’intervention et de maintenance seront aussi intégrés à la documentation de sécurité au travail de l’entreprise et communiquées au médecin du travail et au CSSCT.
Les salariés doivent être aussi informés à propos des produits dangereux mis en œuvre et formés aux pratiques professionnelles sécuritaires.
La prévention la plus efficace est la prévention primaire avec la mise en place de technologies qui permettent des actions sur les produits (suppression ou emploi de produits de substitution de moindre impact potentiel sur l'homme) et/ou des actions sur les procédés (emploi de matériels ou de machines supprimant ou limitant au maximum les impacts, par de très faibles rejets atmosphériques …).
La prévention collective implique l’utilisation de systèmes de fabrication isolés et automatisés et de dispositifs mécaniques comme l’extraction de poussières et de fumées métalliques, un captage à la source, une ventilation générale des locaux efficace, qui permettent de réduire l’exposition des travailleurs par des mesures techniques visant à limiter l’inhalation de ces émanations, en particulier lorsque l’on ne peut pas remplacer des produits chimiques dangereux par d’autres pour des raisons techniques.
Enfin, le port d’équipement de protection individuel (combinaison, gants, lunettes de protection, masques respiratoires filtrants …) est obligatoire pour réduire le risque d’exposition non totalement éliminé par les mesures de protection collectives, ainsi que la présence d’installations et de matériel de premier secours et des mesures individuelles d’hygiène empêchant l'ingestion de particules.
La surveillance médicale renforcée annuelle est obligatoire des travailleurs exposés aux métaux lourds pour contrôler régulièrement leur santé.
De manière aussi à ce que les salariés puissent être informés à propos des composés métalliques utilisés, les Fiches de Données de Sécurité (F.D.S.) doivent être mises à disposition et la connaissance de leurs risques expliquée au travers de la compréhension de l’étiquetage de leur emballage. Ce document renseigne sur la composition, les propriétés et surtout le mode d'utilisation. On y trouve également des données concernant les premiers soins, la toxicité et les précautions de manipulation.
- L’identification, la suppression / substitution des produits les plus toxiques
La première étape consiste à repérer en particulier les agents chimiques cancérogènes ou dangereux dans le cadre de l'évaluation des risques du Document Unique de Sécurité (DUS). Les Fiches de Données de Sécurité (FDS), obligatoires pour tout produit chimique dangereux, comportent les renseignements relatifs à la toxicité des produits, donc notamment leur caractère cancérogène éventuel.
A défaut de produit de remplacement, il convient d’utiliser les produits les moins volatils et privilégier les formes en poudre compacte, en granulés, en pâte au lieu de poudre.
Pour les opérations de soudage, on peut mettre en œuvre des procédés de soudage, de coupage ou de brasage moins émissifs.
- Une ventilation des lieux de travail adéquate
La ventilation et l’aération des lieux de travail jouent un rôle essentiel pour limiter la concentration de l'ensemble des poussières et fumées métalliques dans l'air ambiant et les évacuer des lieux de travail, de façon à respecter les valeurs limites fixées par les réglementations et éviter ainsi les conséquences sur la santé des travailleurs. On procède par ventilation générale des ateliers et par aspiration continue à la source aux postes de travail.
- La ventilation générale opère par dilution des polluants à l’aide d’un apport d’air neuf dans le local de travail de manière à diminuer les concentrations des substances toxiques pour les amener à des valeurs aussi faibles que possible et inférieures à la VME (valeur moyenne d'exposition).
La ventilation mécanique générale, extracteur d’air pour l’aspiration des fumées et poussières métalliques, doit assurer un renouvellement d'air en permanence afin de limiter les risques pour la santé, en évitant l’accumulation de substances nocives et explosives, par extraction et soufflage : l'air est transporté dans le local par un ventilateur de soufflage et extrait du local par un ventilateur d'évacuation. L’extraction de l'air se fait grâce à un système de collecte par ces ventilateurs et des gaines de diffusion, réseau de conduits jusqu'aux filtres et aux épurateurs dans l'installation d'air soufflé qui permettent de nettoyer l'air, puis de l’évacuer à l'extérieur par rejet dans l'atmosphère.
Les composants aérauliques comme les ventilateurs, les conduits doivent être accessibles et faciles d’entretien et de nettoyage. En particulier, les réseaux s’encrassent rapidement avec de filtres hors d’usage, une évacuation des condensats obstruée… L'entretien régulier du système de ventilation (nettoyage des conduits d'extraction, changement des filtres) est une condition indispensable de bon fonctionnement.
- Ces dispositifs doivent être complétés par une aspiration avec extraction localisée des fumées et particules métalliques, … ou sur les équipements avec filtres, épurateurs ou autres collecteurs de poussières : par exemple, torches, gabarits, tables, hottes … aspirantes, cabines avec extraction par le haut ou par l’arrière. Les dispositifs de captage à la source consistent à capter les polluants au plus près possible de leur point d’émission, avant qu’ils ne pénètrent dans la zone des voies respiratoires des travailleurs et ne soient dispersés dans toute l’atmosphère du local. Les polluants ne sont pas dilués mais évacués.
- Il est important de choisir des ventilateurs de dimensions et de type appropriés afin d'assurer l'efficacité du système de ventilation. Les vitesses de l'air dans les canalisations doivent être choisies pour chaque équipement, car la vitesse de transport est un facteur essentiel pour les réseaux d'évacuation d’air contenant des poussières : elle doit être supérieure à une valeur minimale de façon à éviter une sédimentation des poussières et un bouchage des canalisations.
La ventilation générale des ateliers doit être déterminée en fonction des aspirations locales pour ne pas perturber l’efficacité des captages à la source. Le respect de l'équilibrage des réseaux est indispensable au bon fonctionnement de ces installations.
Pour mesurer l’efficacité des installations de ventilation, la mesure périodique des agents chimiques par prélèvements d'atmosphère et analyses des fumées et poussières est importante.
La valeur limite correspond à sa concentration dans l’atmosphère dans laquelle une personne peut travailler pendant un temps donné sans risque d’altération pour sa santé.
La Valeur Limite d’Exposition (VLE) est la concentration maximum à laquelle un travailleur peut être exposée au plus pendant 15 mn sans altérations physiologiques : ce critère a pour but d’éviter les effets immédiats sur l’organisme.
La Valeur Limite Moyenne d’exposition (VME) est la limite d’exposition d’un travailleur pour une exposition régulière de 8h par jour et de 40h par semaine : ce critère a pour objectif d’éviter les effets à long terme sur l’organisme.
La norme EN 481 concerne l’échantillonnage de poussières ou d’aérosols sur les lieux de travail et donne les caractéristiques des instruments à utiliser pour déterminer les concentrations.
Les mesures et analyses peuvent être faites par l’employeur ou par un laboratoire extérieur et le respect des valeurs limites doit être vérifié au moins annuellement.
Si la valeur limite d’exposition est dépassée, cela permet d’imposer un arrêt temporaire d'activité pour remédier à la situation, puis il faut réaliser un nouveau contrôle sans délai.
Ces rapports d’analyses métrologiques, d’intervention et de maintenance seront intégrés à la documentation de sécurité au travail de l’entreprise (Document Unique de Sécurité).
- L’utilisation de procédés adaptés
L'isolement des procédés et la réalisation les opérations en enceinte fermée (vase clos), et l'utilisation de procédés par voie humide (broyage, …) permettent de mettre les travailleurs à l'abri des fumées et poussières métalliques.
Le process des grandes fonderies, verreries, métalleries, chaudronneries, tôleries … industrielles est mécanisé et automatisé, ce qui réduit considérablement les risques : les travailleurs sont isolés dans des salles de contrôle ou des cabines pressurisées, climatisées et insonorisées. Toutefois, des incidents dans l’automatisation des opérations, des fuites, nécessitent des interventions de maintenance qui restent dangereuses. Par ailleurs, dans l’artisanat, les petites séries, les pratiques sécuritaires sont beaucoup moins mises en œuvre et maîtrisées.
- Les mesures organisationnelles de prévention
Les moyens de prévention à mettre en œuvre pour pallier les risques professionnels des composés métalliques résident aussi dans les mesures organisationnelles visant à diminuer fortement le nombre de personnes exposées et la durée et l’intensité d’exposition.
Ces mesures concernent les zones de travail, leur accès et leur balisage, les modes opératoires limitant l'importance des manipulations et les efforts physiques qui augmentent la ventilation pulmonaire donc l’inhalation des poussières et de fumés métalliques, par exemple en approvisionnant les produits en quantité strictement nécessaire (pré-pesage des produits).
Il convient de limiter au strict minimum le nombre de travailleurs soumis au risque en restreignant l’accès des zones où se déroulent les activités et limiter la durée de travail de ces personnes dans les zones à risque : par exemple, limiter l'accès aux zones d’émission de fumées de coupage, de soudage ou de brasage.
- Des mesures d’hygiène
- Un nettoyage régulier permet de réduire les niveaux de poussières métalliques. Il convient de réaliser un nettoyage des lieux de travail avec les outils appropriés, avec des précautions pour éviter la dispersion des poussières lors du vidage des aspirateurs ou des conteneurs à déchets, du changement des filtres des dépoussiéreurs.
Les zones de travail doivent être nettoyées avec un chiffon humide ou un aspirateur à filtre absolu, jamais avec une soufflette ou un balai à sec, ni avec de l’air comprimé pour éliminer les poussières adhérentes. Ces mesures d'hygiène concernent les sols et les plans de travail, mais aussi les murs et les plafonds.
- Des installations sanitaires (WC, lavabos, douches) doivent être mises à disposition des travailleurs, correctement équipées et en nombre suffisant, permettant aux travailleurs de se nettoyer fréquemment les mains et le visage à l'eau et au savon et de se laver en fin de poste pour limiter l’incrustation des particules dans la peau. En cas de forte contamination, les installations sanitaires doivent elles-mêmes faire l'objet d'un nettoyage méticuleux.
- Des douches oculaires portatives conçues pour fournir immédiatement le liquide de rinçage et des fontaines rince yeux/visage fixes doivent être disponibles.
- Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs : l’entreposage des tenues de travail doit avoir lieu à l’abri de la poussière (le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé).
- La gestion et le nettoyage des vêtements de travail et autres équipements individuels de protection fournis aux travailleurs doivent être pris en charge par l’employeur.
- le respect des règles d’hygiène s’étend aux comportements individuels : ne pas manger sur le lieu de travail afin de ne pas ingérer par inadvertance un produit toxique.
- Les équipements de protection individuelle contre l’exposition aux poussières et fumées métalliques
Le port d'équipement de protection individuelle (gants, tenue de travail...) est toujours indispensable car toutes les mesures de prévention collective ne permettent pas de supprimer totalement l'exposition. Quant à la protection respiratoire, le port d’un appareil respiratoire toujours gênant ne s’envisage que s’il persiste un risque d’exposition par inhalation, malgré la mise en place de la prévention collective ou bien dans les cas ou la protection individuelle est la seule possible, comme dans certaines opérations d’entretien, de maintenance ou d’intervention d’urgence, mais l'usage de masques respiratoires ne peut s'envisager que pour des manipulations ponctuelles de courte durée.
- des masques anti-poussières fines de type FFP2, en papier ou cartonnés, légers, jetables, filtrant les particules mais de durée d’efficacité limitée à quelques heures peuvent convenir pour des expositions faibles (ce qui est le cas le plus souvent si les mesures techniques sont mises en œuvre).
- des demi-masques, avec cartouche filtrante, de type FFP3, prenant le nez et la bouche, peuvent être utilisés pour se protéger des fumées et des poussières en concentration plus importante.
- enfin, un masque à adduction d’air est recommandé pour des tâches particulièrement exposées, dans des conditions de travail exceptionnellement difficiles.
- La surveillance médicale des travailleurs exposés aux poussières et fumées métalliques
L’exposition aux métaux lourds impose une surveillance périodique des travailleurs au moins une fois par an, instaurée par le médecin du travail.
Pour les travailleurs exposés aux poussières de métaux lourds, il faut réaliser des visites médicales régulières dans le cadre d’une surveillance médicale renforcée : la périodicité du contrôle des expositions est alors fonction des niveaux mesurés.
- Tests respiratoires (spiromètre) à l’embauche pour détecter une déficience des fonctions pulmonaires et tous les 2 ans pour dépister l’apparition des troubles respiratoires.
- Radiographie thoracique si nécessaire, épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR) conseillées : le salarié doit être soustrait au risque dès l’apparition de signes irritatifs.
- Le dossier médical doit stipuler la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats des examens médicaux. Ces informations sont indiquées dans l'attestation d'exposition et le dossier médical doit être conservé 40 ans après la cessation de l'exposition.
Les mesures préventives des risques de fièvre professionnelle par la vaccination
L'essentiel de la prévention consiste à éviter la pénétration des agents infectieux dans l'organisme humain et leur dispersion sur le lieu de travail et dans l'environnement en respectant des gestes et les règles de confinement adaptés et en inactivant les déchets.
La démarche de prévention consiste à évaluer les risques (identification du "réservoir" de l'agent infectieux et de ses modes de transmission), à placer des barrières entre le réservoir et l'homme, et à pratiquer des vaccinations.
Sans se substituer à la mise en place d'une protection collective et individuelle efficace, un vaccin, quand il existe, vise à renforcer les défenses d'un individu contre un ou plusieurs agents biologiques pathogènes présents sur le lieu de travail.
On impose une obligation vaccinale en fonction des risques que font encourir certaines activités. De même, certains vaccins sont recommandés en fonction du secteur professionnel (par exemple, la vaccination contre la leptospirose pour les égoutiers ou l'hépatite A pour le personnel des crèches).
Un suivi médical annuel est obligatoire pour tout personnel en contact avec des agents biologiques. Un suivi particulier pour les femmes enceintes est nécessaire pour tenir compte de leur immunodéficience temporaire. Avec le respect des règles d'hygiène, la vaccination est un des moyens de prévention le plus efficace contre les risques infectieux. La vaccination consiste à injecter un antigène qui sera reconnu par le système immunitaire qui produira des anticorps capables de renforcer les défenses de l'organisme contre l'agent biologique pathogène concerné présent sur le lieu de travail, sans contracter la maladie.
Certains métiers exposent à un risque élevé d'infections (personnel médical et de secours …) qui impose des mesures de protections particulières : des textes réglementaires soumettent ces professions à une obligation vaccinale de nature contractuelle.
D'autres professions font l'objet de recommandations pour certaines situations de travail (personnel des services sociaux, des crèches, des abattoirs …). Le médecin de santé au travail conseille alors la personne exposée, compte tenu de sa connaissance du milieu de travail et est juge de la nécessité de réaliser une vaccination, en fonction des risques auxquels sont exposés les salariés et d'une contre-indication éventuelle à une ou plusieurs vaccinations.
La vaccination est certes un moyen de protection individuelle efficace contre plusieurs risques biologiques mais ne se substitue pas à la prévention technique collective (méthodes de désinfection et de décontamination, d'élimination des déchets, lavage des mains..), ni ne dispense du port des équipements de protection individuelle nécessaires (gants, masques, blouses…).
La prévention du risque biologique est par principe primaire, il faut éviter le contact entre les agents biologiques et l'homme par des mesures d'hygiène élémentaires et des protections individuelles.
La prévention individuelle contre les aérosols contaminés repose sur le port d'équipements de protection individuelle (EPI) respiratoire (masques), adaptés au poste de travail.
Le port de masques de protection respiratoire est nécessaire pour toute manipulation présentant des risques d'exposition par inhalation d'aérosols provenant d'échantillons potentiellement contaminés par des agents biologiques entraînant des pathologies respiratoires. L'usage des masques ne peut s'envisager que pour des manipulations ponctuelles de courte durée.
Les mesures préventives des risques de fièvre professionnelle des ambiances de travail chaudes
Pour les travaux à l'extérieur, débuter la journée de travail plus tôt et reporter les lourdes tâches aux heures plus tempérées de la matinée, aménager des zones de travail et de repos à l'ombre avec mise à disposition d'eau fraîche, inciter les travailleurs à se couvrir la tête, à ne pas travailler torse nu et à porter des vêtements amples et légers, de couleur claire, permettant l'évaporation de la sueur (le coton est à privilégier, le nylon est à éviter), sans toutefois négliger le port des équipements de protection individuelle si nécessaire, sont des mesures évidentes.
Le travailleur doit boire régulièrement de l’eau : sur les chantiers du BTP, les employeurs sont tenus de mettre à la disposition des travailleurs d’au moins par 3 litres d'eau, par jour et par travailleur (article R. 4534-143 du Code du travail) et prévoir des zones d'ombre ou des abris pour l'extérieur et/ou des aires climatisées pour les pauses.
Pour aller plus loin :
- OFFICIEL PREVENTION : ORGANISATION ERGONOMIE > RISQUE BIOLOGIQUE :
- OFFICIEL PREVENTION : ORGANISATION ERGONOMIE > RISQUE CHIMIQUE :
- OFFICIEL PREVENTION : SANTÉ HYGIÈNE SST > CHAUFFAGE, CLIMATISATION & ISOLATION THERMIQUE :
- OFFICIEL PREVENTION : SANTÉ HYGIÈNE SST > SERVICE DE SANTÉ AU TRAVAIL, RÉGLEMENTATIONS :
MARS 2023
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.