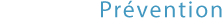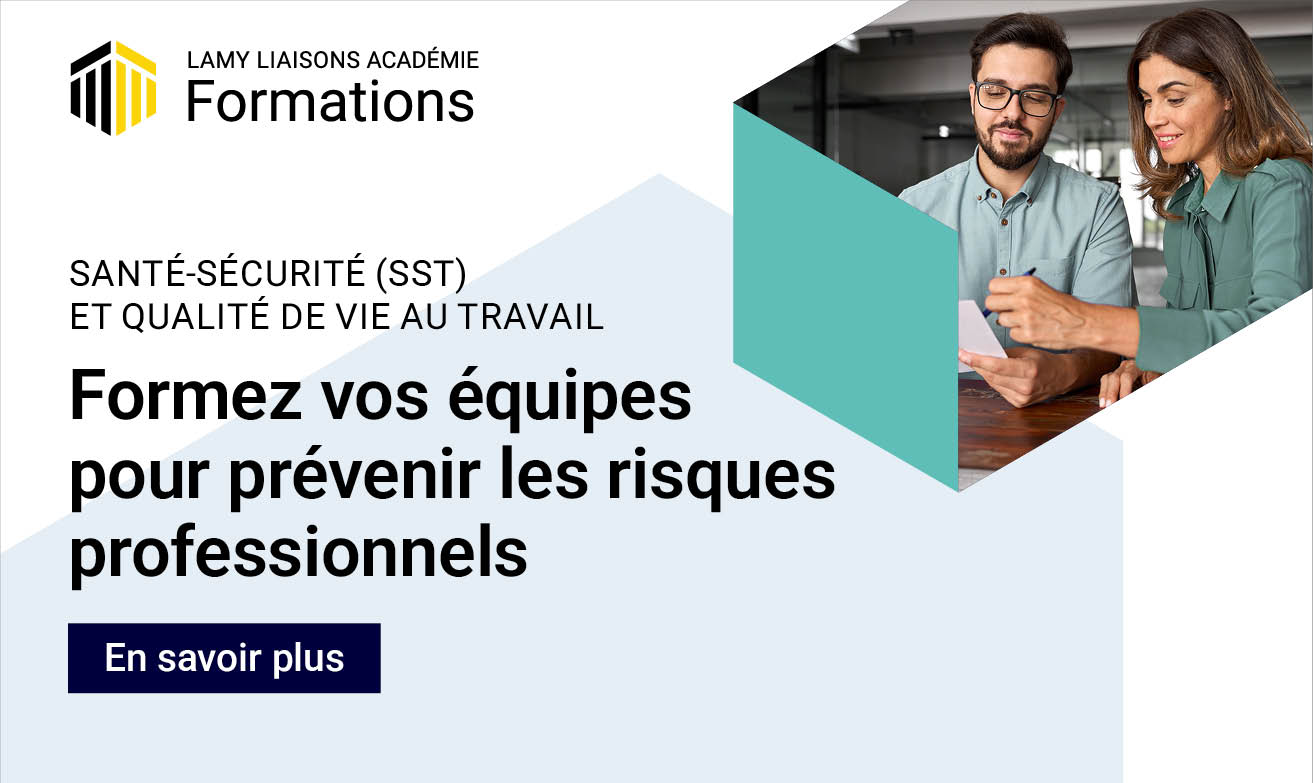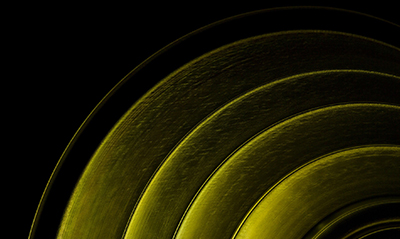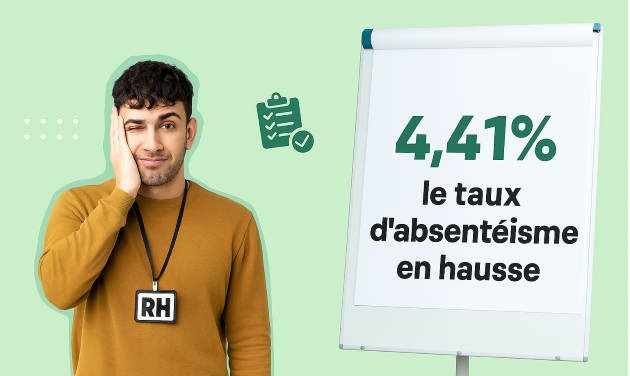De nombreux agriculteurs utilisent des engrais (minéraux ou organiques, solides ou liquides …) de façon fréquente, intensive et prolongée. L'utilisation des engrais, présente des risques pour l'environnement (sol, eau, air) mais aussi chimiques et/ou biologiques pour la santé des agriculteurs exposés. Outre leur toxicité environnementale et sanitaire, certains engrais sont explosifs dans des conditions particulières. En cas d'incendie, certains engrais sont susceptibles de libérer des gaz toxiques.
De nombreux agriculteurs utilisent des engrais (minéraux ou organiques, solides ou liquides …) de façon fréquente, intensive et prolongée.
L'utilisation massive des engrais, produits fertilisants des récoltes, par épandage ou pulvérisation, présente des risques pour l'environnement (sol, eau, air) mais aussi chimiques et/ou biologiques pour la santé des agriculteurs exposés. Par ailleurs, l'utilisation d'engins et machines agricoles de traction et d'épandage est dangereuse : chutes et renversements des tracteurs, coincements, écrasements, happements par les accessoires des machines en rotation … Outre leur toxicité environnementale et sanitaire, certains engrais solides à base de nitrate d'ammonium sont explosifs dans des conditions particulières. En cas d'incendie de leur lieu de stockage, certains engrais sont susceptibles de se décomposer et de libérer des gaz toxiques.
Comme pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques et/ou biologiques, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs, limiter l'usage des engrais au strict nécessaire, adopter de bonnes pratiques et d'hygiène au travail, former ses salariés et mettre à leur disposition les équipements de protection individuelle adéquats (combinaison, gants, bottes, masque) pour éviter tout contact et inhalation de poussières ou émanations gazeuses d'engrais.
En outre, des pratiques gestuelles appropriées, une organisation rationnelle des travaux agricoles, le choix d'engins adaptés au travail à réaliser et bien entretenus, des techniques éprouvées suite à une bonne formation, sont des mesures de prévention qui permettent de réduire l'accidentologie du machinisme agricole.
Composition et présentation des engrais
Les engrais se répartissent en plusieurs grandes familles de composition et d'utilisation différentes pour fertiliser les cultures : On distingue deux types de provenance et de composition d'engrais agricole :
- engrais minéral : provenant soit de l'industrie chimique soit de gisements naturels, permettant d'apporter les éléments nécessaires aux végétaux (l'azote, le phosphore et le potassium et d'autres éléments comme le calcium, le magnésium et le soufre).
- engrais organique : provenant des animaux ou végétaux, produits à partir des déjections (fumier, purin, lisier, fientes), boues issues de stations d'épuration, digestats de méthanisation ou sous produits industriels de récupération fermentescibles. Le matériel d'épandage sur les champs et prairies agricoles dépend de la forme de l'engrais :
- Les engrais se présentant sous forme solide sont généralement répandus par des épandeurs centrifuges attelés à un tracteur qui projettent les engrais et les amendements granulés en nappe.
- Le matériel de pulvérisation à rampe est utilisé pour les engrais liquides ou bien les solutions nutritives sont injectées dans un réseau d'irrigation, rampe à pendillard ou à sabots trainés pour les lisiers, injecteurs pour les lisiers et les digestats de méthanisation …
Les principaux risques chimiques et biologiques des engrais
Si les risques des substances chimiques des pesticides sont très importants pour la santé des agriculteurs, les engrais présentent eux aussi des dangers quoique bien moindres, mais qu'il ne faut pas négliger pour autant : toutefois, les effets toxiques, après exposition professionnelle aux engrais, sont assez restreints compte tenu des millions de tonnes manipulées chaque année. Les poussières d'engrais dans les locaux de stockage ne font pas l'objet de VLEP (Valeur Limite d'Exposition Professionnelle) spécifique : elles ne sont pas en mesure de provoquer sur les poumons d'autre effet que celui de surcharge.
Les engrais pénètrent dans le corps humain par trois voies :
- orale (bouche, œsophage, appareil digestif),
La pénétration par cette voie se fait soit par ingestion accidentelle d'un produit ou par déglutition de produit, soit par contact direct, en portant des mains ou des objets souillés à la bouche.
- respiratoire (nez, trachée, poumons)
Ce type de pénétration se fait par inhalation de poussières, gaz, particules fines émises à la préparation et lors de l'épandage ou la pulvérisation du produit. Ce risque est ainsi fortement présent lors des différentes phases de traitement. Les poumons ont une grande capacité de contact, de rétention et d'absorption des produits toxiques.
- cutanée (y compris les yeux et les muqueuses). Les divers produits fertilisants peuvent causer des lésions sur la peau à l'endroit du contact (rougeurs, irritations, …) par effet irritant. La chaleur et la transpiration accélèrent très souvent ce phénomène. Des surinfections suite à une blessure, piqure, coupure sont possibles.
- Les risques chimiques des engrais minéraux
Le principal danger des engrais minéraux chimiques inorganiques vient des composantes azotées, qui sont présentes dans la plupart des engrais. Les composants azotés sont les nitrates NO3, l'ammonium NH4 (généralement sous la forme de nitrate d'ammonium NH4NO3) et l'urée.
Les nitrates ingérés par déglutition de particules sont dégradés par les bactéries buccales et se transforment en nitrites (NO2). L'ingestion accidentelle de faibles quantités de nitrate d'ammonium peut entraîner des nausées, vomissements, diarrhées, hypertension ou hypotension et, parfois, tachycardie. En dose massive très peu probable en usage professionnel accidentel, ces nitrites peuvent empoisonner le sang en oxydant l'hémoglobine, ce qui engendre des troubles respiratoires (méthémoglobinémie). Les particules très fines de nitrate d'ammonium (ou de poudres de carbonate de calcium pulvérisé) pénètrent dans les poumons : lors de l'épandage en milieu agricole ou de la remise en suspension depuis les lieux de dépôt ou lors de certaines manutentions, l'inhalation de poussières peut être responsable d'une irritation oculaire, rhino-pharyngée et trachéale, irritation des muqueuses et des voies respiratoires, une toux accompagnée de difficultés respiratoires. La projection de poussières de nitrate d'ammonium dans les yeux peut causer larmoiement, douleurs, troubles de la vision, irritations et atteinte de la cornée.
Les engrais azotés sont à l'origine de décompositions avec émanations de composés gazeux d'azote, à partir du sol ou de la matière fertilisante azotée, par dégagement direct dans l'atmosphère d'ammoniac ou d'oxyde d'azote. L'ammoniac (NH3) est produit par les engrais azotés qui exhalent ce gaz qui se volatilise par dégagement direct dans l'atmosphère, ou du fait de l'hydrolyse en ammoniac par l'enzyme uréase présente dans le sol : l'ammoniac est toxique pour ceux qui épandent l'engrais, notamment par temps chaud, sec et sans vent ; l'inhalation provoque l'irritation du nez, de la gorge et des poumons. En plus, l'ammoniac libéré par volatilisation au moment de l'épandage d'engrais se combine avec d'autres polluants présents dans l'atmosphère, formant des particules secondaires très fines en suspension (matières particulaires PM 10 à PM 2.5, c'est-à-dire « Particulate Matter » de taille inférieure à 10 ou à 2.5 microns) qui peuvent stagner dans l'air environnant pendant plusieurs jours et qui atteignent les bronches et les alvéoles pulmonaires, à l'origine à la longue de l'inflammation des tissus pulmonaires et de maladies respiratoires chroniques.
L'inhalation des gaz libérés par la décomposition thermique du nitrate d'ammonium (oxydes d'azote très toxiques) en milieu confiné provoque une irritation aiguë des voies respiratoires. Les nitrates sont peu irritants pour la peau (éventuellement dermite prurigineuse des mains et des poignets) et les muqueuses ; ils ne sont pas sensibilisants et non hydrophobes, présentent très peu de pénétrations cutanées en milieu professionnel. La cyanamide calcique (CaCN2) doit être utilisée avec précaution : nocive en cas d'ingestion, elle irrite aussi la peau, les muqueuses et les voies respiratoires et peut provoquer des risques de lésions oculaires. - Les risques biologiques des engrais organiques
Les sources potentielles de danger par inhalation lors d'épandage d'engrais organiques sont les émissions toxiques diffuses de vapeurs, poussières, la présence de composés traces organiques (CTO), d'éléments traces métalliques (ETM), de bioaérosol, l'envol de micro-organismes, …
Les engrais organiques issus de déjections animales, boues de station d'épuration … présentent des dangers biologiques (bactéries, virus et parasites) dont les possibilités de contamination sont faibles, du fait du traitement d'hygiénisation (consistant à détruire les micro-organismes pathogènes) auxquels ils ont été soumis.
Des infections digestives par les salmonelles, les listeria, les escherichia coli, les clostridies, d'autres entérobactéries ou encore par des œufs d'helminthes ou cysticercose (ténia), sont néanmoins possibles suite à l'ingestion accidentelle de particules d'engrais organiques. De même que des infections cutanées secondaires à des blessures septiques ou coupures souillées par de la terre contaminée qui peuvent se surinfecter à cause des germes pathogènes contenus dans les fertilisants organiques (panaris des doigts, furoncles, …). Les troubles de contact respiratoire sont aussi assez fréquents avec les fertilisants organiques, responsable de rhinites, d'asthmes professionnels, de maux de tête et de nausées.
Les engrais organiques et les composts commerciaux issus de produits alimentaires (notamment des déchets de crustacés et de poissons) sont des sources possibles d'allergènes alimentaires et présentent éventuellement des risques de sensibilisation lors de leur manipulation pour les travailleurs prédisposés.
Les risques d'explosion et d'incendie des engrais
Les risques d'accidents majeurs associés aux engrais sont liés à l'explosion d'engrais à forte teneur en nitrate d'ammonium, mais les ammonitrates présents sur le marché, c'est-à-dire conformes à la réglementation et exempts de contamination par des combustibles ou par des produits incompatibles (chlore, acides, certains métaux...), sont très difficiles à faire détoner. Les enceintes de confinement empêchant l'évacuation des gaz émis peuvent éclater violemment lorsque le nitrate d'ammonium ou les ammonitrates qu'elles contiennent sont soumis à des facteurs de déclanchement avec fort apport d'énergie (flamme, incendie, projectile explosif …).
En cas d'incendie, les engrais azotés sont susceptibles de se décomposer et de libérer des gaz toxiques, qui peuvent être de l'ammoniac, des oxydes d'azote, du monoxyde et du dioxyde de carbone. En fonction de leur composition, certains engrais composés azotés à base de nitrate d'ammonium peuvent être soumis, en cas d'élévation de la température (>130 °C), à une décomposition thermique spécifique, susceptible d'être auto-entretenue, le phénomène de décomposition perdurant longtemps alors que la source de chaleur est éliminée : ces engrais, soumis à cet échauffement lent sans manifestation apparente au début, sont susceptibles d'une décomposition générant des gaz toxiques (dioxyde d'azote, acide chlorhydrique, chlore…) avec la production en quantité importante de fumées toxiques denses et lourdes avec l'absence de flamme.
La poussière d'engrais minéral est incombustible et ne présente pas de risque d'explosion comme cela peut être le cas pour d'autres types de poussières.
Les risques liés à l'utilisation de machines épandeuses d'engrais
Les travaux agricoles de fertilisation comportent une combinaison de risques naturels et de risques liés à l'emploi de machines d'épandage. Les risques naturels sont liés au caractère accidenté des terrains et à leur déclivité éventuelle, aux difficultés d'accès, à la visibilité réduite et à la difficulté des conditions climatiques (vent, humidité, brouillard, chaleur ou froid). Les facteurs de risque professionnel sont souvent relatifs à des conditions dans lesquelles une énergie non contrôlée est libérée, gravitationnelle (chutes, renversements..), cinétique (heurts, happements…).
La durée d'exposition à la condition dangereuse, influence considérablement l'incidence des facteurs de risque. Les risques professionnels liés à l'épandage d'engrais, hors les risques chimiques dus aux produits fertilisants, ou aux lubrifiants et carburants, peuvent être classés selon qu'ils sont :
- mécaniques : heurts et happements (des doigts ou bras, de la chevelure ou des vêtements) par les parties mobiles en mouvement des machines (éléments mobiles de transmission d'énergie ou des équipements de travail, fond de la trémie d'épandage, vis sans-fin …), écrasement par des chutes de charges ou le renversement des engins dans les déclivités ou profondes ornières, coupures et perforations par les outils de travail, projections de particules solides (de bois, de roche, de débris végétaux dans les yeux), chute lors de la descente de l'engin.
- physiques : vibrations produites par les engins dans le poste de conduite, niveau sonore trop élevé, courant électrique, … Les interventions en cas de bourrage, les opérations d'attelage et de dételage, du décrochage de l'épandeur d'engrais, les travaux concernant les liaisons tracteurs-outils autour de l'arbre de transmission à cardans (avec des pièces mobiles à vitesse de rotation élevée), figurent parmi les situations les plus dangereuses. Le taux d'accidents mortels causé par l'éjection du conducteur de son siège ou consécutif au retournement du tracteur et à l'écrasement ou coincement du conducteur, est important dans le secteur agricole : soit des renversements sur le côté durant les opérations sur pente raide, au bord d'un fossé, soit des renversements vers l'arrière (cabrage) consécutif à une élévation de l'avant de l'engin. Les chutes à la descente de la cabine du tracteur sont fréquentes du fait de l'engourdissement des membres inférieurs et/ou de la glissance du marchepied ou de la chaussée boueuse. De plus, le retard dans l'alerte et l'éloignement des centres de secours, du fait du caractère isolé des travaux agricoles, est un facteur majorant de gravité. Enfin, la faible vitesse relative des engins agricoles par rapport aux autres véhicules sur la route, leur gabarit important sont sources de risques d'accident routier. Les vibrations au volant des engins agricoles, les forces compressives et de cisaillement répétées principalement aux jonctions dorsolombaires et lombo-sacrées présentent des risques chez les conducteurs d'engins qui restent assis pendant longtemps sur leur siège au poste de conduite : il en résulte des troubles vertébraux provoquant des lombalgies, cruralgies, cervicalgies, sciatiques par hernie discale …
Les mesures de prévention des risques professionnels des utilisateurs d'engrais
Comme pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle. L'évaluation des risques inclut toutes les activités de l'entreprise, y compris l'entretien et la maintenance.
Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le Document Unique de Sécurité (D.U.S). L'étiquetage du produit et la fiche de données de sécurité sont obligatoires et permettent de repérer les principaux risques. En fonction des risques mentionnés sur l'étiquette, le port de certains types de protection peut s'avérer obligatoire. Il est essentiel de lire l'ensemble des indications reprises sur l'étiquette.
En supplément de l'étiquetage, tout employeur doit obtenir de son fournisseur une Fiche de Données de Sécurité (F.D.S) plus complète pour mieux mesurer les risques.
- La prévention des risques chimiques des engrais
L'adoption de bonnes pratiques d'usage des produits fertilisants est indispensable :
- Des réductions dans l'usage des engrais sont possibles en résorbant les inefficacités des exploitations : il convient de limiter l'usage des fertilisants au strict nécessaire et d'optimiser les doses et nombres de traitement en fonction des critères météo, état sanitaire, stade de développement de la culture… pour limiter à la fois les risques professionnels et environnementaux.
- La limitation de l'émission de poussières ou particules primaires et pour réduire la volatilisation : usage d'engrais tamisés, dépoussiérés et éventuellement traités avec un anti-poussière ; transport en benne bâchée ou en camion-citerne ; circuit fermé pour transférer le produit de la citerne à l'épandeur ; rampe d'épandage équipée de tapis caoutchoutés pour plaquer le produit au sol et privilégier l'utilisation de rampes munies d'injecteurs ou de sabots ; jupes en toile pour les épandeurs à disque ;
- Les mesures techniques de stockage indispensables sont les suivantes :
1. Aménagement du local technique et de l'aire de préparation et de nettoyage des équipements de travail : ventilation efficace, séparation des produits en fonction des FDS …
2. Bon réglage et entretien (buses bouchées…) des pulvérisateurs.
3. Toujours bien refermer les bidons et autres conteneurs de produits chimiques et essuyer les liquides ou ramasser les granulés immédiatement après tout déversement.
4. Stocker des engrais présente des risques de chute ou de renversement d'emballage avec fuites ou déversements des produits. Toutes ces caractéristiques rendent nécessaire, outre les précautions lors de leur emploi, l'utilisation de contenants et l'aménagement de locaux spécifiques de stockage, armoires avec étagères de rétention, matériels de stockage avec bacs rétention pour prévenir et maîtriser les fuites accidentelles de liquides.
- Les équipements de protection individuelle (lunettes de sécurité, gants de protection chimique certifiés EN ISO 374, bottes de sécurité, combinaison et éventuellement un masque anti-poussières FFP2 en cas de fort empoussièrement) doivent être portés dès le début du travail.
- Une hygiène rigoureuse, en application ou à la fin, est indispensable : éviter de porter les mains à son visage, se laver les mains après chaque intervention, prendre une douche immédiatement après le traitement, remplacer tout vêtement souillé par des projections. - La prévention des risques physiques de l'épandage des engrais
- Une organisation rationnelle des taches
La première des mesures de prévention passe par une réflexion en amont sur les travaux agricoles à effectuer. Une bonne préparation et organisation sont des gages de sécurité des opérations ultérieures, ainsi que le respect des bonnes pratiques sécuritaires. 1. Choix de la machine et des outils bien adaptés au travail à réaliser et au terrain.
2. Nécessité de procéder aux vérifications périodiques (freins du tracteur et de son attelage, pneumatiques, protecteurs d'arbre à cardans, graissage …).
3. Equilibrage correct du chargement embarqué, arrimage sûr du matériel transporté dans la remorque. Des calages et arrimages des charges et des équipements mal assurés ou défectueux, une mauvaise confection ou répartition du chargement sur les fourches ou plateaux de levage, entrainent une chute et des traumatismes lors du basculement de la charge manutentionnée, comme l'écrasement ou la fracture des membres, les coincements des pieds et des mains, des contusions et hématomes, …
4. Axe de verrouillage de la béquille correctement placé pendant les phases d'attelage et de dételage
5. Vérification que la remorque décharge le produit sans risque de basculement, s'assurer de l'équilibre du chargement de la trémie, de l'horizontalité de l'épandeur
6. Porter attention au risque d'enroulement ou de happement au fond des trémies, respecter les barres d'éloignement et les protecteurs situés au-dessus ou sur le coté des outils pour réduire les accès involontaires aux zones dangereuses (étrier de protection intégral …). L'absence ou le mauvais état des protections ou du mode d'attelage sont sources de nombreux accidents.
7. Prendre les précautions nécessaires pour ne pas entreprendre un débourrage en marche.
8. Abaissement des charges ou équipements élevés par systèmes hydrauliques à la fin de toute opération.
9. Respect de la réglementation routière : permis, gyrophare, feux de croisement, vitesse, poids total en charge (PTC), pas de consommation d'alcool ni de produits stupéfiants, port de la ceinture de sécurité. Plus spécifiquement, les parties mobiles des engins agricoles doivent être repliées ou démontées lors d'un parcours routier (article R. 312-15 du code de la route).
- Des équipements de protection individuelle adaptés (EPI)
L'utilisation de vêtements non ajustés ou flottants (manches, pans de chemise, franges ou tout autre élément qui peut s'accrocher …), qui pourraient être facilement happés par des pièces mobiles en rotation, est proscrite (article R 4323-16 du code du travail). Les équipements de protection individuelle comportent : des combinaisons de travail, des gants (en particulier certifiés de protection chimique EN ISO 374 en cas d'intervention sur épandeur à engrais et microgranulateur), des chaussures et lunettes de sécurité, une ceinture lombaire éventuellement pour prévenir les lombalgies, un masque anti-poussières FFP2 lors d'un fort empoussièrement occasionnel en sortie de cabine.
Juin 2019
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.