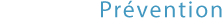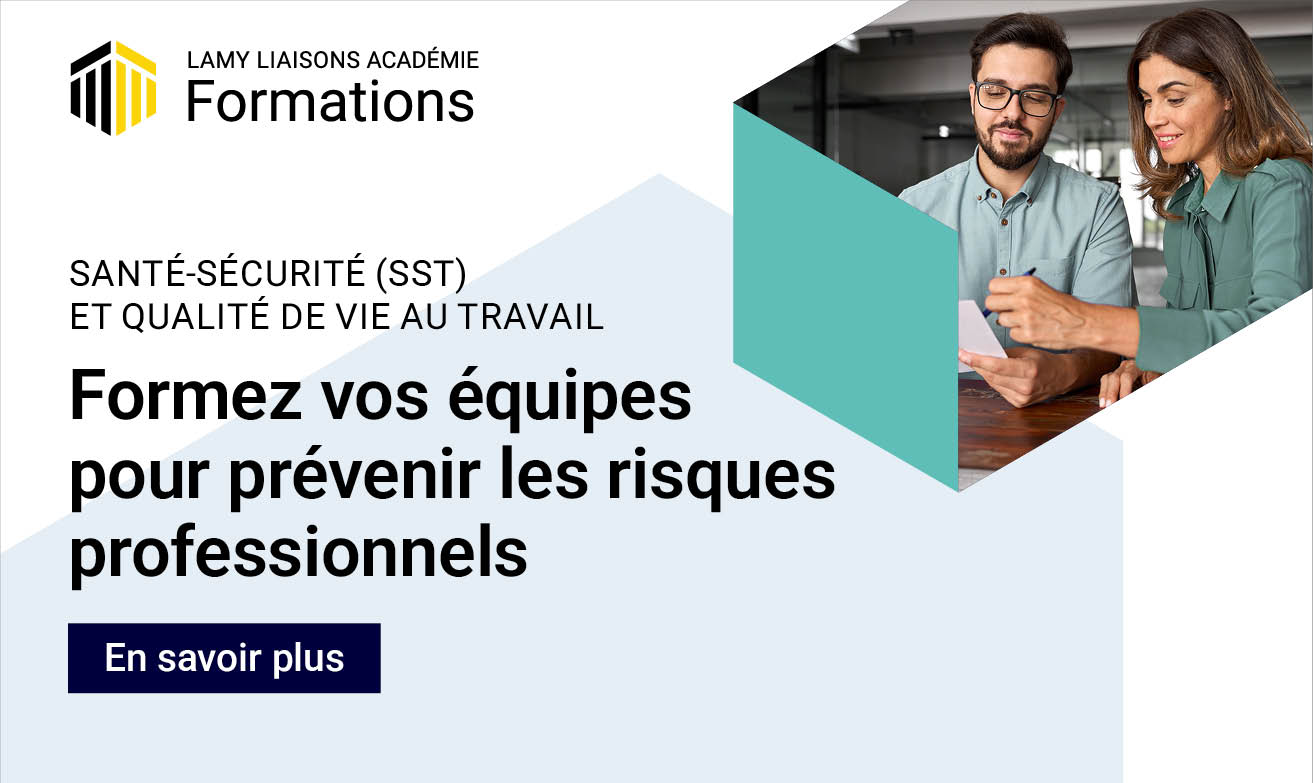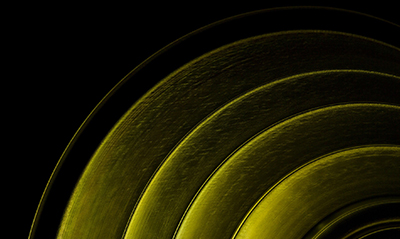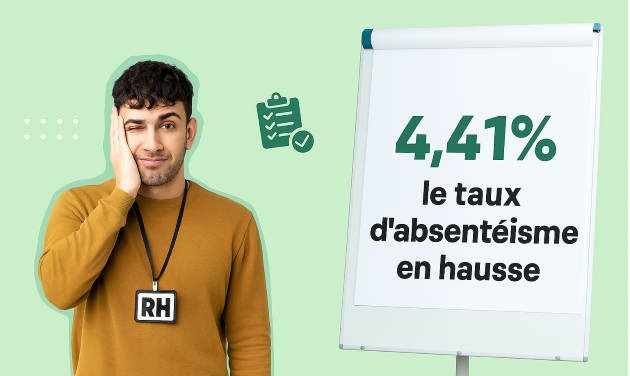Les matières minérales sont largement présentes dans de très nombreux secteurs d'activités (travaux d'extraction des roches et minerais, travaux souterrains, cimenteries et plâtreries) et utilisées pour des applications très diverses... L'inhalation fréquente et prolongée des poussières minérales provoque des atteintes pulmonaires et respiratoires d'occurrence et de gravité variable selon leurs caractéristiques physiques et chimiques...
L'inhalation fréquente et prolongée des poussières minérales provenant du transport, de la manutention, du forage, de la découpe, du perçage et du ponçage, provoque des atteintes pulmonaires et respiratoires d'occurrence et de gravité variable selon leurs caractéristiques physiques et chimiques, pouvant entrainer certaines maladies professionnelles particulièrement sévères (fibroses, cancers) avec la silice et l'amiante par exemple.
Les travailleurs exposés aux dangers des poussières minérales sont soit ceux à l'origine de l'extraction ou de la fabrication des matières minérales naturelles (roches concassées ou taillées, granite, grès, ardoise, …) ou élaborées (ciment, mortier, béton, abrasifs, briques, verre, céramique …), soit ceux beaucoup plus nombreux qui les utilisent (fondeurs, maçons, façadiers, calorifugeurs, plaquistes, couvreurs, bijoutiers, prothésistes dentaires …), ou ceux qui y sont exposés, sans en être tout à fait conscients, dans les activités d'entretien ou de maintenance du BTP.
Les milieux confinés et travaux souterrains représentent des dangers considérablement accrus d'exposition aux poussières minérales pour les travailleurs évoluant dans un espace clos, exigu, aux issues difficiles d'accès et peu praticables rendant difficiles une évacuation d'urgence en cas d'empoussièrement massif.
Des mesures de prévention primaire et collective, substitution des produits les plus nocifs, ventilation et hygiène des locaux, aspiration à la source des poussières, confinement des procédés, sont à la base d'une protection efficace : ces mesures limitent l'exposition et diminuent la concentration des poussières dangereuses dans l'air ambiant. À défaut de pouvoir le faire quand on se trouve à l'extérieur ou que le travailleur utilise une machine mobile, il est essentiel de porter un masque respiratoire. La protection collective est primordiale et le port d'une protection individuelle comme le masque est une solution de pis-aller car celui-ci peut être porté de manière inefficace ou seulement de temps en temps du fait de leur inconfort ou devenir rapidement défectueux.
Une surveillance médicale, les informations données aux travailleurs exposés sur les risques des matières minérales utilisées dans leur métier et leur formation aux mesures de prévention adéquates complètent le dispositif de sécurité au travail.
Les principales caractéristiques et dangers des poussières minérales
La poussière minérale est constituée de particules solides très fines (d'un diamètre inférieur à 100 microns) en suspension dans l'air, d'origine minérale (quartz, amiante, argile, calcaire, gypse …) : elles sont appelées fibres si le rapport longueur/diamètre est élevé (supérieur à 3). Les particules de poussières minérales sont invisibles à l'œil nu, et restent longtemps en suspension dans l'air ambiant. Elles sont souvent composées d'un mélange de particules de nature chimique différente et de granulométrie diverse, comme celles de charbon et de silice dans les galeries des mines par exemple.
La dangerosité des poussières minérales de silice ou d'amiante, apparition de pathologies respiratoires aigues ou chroniques et de cancers pulmonaires, est avérée depuis longtemps dans les usines ou dans les mines et autres travaux souterrains : mais des poussières fines peuvent être libérées aussi dans les travaux les concernant (usinage…) ou lors du vieillissement des produits en contenant ou suite à une dégradation accidentelle, et risquent d'être inhalables dans des conditions moins évidentes. Par ailleurs, d'autres minéraux entrant dans la composition de matériaux pulvérulents (ciment, plâtre, talc …) ou fibreux (laines de verre et de roche volcanique) sont susceptibles d'émettre des poussières irritantes et/ou allergisantes, et peuvent causer des rhinites allergiques ou des inflammations de la muqueuse nasale et attaquer la trachée et les poumons, ou elles engendrent une inflammation des muqueuses de la trachée (trachéite) ou des bronches (bronchite).
La quantité de poussière et les types de particules en cause influent sur la gravité des lésions pulmonaires : la formation d'un tissu fibreux ou cicatriciel peut porter atteinte à la fonction pulmonaire et donne lieu à une affection appelée fibrose (silicose pour les poussières de silice …).
- Facteurs de toxicité des poussières minérales
Ce risque est davantage lié à la structure physique de la particule qu'à sa structure chimique. C'est donc la granulométrie de la particule qu'il est important de connaître (forme, diamètre, longueur)
La concentration dans l'air inspiré, la durée et la fréquence d'exposition déterminent également le risque potentiel lié à l'inhalation de poussières minérales.
Le type d'impuretés contenues dans ces particules (résidus d'hydrocarbures, de solvants ou matières biologiques …), une susceptibilité individuelle variable et le tabagisme sont des cofacteurs aggravants.
Des maladies fibrosantes ou cancéreuses sont, avec certitude, induites par l'exposition aux fibres d'amiante et à la silice cristalline.
Il y a des durées, des intensités d'exposition et des délais pour l'apparition d'un cancer professionnel ou d'une fibrose très variables : le seuil de toxicité d'une fibre est difficile à déterminer, mais le risque de développer un cancer professionnel ou une fibrose augmente évidemment avec la durée, la fréquence et l'intensité de l'exposition. Aussi, il a été élaboré des valeurs limites d'exposition professionnelles (VLEP).
Les autres fibres minérales n'ont pas les mêmes caractéristiques physiques et chimiques, mais possèdent aussi une structure fibreuse potentiellement pathogène, avec toutefois des données permettant de juger de leur toxicité souvent encore incomplètes.
La lenteur de dissolution des fibres dans les milieux biologiques (biopersistance) est une caractéristique essentielle de toxicité : la durée de rétention dans les poumons, la durée de vie de la fibre dans l'organisme sont conditionnées par ce mode d'épuration et les fibres qui demeurent longtemps dans le poumon après avoir été inhalées sont les plus fibrosantes. De même, les fibres qui sont très biopersistantes sont plus suspectées d'être cancérogènes.
Par ailleurs, le risque est beaucoup lié à la structure physique de la fibre, à sa granulométrie (forme, diamètre, longueur) : plus les fibres sont fines et longues, plus elles peuvent pénétrer profondément dans les poumons, plus l'organisme a des difficultés à les éliminer et plus elles sont potentiellement dangereuses.
Enfin, la capacité de migrer vers d'autres organes est aussi un facteur de toxicité des fibres.
Quant aux plus fines des particules (diamètre inférieur à 5 microns), en séjournant longtemps dans le tissu pulmonaire, elles provoquent une inflammation chronique des muqueuses pulmonaires, la formation d'un tissu pulmonaire fibreux, la constitution de nodules, entrainant une maladie respiratoire, une pneumoconiose fibrosante.
L'état du matériau (niveau de détérioration et vieillesse) conditionne aussi sa friabilité, donc la production de poussières et la libération de fibres dans l'air ambiant. - L'amiante
L'amiante, blanc (chrysotile, groupe des serpentines) ou bleu (crocidolite, groupe des amphiboles), est un silicate magnésien ou calcique. Ces propriétés sont sa résistance élevée à la traction, sa résistance à la chaleur, à l'abrasion et à de nombreux produits chimiques. On trouve de multiples produits manufacturés anciens contenant de l'amiante, dont des matériaux de construction, des produits de friction, des feutres, des joints, des garnitures, des matériaux isolants et des textiles.
L'asbestose, pneumoconiose fibrosante due à l'inflammation chronique pleurale, le mésothéliome de forme maligne et le cancer des poumons sont des maladies spécifiques provoquées par la poussière d'amiante.
L'amiante est classée cancérogène en catégorie 1, c'est-à-dire en substance cancérogène sûre pour l'homme et est aujourd'hui complètement interdite en France, en ce qui concerne les utilisations nouvelles, mais elle subsiste en millions de tonnes dans les produits et constructions anciennes (toutefois en grande partie sous forme non friable comme l'amiante-ciment, mais la dépose et la vétusté libèrent des fibres).
La valeur limite d'exposition à respecter est fixée en moyenne (à ce jour) pour l'amiante, à 0,1 fibre par cm3, sur 1 heure.
Dans certains cas, les opérations de maintenance sont réalisées sans information et sans précaution, car les travailleurs ne sont pas assez conscients de la présence de fibres pathogènes, par exemple :
- les poussières de frein sur les très vieux véhicules,
- les fibres d'amiante dans les travaux de rénovation de toiture ou l'amiante se trouvent dans les plaques ondulées de fibrociment ou les produits de bardage dans les constructions datant d'avant 1978.
- Les interventions sur matériaux contenant de l'amiante (calorifuge, flocage, joints, …),
- etc.… - La silice
La silice (SiO2) et un minéral très abondant dans l'écorce terrestre, qui existe sous forme libre (cristalline ou amorphe) ou combinée sous forme de silicates de calcium, de magnésium, d'aluminium ... dans les roches sédimentaires (grès, talc, silex …), les roches métamorphiques (ardoise…) ou magmatiques (granite, feldspath, quartzite, mica …).
La silice est dure, transparente ou blanchâtre, insoluble dans l'eau et les solvants, chimiquement inerte, non combustible et présente une bonne résistance à la chaleur (point de fusion élevé) et aux chocs, ce qui lui confère de nombreuses applications industrielles : c'est en particulier la matière première principale du verre.
Les principales variétés cristallines de la silice sont le quartz (de très loin la plus répandue, notamment dans le sable), la cristobalite et la tridymite : la silice est un des minéraux les plus courants et on la trouve dans presque toutes les mines (charbon et minéraux métalliques) et carrières (granulats, pierre de taille, ardoisières, grésières et autres matériaux siliceux). Les silices amorphes (c'est-à-dire non cristallisées) sont présentes dans la terre de diatomée, mais sont surtout obtenues de façon artificielle.
Les poussières très dangereuses sont celles de la silice cristalline, la toxicité des silices amorphes étant faible.
En séjournant longtemps dans le tissu pulmonaire, les très fines poussières de silice provoquent une inflammation chronique des muqueuses pulmonaires, la formation d'un tissu pulmonaire fibreux, la constitution de nodules, entrainant une maladie respiratoire, une pneumoconiose fibrosante nommée silicose.
La gravité de la silicose peut varier de façon importante et les signes cliniques de la silicose peuvent être un simple essoufflement à l'effort (dyspnée) et de la toux au début, jusqu'à une déficience respiratoire très grave et une insuffisance cardiaque, qui apparaît en général après une dizaine, voire même une vingtaine d'années d'exposition et son évolution se poursuit même après cessation de l'exposition (beaucoup de silicose ne sont ainsi diagnostiquées qu'après la retraite).
La silicose affecte la fonction pulmonaire au point de favoriser l'apparition de la tuberculose, ce qui assombrit le pronostic vital, et le développement de cancers broncho-pulmonaires : la silice est classée comme cancérogène avéré par le CIRC mais n'est classée par l'Union européenne que comme Agent Chimique Dangereux (ACD).
Des valeurs limites d'exposition professionnelle VLEP réglementaires contraignantes sont fixées dans le Code du travail (article R. 4412-149 et décret du 10 avril 1997). La concentration moyenne en silice cristalline de l'atmosphère inhalée par un travailleur pendant une journée de travail de 8 heures ne doit pas dépasser 0,1 mg/m3 pour le quartz et 0,05 mg/m3 pour la cristobalite et la tridymite. - L'argile
Les argiles (silicates d'aluminium hydratés) sont des matériaux plastiques, malléables, friables, hygroscopiques, avec des qualités variables dépendant de la teneur en alumine (kaolin). Elles sont utilisées pour la fabrication d'objets en céramique et porcelaine, de briques, de tuiles, dans la papeterie.
L'extraction mécanique d'argile entraine la diffusion de grandes quantités de fines poussières irritantes qui se logent dans le nez ou elles peuvent causer une rhinite ou une inflammation de la muqueuse nasale. Mais surtout, l'argile contenant généralement de grandes quantités de silice libre, une inhalation chronique risque de provoquer la silicose. - Le calcaire
Le calcaire est une roche sédimentaire essentiellement constituée de carbonate de calcium qui se présente sous diverses formes, calcite cristalline (marbre), dolomie avec carbonate de magnésium, calcaire argileux ou siliceux …
Le calcaire est massivement employé comme pierre à bâtir, et broyé, il est utilisé comme fondant dans la sidérurgie ainsi que pour la fabrication de la chaux. Mélangé à l'argile, calciné puis broyé et tamisé, c'est le composant essentiel (80%) des ciments.
Les ciments sous forme sèche, poussières présentes en quantité dans les cimenteries et les chantiers de construction, présentent des risques pour les voies respiratoires (rhinites, asthme, altération de la fonction respiratoire comme la bronchite chronique, l'emphysème....).
De même, les travailleurs employés à l'extraction et au traitement du calcaire sont susceptibles de présenter des d'altérations pulmonaires, des pharyngites, des bronchites et de l'emphysème. - Le gypse
Le gypse est un sulfate de calcium hydraté pouvant contenir aussi du quartz, des carbonates, silicates …
Le gypse broyé, calciné et réduit en poudre est à la base du plâtre, mais entre aussi dans la fabrication du ciment de Portland. Il sert également comme pigment blanc dans les peintures, les émaux, les papiers …
Les travailleurs employés dans le traitement de la pierre gypseuse et les plâtriers peuvent être exposés à des concentrations élevées de poussière de gypse. Ces poussières sont nocives par inhalation : elles sont responsables d'atteintes des voies respiratoires et lorsqu'une quantité importante de ces particules de poussière irritantes se logent dans le nez, elles peuvent causer une rhinite allergique ou une inflammation de la muqueuse nasale. Certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et à s'attaquer à la trachée et aux poumons, ou elles engendrent une inflammation des muqueuses de la trachée ou des bronches. L'inhalation constante dans les poumons de poussières de gypse peut causer une pneumopathie chronique et de l'asthme. - Le charbon et le graphite
Le charbon est une roche combustible, solide, constituée essentiellement de carbone, produit de la carbonisation de substances organiques végétales depuis l'ère primaire, en association en proportion variable avec des grés, du schiste, du quartz, du soufre. Le graphite naturel est un minéral, élément natif presque pur de carbone, tendre et friable, en amas ou en paillettes, avec la présence d'un peu de silice cristalline et de silicates. Le graphite artificiel pur peut être obtenu par chauffage du charbon ou du coke de pétrole.
Le charbon est utilisé comme moyen de chauffage mais surtout comme carburant des centrales électriques et matière première dans de nombreux procédés chimiques par pyrolyse, hydrogénation catalytique, gazéification.
Le graphite, bon conducteur du courant électrique, est utilisé dans la fabrication des électrodes, des piles et ajouté à certains lubrifiants. L'industrie en utilise dans la fabrication de crayons, dans les peintures, les pneus, en fonderie et métallurgie (garnissage des fours et creusets).
L'anthracose est une pneumoconiose causée par l'inhalation de particules de carbone : les particules de charbon s'accumulent dans les poumons et dans les systèmes de drainage lymphatique. L'anthracose n'entraîne pas de lésion pulmonaire par elle-même, mais est très souvent associée à des cristaux de silice issus des roches siliceuses avoisinantes, responsables d'une inflammation chronique et d'une fibrose (anthracosilicose), qui a été à l'origine d'une des plus grandes catastrophes sanitaires en matière de maladie professionnelle.
L'anthracosilicose se traduit par une réduction progressive et irréversible de la capacité respiratoire (insuffisance respiratoire), même après l'arrêt de l'exposition aux poussières. Il existe un risque associé de tuberculose et possiblement de cancer du poumon : le cancer broncho-pulmonaire primitif est reconnu comme imputable à l'inhalation de poussières de silice cristalline lorsqu'il est associé à des signes radiologiques ou des lésions de nature silicotique.
Par ailleurs, les mineurs de charbon ont une prévalence plus importante de syndromes de bronchite et d'emphysème. - Les fibres minérales naturelles (hors amiante)
La wollastonite (silicate de calcium) a des cristaux sous forme d'aiguilles prismatiques grêles, les argiles telles que l'attapulgite (hydrosilicate magnésium aluminium) et la sépiolite (silicate de magnésium) sont composées d'entrelacs de fibres avec des cristaux sous forme de microscopiques bâtonnets allongés. La vermiculite (silicate d'aluminium-fer-magnésium) est un minerai ressemblant au mica, composé d'une structure argileuse en feuillets pouvant se fracturer en minuscules particules fibreuses.
En substitution à l'amiante, ces fibres minérales naturelles sont massivement utilisées dans la construction pour la fabrication de matériaux d'isolation (fibrociment, plaques d'isolation thermique, revêtements muraux résistants au feu), pour le renforcement des matériaux de construction (ciment, plastique, caoutchouc, plâtre), dans certains matériaux de friction et d'isolation et dans l'industrie des céramiques …
Elles sont également employées comme matériau d'amendement des sols et pour leurs propriétés absorbantes (déversements d'huiles, litières …).
Les expositions professionnelles à ces poussières de fibres minérales naturelles sont nombreuses et leur inhalation prolongée peut provoquer une irritation des parties supérieures des voies respiratoires (nez, gorge, larynx). On ne peut pas les classer comme cancérigène pour l'homme selon le CIRC (groupe 3 : non classable). - Les laines minérales
Les laines minérales d'isolation sont des fibres de silicates vitreuses artificielles à orientation aléatoire.
Selon le matériau utilisé pour les fabriquer, on distingue :
- La laine de verre, obtenu à partir de sable et de verre recyclé (calcin),
- La laine de roche, obtenu à partir de basalte fondu, filé, et soufflé,
- La laine de laitier, obtenu à partir de laitier de hauts fourneaux.
Les laines de verre, de roche ou de laitier contiennent plus de 90 % de fibres, mais aussi 3 à 5 % de liants organiques (résines phénoliques) qui assurent la cohésion du produit, et moins de 1 % d'huile, qui limite l'émission de poussières et l'absorption d'eau. Les laines minérales sont principalement utilisées pour l'isolation thermique, acoustique et la protection incendie des habitations individuelles et des bâtiments collectifs. Elles servent à isoler les combles, les murs, les sols, les plafonds, les toitures, les terrasses, les tuyauteries... En climatisation ou ventilation, elles peuvent constituer des gaines de circulation d'air. Elles peuvent aussi isoler des chaudières, des fours, du matériel frigorifique et des appareils électroménagers.
Les fibres des laines minérales sont plus épaisses que les fibres d'amiante, ce qui réduit leur dangerosité. Les fibres des laines minérales pénètrent beaucoup moins profondément dans l'arbre respiratoire et, de plus, sont en général plus rapidement éliminées par l'organisme que les fibres d'amiante (faible biopersistance).
Les fibres constituant les laines minérales sont exonérées du classement cancérogène (groupe 3 du CIRC « ne peut être classé quant à sa cancérogénicité pour l'homme »), avec une phrase de risque R40, c'est-à-dire substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante.
Des irritations des voies respiratoires sont fréquentes chez les utilisateurs de laines minérales, ainsi que des cas d'asthme.
La valeur limite d'exposition à respecter est fixée en moyenne est fixée (à ce jour) pour les laines de verre, de roche, à 1 fibre par cm3, sur 8 heures. - Autres poussières minérales
De très nombreuses autres poussières minérales son susceptibles d'être dangereuses :
- le corindon (oxyde d'aluminium) utilisé comme abrasif pour l'usinage des métaux, du bois, du verre et des céramiques par abrasion, meulage ou polissage,
- le spath fluor (fluorure de calcium) employé comme fondant dans les fours à sole des aciéries et pour la fusion des métaux,
- le talc (silicate de magnésium hydraté) utilisé dans les produits cosmétiques et sanitaires, dans la fabrication des peintures, des céramiques, du papier.
- etc. …
Les situations professionnelles à risques de poussières minérales
De nombreux métiers sont très exposés aux risques d'inhalation nocive de poussières minérales : les industries extractives et les chantiers du BTP sont les plus concernés par leurs dangers pour la santé au travail.
- Les carriers
Les poussières minérales sont produites dans les carrières en continu et à tous les points du traitement : chargement, concassage, criblage, roulage des camions, tirs de mines, …, et, par temps sec, ensoleillé et/ou venté, ce phénomène est accentué.
Ces poussières sont occasionnées par le transport et le traitement des matériaux et, dans le cas de carrières de roches massives, par le forage des trous de mine et l'abattage de la roche. Les émissions de poussières ont des conséquences sur la santé des carriers, plus ou moins graves selon la climatologie du secteur, la topographie et la granulométrie et la nature des particules aéroportées (friabilité, siccité, composition chimique de la roche).
De nombreux matériaux de construction (granite, grès, quartzite, ardoise, …) extraits dans les carrières renferment de la silice cristalline et les postes de travail des carriers sont ainsi particulièrement concernés par l'exposition aux poussières fines de silice. - Les mineurs
De nombreuses roches présentes dans les tunnels et les mines renferment aussi de la silice cristalline et les postes de travail sont ainsi particulièrement concernés par l'exposition aux poussières fines de silice : ces particules minérales solides en suspension dans l'air, sont produites dans les creusements des galeries souterraines ou le fonçage des puits et à tous les points du traitement : chargement, roulage des camions, tirs de mines, forage des trous de mine, abattage au marteau-piqueur et concassage de la roche. Les facteurs de risques de silicose augmentent avec les concentrations élevées observées dans ces milieux confinés, la fréquence et la durée d'exposition, le tabagisme, l'inhalation d'autres polluants (gaz d'échappement ou des tirs d'explosifs, vapeurs de solvants ...) et les symptômes peuvent être aggravées par l'inhalation concomitante de poussière de charbon. - Les maçons
Les ciments sous forme sèche, les poussières d'abrasif, de plâtre et de laines isolantes… présentes en quantité sur les chantiers présentent des risques pour les voies respiratoires (rhinites).
Les postes de travail concernés par l'exposition à la silice sont ceux ou ces matières siliceuses sont susceptibles d'émettre des poussières fines : le meulage, le ponçage, le burinage et le tronçonnage, de pierres, de briques, de parpaings, d'ardoises, de béton ou de mortier, le forage au marteau perforateur, la démolition à l'aide d'un marteau-piqueur ou le sciage de pièces de maçonnerie avec scie portative.
Les risques d'exposition à l'amiante concernent principalement les travaux de démolition et les maçons fumistes (cheminées industrielles).
Un tableau de maladie professionnelle est spécifique aux risques du ciment : Tableau n°8 RG : Affections causées par les ciments (aluminosilicates de calcium). - Les façadiers
Les différentes techniques de décapage mécanique (décapage à l'eau sous haute pression, sablage, hydro sablage, gommage, hydro gommage, ponçage…) exposent à des aérosols de débris du revêtement et aux poussières des agents abrasifs utilisés (corindon…) : la présence, dans les vapeurs et brouillards générés lors du décapage, de particules toxiques telles que des poussières de revêtements pulvérisés par la projection abrasive contenant de la silice cristalline (grès, granits …) présente un risque respiratoire.
Toutes les poussières du chantier répandues par élimination des salissures et de la couche superficielle du revêtement, par le brassage d'air et le piétinement soulevant les particules tombées au sol, sont nocives par inhalation. Le risque d'exposition à l'amiante existe dans les travaux de rénovation ou l'amiante se trouvent dans des produits de bardage dans les constructions datant d'avant 1978. - Les plâtriers
Les travaux du plâtrier et du plaquiste sont sources de production de beaucoup de poussières minérales : les poussières de plâtre (carbonate et sulfate de calcium), les fibres des laines d'isolation minérales de verre, de roche, mais il faut aussi tenir compte des autres poussières provenant du reste du chantier (ciment, amiante), répandues par le brassage d'air et le piétinement soulevant les particules tombées au sol. - Les couvreurs
L'exposition aux poussières de silice, d'amiante et d'ardoise génère des risques de lésions pleurales, fibroses pulmonaires, cancer broncho-pulmonaire. Le risque d'exposition à l'amiante existe dans les travaux de rénovation ou l'amiante se trouvent dans les plaques ondulées de fibrociment ou les produits de bardage dans les constructions datant d'avant 1978. Ce sont les opérations libératrices de fibres qui sont les plus dangereuses : découpe pour l'ouverture dans une toiture en amiante-ciment pour le passage d'une gaine d'extraction d'air, d'une cheminée…, perçage, manipulation de plaques détériorées, démoussage avec un nettoyeur haute pression… Mais la simple dépose des plaques du support (crochets, tirefonds, agrafes…) peut occasionner une dégradation mécanique brutale ou la casse due à la vétusté.
La manipulation et la pose de laines minérales (plusieurs millions de m3 par an), en rouleau, en panneaux et matelas, de dalles de plafonds … pour l'isolation des combles génère de grandes quantités de poussières irritantes. - Les carreleurs
Les carreleurs sont exposés à l'inhalation de poussières de ciment sous forme sèche et de poussières minérales de silice lors de la découpe de granit et le ponçage de béton pour la préparation des supports, qui peuvent être responsables d'affections respiratoires. L'intervention sur des matériaux susceptibles de libérer de l'amiante expose le carreleur à l'inhalation de la poussière de cette fibre minérale cancérogène lors de travaux de rénovation d'anciens dallages.
Un tableau de maladie professionnelle est spécifique aux risques du ciment : Tableau n°8 RG : Affections causées par les ciments (aluminosilicates de calcium). - Les chauffagistes
Les interventions sur matériaux contenant de l'amiante (calorifuge, flocage, joints) sont susceptibles d'exposer à l'inhalation de poussières cancérogènes conduisant à de graves maladies pulmonaires (asbestose), ou cancers du poumon, de la plèvre qui peuvent se déclarer très longtemps après l'exposition. - Les céramistes
Les substances entrant dans la composition de la céramique sont très nombreuses et les poussières minérales provenant des matières premières en suspension exposent les céramistes à des dangers d'affections respiratoires.
Les poussières du plâtre sont émises lors de la fabrication des moules et les poussières de silice sont émises lors de nombreuses opérations. - Les verriers et cristalliers
La silice cristalline est le produit de base essentiel de la fabrication du verre et les émissions de particules de silice cristalline peuvent générer des cancers broncho-pulmonaires et les poussières de silice cristalline peuvent provoquer l'apparition de bronchites chroniques.
L'industrie du verre a été classée par le CIRC en 1993 en 2A (cancérogène probable, indices d'action cancérogène sur l'homme presque suffisants) pour la fabrication de la verrerie d'art et le verre pressé dans son ensemble. - Les fondeurs
Le sable de fonderie utilisé pour la fabrication des moules, sous forme de poussières riches en silice cristalline peut provoquer une silicose et est classée comme cancérogène avérée par le CIRC : l'exposition a lieu à la sablerie lors du mélange et du transport, lors du noyautage et du moulage, lors du décochage (séparation du sable des pièces), et un peu lors du parachèvement des pièces (ébarbage, meulage des pièces). - Les cimentiers
La production du ciment dans les cimenteries expose les cimentiers à des pathologies respiratoires liées à la structure de poudre fine alcaline et irritante qui se répand dans l'air ambiant sous forme de poussières, qui se déposent sur tous les sols et supports divers et qui sont susceptibles d'atteindre les alvéoles pulmonaires.
Les ciments sous forme sèche, poussières présentes en quantité dans les cimenteries, présentent ainsi des risques sérieux pour les voies respiratoires (rhinites, asthme, altération de la fonction respiratoire comme la bronchite chronique, l'emphysème....). - Les prothésistes dentaires, les bijoutiers et joaillers
L'exposition aux poussières de silice cristalline par inhalation lors de la fabrication des moules, du meulage, du sablage et polissage des prothèses avec des abrasifs, peut provoquer une silicose et est classée comme cancérogène. Par ailleurs, les poussières de silice cristalline peuvent provoquer l'apparition de bronchites chroniques.
Il en est de même dans les bijouteries ou l'exposition à la silice cristalline est due au plâtre réfractaire et au meulage, lorsque le moule est brossé, au polissage compte tenu de la pâte abrasive utilisée (émeri, tripoli), et au démoulage avec du talc. - Les travailleurs du caoutchouc
La pneumoconiose au graphite se rencontre chez les travailleurs du caoutchouc exposés régulièrement et longtemps soumis sans protection aux fumées émises lors des étapes de production, de vulcanisation et de transformation du caoutchouc.
Les mesures de prévention des risques professionnels des poussières minérales
Les risques professionnels des poussières minérales offre un large champ d'application à la prévention : si la vulnérabilité de l'appareil respiratoire est importante, les diverses mesures de prévention techniques et organisationnelles sont efficaces et permettent de fortement réduire la fréquence et la gravité des affections respiratoires professionnelles provoquées par les poussières minérales. Cette vigilance est d'autant plus importante que la latence de nombreux effets, le manque de recul pour les nouveaux produits, des connaissances techniques et scientifiques insuffisantes (en regard de la forte croissance de l'utilisation et de la diversité des fibres minérales), créent des conditions susceptibles de reproduire à moyen terme des catastrophes sanitaires similaires à celle des expositions anciennes à l'amiante et à la silice.
Les mesures principales portent sur des mesures techniques, des améliorations des pratiques au travail, le port d'équipements individuels de protection respiratoire et des programmes de formation. Cette vigilance est d'autant plus importante que la latence des effets nocifs, leur caractère ténu au début de leur apparition, créent des conditions susceptibles de masquer longtemps la gravité de la situation.
Les risques professionnels liés aux poussières minérales nécessitent de respecter scrupuleusement les principes de prévention collective et individuelle :
- la prévention technique collective, qui permet la suppression ou la réduction de l'exposition à des niveaux aussi bas que possible, est primordiale, là ou elle est envisageable : diminuer les émissions de poussières, favoriser leur évacuation et développer l'automatisation des tâches, ce qui permet de limiter le contact avec l'ambiance polluée, choix de produits et de modes opératoires les moins émissifs.
- la prévention technique individuelle, qui consiste à utiliser des appareils de protection respiratoire, ne doit être qu'un complément des mesures de protections collectives ou pour pallier une situation exceptionnelle pour laquelle il n'est pas possible de mettre en œuvre des mesures de protection collective.
Les différents risques professionnels liés aux poussières minérales doivent faire l'objet d'une évaluation pour permettre la rédaction du Document Unique de Sécurité (Décret du 5 novembre 2001) en appréciant à la fois l'environnement matériel et technique (outils, machines, produits utilisés) et l'efficacité des moyens de protection existants et de leur utilisation selon les postes de travail. De manière aussi à ce que les salariés puissent être informés à propos des produits dangereux utilisés, les Fiches de Données de Sécurité (F.D.S.) doivent être mises à disposition et la connaissance de leurs risques expliquée au travers de la compréhension de leur étiquetage.
- La substitution des matériaux et procédés les plus émissifs de poussières minérales dangereuses
La suppression, notamment de la silice, ou le recours à des procédés évitant de l'utiliser, sont les mesures de prévention prioritaire, qui s'impose à l'employeur. Toutefois, cette substitution n'est envisageable que lorsqu'il existe un produit aussi efficace, tout en ne présentant pas par ailleurs d'autres risques, et lorsque c'est techniquement possible. Dans le cas de la silice, la substitution est difficile mais on peut néanmoins trouver des exemples ou adopter des matériaux pas ou moins émissifs de silice. Par exemple :
- Utiliser la grenaille d'acier ou d'autres produits abrasifs non siliceux (microbilles plastique) pour le décapage par projection sous pression et le sablage des surfaces,
- Remplacer les meules en grès par des meules à base de corindon (oxyde d'aluminium), ou les briques réfractaires siliceuses par des briques en magnésite (carbonate de magnésium) ou corindon dans les fours,
- Lors des opérations de sablage des façades, utiliser des matériaux de substitution tels que le corindon, ou les médiaplastiques, ou des media naturels provenant de coquilles ou de noyaux de fruits,
- Lors du malaxage et crépissage des façades, substituer les enduits standards par des produits “sans poussière”.
- Favoriser les matériaux prédécoupés et utiliser des laines minérales isolantes non friables et entourées d'une enveloppe cellulosique protectrice.
- Au démoulage en bijouterie, remplacer le talc par de la silicone,
- Pour les prothésistes dentaires, choisir des produits ou instruments (meules, revêtements) à la plus faible teneur en silice,
A défaut de produit de remplacement, il convient d'utiliser les produits les moins émissifs de poussières (par exemple, pour les laines d'isolation, adopter des matériaux revêtus sur leur surface externe), les emballages et les méthodes de travail permettant de réduire au minimum l'émission de fibres : les pratiques qui libèrent les fibres en quantité importante doivent être évitées, comme l'utilisation des fibres en vrac dans les opérations d'isolation ou de calorifugeage, le travail de flocage (projections mettant en jeu des fibres), les découpes avec des outils tournant à vitesse rapide.
Il convient d'utiliser des méthodes de travail permettant de réduire au minimum l'émission de poussières minérales :
- Adopter des méthodes de travail non génératrices de poussières : le travail à l'humide (opérations de sciage par exemple) par l'arrosage, la brumisation, l'humidification des supports, permettent de diminuer fortement le taux de poussières de silice cristalline dans l'air.
- Préfabriquer en atelier bien équipé et ventilé peut diminuer certains risques, plutôt qu'effectuer les découpes sur place dans de mauvaises conditions (éléments de bordures de voirie, courbes de trottoirs …).
- Proscrire le balayage et le soufflage, ne jamais utiliser de l'air comprimé et favoriser le nettoyage par voie humide. - La prévention collective des affections respiratoires dues aux poussières minérales
- Réduction de la formation de poussières.
La concentration minimale doit être atteinte en évitant l'émission et l'accumulation de poussières d'une part, en disposant de systèmes de ventilation et d'aspiration d'autre part.
Parmi les dispositions de réduction de l'empoussièrement pour les différents métiers,- Capoter les sources d'émission de poussières (par exemple jetées des élévateurs, mise sous aspiration des transporteurs, des malaxeurs d'enduit à arrivée d'eau automatique, fermé par un capot muni d'une couverture au format du sac, dispositif d'extraction des machines de noyautage et de moulage) et relier ces capotages aux circuits de dépoussiérage. Les sources d'émissions de poussières sont fortement dépendantes de la maîtrise de l'étanchéité des installations.
- Confinement des procédés générateurs de poussière sous pression négative (dépression légère par rapport à la pression d'air à l'extérieur de l'espace confiné).
- Mécanisation du sablage à sec haute pression, en l'effectuant en espace clos, encoffrement des machines de grenaillage et décochage, des cabines d'ébarbage ventilées, des cabines de sablage étanches et en dépression, équipées d'un dispositif de récupération automatique des sables.
- Equiper toutes les installations d'un système d'aspiration fermé permettant le captage et la collecte des poussières avec asservissement de la marche des équipements à la marche des ventilateurs de dépoussiérage. La récupération des poussières se fait par un circuit de dépoussiérage largement dimensionné comportant des cyclones permettant la récupération des poussières très fines et des filtres.
- Utiliser des machines de coupe munis d'aspirateur de poussière
- Diminuer des possibilités d'accumulation de poussières en évitant les surfaces planes inaccessibles et les aspérités des parois (surfaces lisses, rebouchage de tous les trous des sols et des murs…). Des installations conçues pour permettre facilement leur nettoyage et éviter toute zone de rétention de poussières est une mesure essentielle.
- Réduire la mise en suspension des poussières dans l'air en limitant les hauteurs de chute de produits pulvérulents lors des transferts, en contrôlant périodiquement les attaches au niveau des manches…
- Employer des systèmes clos pour acheminer les matières premières sèches (convoyeurs ou conduites fermés, distributeurs à vis clos…).
- Vérifier que les raccords des installations en circuit fermé, les joints pour empêcher les fuites sont en bon état et correctement posés.
- Réduire la concentration de poussières dans l'environnement passe aussi en procédant au nettoyage fréquent par aspiration mécanique centralisée, si possible, ou par des mesures d'hygiène des locaux tel le nettoyage régulier du sol et des parois de l'atelier et des postes de travail à l'aide d'un aspirateur équipé d'un filtre absolu (pas de balayage qui remet en suspension les particules dans l'air) et humidifier les sols.
- Des pistes bien entretenues qui n'entraînent pas une émission de poussières excessive dans les carrières et la réglementation de la vitesse des engins et surveillance de son respect qui permet de limiter les envols de poussières. Le capotage et le bâchage des matériels enferme le lieu d'émission de la poussière et évite qu'elle se disperse dans l'air ambiant : toile sur les cribles, bâchage des convoyeurs et des camions. L'arrosage des pistes par des citernes mobiles ou préférentiellement par des buses fixes déclenchées manuellement ou automatiquement permet de réduire la remise en suspension des poussières des pistes. De même, on peut humidifier superficiellement le chargement des camions passant sous un portique, pulvériser de l'eau dans la trémie d'alimentation, ...Des additifs chimiques mouillants peuvent améliorer l'efficacité en agglomérant les poussières émises.
- L'utilisation de filtres électrostatiques dans les conduits du four à clinker des cimenteries, aux postes de criblage et d'ensachage diminue aussi considérablement le niveau d'empoussièrement.
- Travailler à l'humide : mélanger les substances en milieu humide, humidifier si possible le matériau avec de l'eau pour éviter la dispersion des fibres dans l'air, outils avec apport d'eau tels l'arrosage intégré pour marteau-piqueur, la découpe au jet d'eau, l'hydrogommage, les carters de découpe à l'humide .…
- Dans les travaux miniers et de creusement des tunnels et galeries souterraines, forage à l'eau, humidification préalable de la roche et des déblais lors de leur chargement et de leur transport, arroser abondamment le marin, le front de taille, avant le tir, puis d'effectuer une brumisation après le tir et au cours du marinage.
- Délimiter et isoler les zones d'utilisation à risque : pour limiter au strict minimum le nombre de travailleurs soumis au risque en restreignant l'accès des zones où se déroulent les activités poussiéreuses et limiter la durée de travail de ces personnes dans les zones à risque. En particulier, coordonner l'intervention des différents corps de métiers pour éviter leur présence simultanée sur le site, de façon à limiter le nombre de personnes susceptibles d'être exposées. Apposer une signalisation claire d'avertissement et de sécurité.
- Limiter les quantités de fibres (stockage, déchets) sur le lieu de travail. Les produits doivent être stockés dans leur emballage d'origine et déballés au dernier moment et au plus près du lieu d'utilisation.
- Prédécouper les pièces en atelier bien équipé (table aspirante …) et ventilé, plutôt qu'effectuer les découpes sur place dans de mauvaises conditions.
- D'autres mesures spécifiques sont aussi à considérer, comme la dépose de plaques amiante-ciment de l'ensemble d'une toiture qui nécessite un plan de retrait en rentrant dans la catégorie des travaux de « retrait d'amiante non friable à risques particuliers » (arrêté du 22/02/2007) après avoir obtenu un certificat de qualification.
- Les installations de dépoussiérage sont conçues pour assurer une protection collective comme l'aspiration des poussières des machines de meulage etc.…
Elles reposent sur une extraction de l'air chargée de poussière avec un système de collecte par des ventilateurs, avant son rejet à l'atmosphère.
La ventilation mécanique générale doit assurer un renouvellement d'air en permanence par extraction et soufflage : l'air est transporté dans le local par un ventilateur de soufflage et extrait du local par un ventilateur d'évacuation. L'extraction de l'air se fait grâce à un système de collecte par ces ventilateurs et des gaines de diffusion, réseau de conduits jusqu'aux filtres et aux épurateurs dans l'installation d'air soufflé qui permettent de nettoyer l'air, puis de l'évacuer à l'extérieur par rejet dans l'atmosphère (les aires de chargement et de déchargement, sans système d'aspiration localisé, sont particulièrement concernées par une ventilation forcée efficace).
Les composants aérauliques comme les ventilateurs, les conduits doivent être accessibles et faciles d'entretien et de nettoyage. En particulier, les réseaux s'encrassent rapidement avec de filtres hors d'usage, une évacuation des condensats obstruée… L'entretien régulier du système de ventilation (nettoyage des conduits d'extraction, changement des filtres) est une condition indispensable de bon fonctionnement.
Dans le cas d'une installation fonctionnant avec un rejet permanent de l'air dépoussiéré à l'extérieur, elle est dotée d'un système d'introduction d'air neuf destiné à compenser les volumes d'air extraits par l'installation d'aspiration. La compensation peut être naturelle par des ouvertures existantes ou spécialement aménagées à cet effet dans des zones éloignées des postes de travail (cas généralement des petites installations).Dans les cas de moyennes ou grandes installations, la compensation doit être réalisée par une introduction mécanique au moyen d'un ventilateur raccordé à une gaine de diffusion. Pour les machines portatives, il convient de généraliser le captage localisé des poussières à la source en utilisant par exemple un outillage muni d'un système d'aspiration intégré et s'organiser pour isoler les matériels et postes de travail qui ne pourraient être raccordés au réseau d'aspiration.
L'extraction par le captage à la source doit être réalisée avec un matériel adapté évitant notamment la formation d'étincelles. Il est important de choisir des ventilateurs de dimensions et de type appropriés afin d'assurer l'efficacité du système de dépoussiérage. Ils doivent permettre d'obtenir une vitesse de déplacement de l'air suffisante pour capter les poussières, les aspirer et les transporter dans le réseau de conduits jusqu'aux filtres et aux épurateurs qui nettoient l'air, puis l'évacuent à l'extérieur. Les vitesses de l'air dans les canalisations doivent être choisies pour chaque installation en fonction de la nature et des propriétés des poussières. La vitesse de transport est un facteur essentiel pour les réseaux d'évacuation d'air contenant des poussières : elle doit être supérieure à une valeur minimale de façon à éviter une sédimentation des poussières et un bouchage des canalisations. Elle est d'autant plus grande que les particules sont de masse volumique et de dimensions élevées.
Pour prévenir un risque de pollution de l'atelier et les conséquences d'un incendie ou d'une explosion, il faut placer le dépoussiéreur à l'extérieur ou dans un local adapté.
Le respect de l'équilibrage des réseaux et une maintenance rigoureuse (vérification des filtres avec nettoyage ou changement par exemple) sont indispensables au bon fonctionnement de ces installations.
Pour mesurer l'efficacité des installations de ventilation, la mesure périodique par prélèvements d'atmosphère et analyses des poussières est importante.
- Pour les travaux souterrains, la recommandation R352 de la CNAMTS, « Travaux de creusement en souterrain de galeries, de puits ou de grandes excavations. Mise en œuvre de dispositifs de ventilation mécanique », définit les caractéristiques de la ventilation et indique avec précision les quantités d'air nécessaires à apporter, en fonction du type et des dimensions de l'ouvrage : une ventilation mal calculée n'atténue pas assez la pollution de l'air.
Gaines de ventilation de taille et de débit suffisants
Aspiration au plus près possible des émissions de gaz et de poussières
Ventilation auxiliaire pour l'absorption du bouchon de tir
Canars (buses ou conduites en tôle de diamètre pouvant dépasser le mètre, adapté à la dimension de l'ouvrage excavé), amenant l'air frais ou évacuant l'air vicié.
Il existe deux techniques d'aération, la surpression par soufflage et la dépression par aspiration, plus efficace, qui peuvent être associées dans un dispositif de ventilation soufflante et aspirante, avec un ventilateur de brassage muni d'un dispositif de brumisation dans la zone du front, afin d'éviter la formation de zones mortes où les gaz pourraient s'accumuler et générer des expositions significatives pour les travailleurs.
A proximité des tailles, les conduites d'aération peuvent déboucher sur des galeries spécifiques très inclinées, voire verticales : les remontes d'aérage, qui sont destinées à établir le plus vite possible une communication d'air entre une galerie d'aval et une galerie d'amont. - La métrologie des concentrations de poussières minérales dans l'air
Pour évaluer les niveaux d'exposition, des mesures doivent être réalisées régulièrement pour procéder à des contrôles de la concentration de la silice au poste de travail afin de déterminer si les valeurs limites VLEP sont respectées. Les concentrations sont calculées soit sur la durée du prélèvement, soit sous forme de valeur moyenne pondérée dans le temps par rapport à une journée de travail de huit heures.
La norme EN 481 concerne l'échantillonnage de poussières sur les lieux de travail et donne les caractéristiques des instruments à utiliser pour déterminer les concentrations.
Les mesures et analyses peuvent être faites par l'employeur ou par un laboratoire extérieur et le respect des valeurs limites doit être vérifié au moins annuellement.
Si la valeur limite d'exposition est dépassée, cela permet d'imposer un arrêt temporaire d'activité pour remédier à la situation, puis il faut réaliser un nouveau contrôle sans délai. - La prévention individuelle des affections respiratoires dues aux poussières minérales
Le port d'équipements de protection des voies respiratoires ne doit être qu'un complément des mesures de protections collectives ou pour pallier une situation exceptionnelle ou pour laquelle il n'est pas possible de mettre en œuvre des mesures de protection collective, notamment pour les travaux en extérieur.
Il convient alors de porter un appareil de protection respiratoire à ventilation libre de type FFP3 pour les activités les plus génératrices de poussières comme le ponçage ou un masque jetable FFP2 pour les activités occasionnelles moins poussiéreuses. Le masque filtrant contre les poussières ou les grosses particules (pas de protection contre les gaz), est en papier ou cartonné, léger, jetable. Le plus souvent, il s'agit de demi-masques prenant le nez et la bouche. Ils sont relativement faciles à porter et bien acceptés, mais leur durée d'efficacité est limitée à quelques heures.
Le demi-masque ou masque complet filtrant à cartouche est à utiliser dans les situations d'empoussièrement massif ou pour les travailleurs prédisposés aux affections respiratoires causées par les poussières minérales : ils possèdent une cartouche qui filtre les aérosols solides, les aérosols solides et liquides, les gaz ou combiné contre les gaz et les aérosols, avec cartouche adaptée au risque et pré-filtre poussières. C'est une pièce faciale qui recouvre le nez, la bouche et le menton et les yeux dans le cas du masque complet et qui est réalisée entièrement ou dans la plus grande partie de sa surface en matériau filtrant. Elle comporte des brides de fixation et dans certains cas une ou plusieurs soupapes expiratoires.
Pour les concentrations attendues élevées de silice ou d'amiante, pendant le sablage de pierre, le grenaillage, le démantèlement des fours industriels pour l'enlèvement des isolants usagés, le désamiantage, un masque complet à adduction d'air (ventilation assistée) est indispensable pour ces tâches particulièrement exposées, dans les conditions de travail exceptionnellement difficiles. - Des mesures d'hygiène
- Un nettoyage régulier permet de réduire les niveaux de poussières. Il convient de réaliser un nettoyage des lieux de travail avec les outils appropriés, avec des précautions pour éviter la dispersion des poussières lors du vidage des aspirateurs ou des conteneurs à déchets, du changement des filtres des dépoussiéreurs.
Les zones de travail doivent être nettoyées avec un chiffon humide ou un aspirateur à filtre absolu, jamais avec une soufflette ou un balai à sec, ni avec de l'air comprimé pour éliminer les poussières adhérentes.
Ces mesures d'hygiène concernent les sols et les plans de travail, mais aussi les murs et les plafonds.
- Des installations sanitaires (WC, lavabos, douches) doivent être mises à disposition des travailleurs, correctement équipées et en nombre suffisant, permettant aux travailleurs de se nettoyer fréquemment les mains et le visage à l'eau et au savon et de se laver en fin de poste pour limiter l'incrustation des particules dans la peau. En cas de forte contamination, les installations sanitaires doivent elles-mêmes faire l'objet d'un nettoyage méticuleux.
- Des douches oculaires portatives conçues pour fournir immédiatement le liquide de rinçage et des fontaines rince yeux/visage fixes doivent être disponibles.
- Des vestiaires appropriés doivent être mis à la disposition des travailleurs : l'entreposage des tenues de travail doit avoir lieu à l'abri de la poussière (le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé). - La surveillance médicale
Pour les travailleurs exposés à la poussière, il faut réaliser des visites médicales régulières :
- Tests respiratoires (spiromètre) à l'embauche pour détecter une déficience des fonctions pulmonaires et tous les 2 ans pour dépister l'apparition des troubles respiratoires.
- Radiographie thoracique si nécessaire, épreuves fonctionnelles respiratoires (EFR).
La détection au plus tôt des irritations respiratoires et l'intervention du médecin du travail permet l'identification des travailleurs prédisposés et le retirement de l'exposition afin de prévenir une maladie chronique.
En cas d'une maladie débutante ou a fortiori établie (asthme, pneumopathie …), le changement de poste pour une éviction totale de la poussière peut être demandé par le médecin du travail, qui, conformément à l'article L241-10-1 du Code du Travail, est habilité à proposer des mesures individuelles telles que mutations ou transformations de postes, justifiées par des considérations relatives à l'état de santé physique des travailleurs qui ne correspondent plus au travail exigé. - La formation et l'information du personnel
La formation, par un organisme agréé, sur les dangers des produits et procédés utilisés et sur les moyens de se protéger, est indispensable : informer sur le risque potentiel de maladies pulmonaires et sur les moyens de les prévenir, savoir utiliser les masques adéquats, …
Pour aller plus loin :
- OFFICIEL PREVENTION : Protections collectives - Organisation – Ergonomie > Risque chimique : La prévention des risques professionnels des fibres
- OFFICIEL PREVENTION : Protections individuelles > Les voies respiratoires : La prévention des risques professionnels de la silice
Février 2015
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.