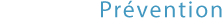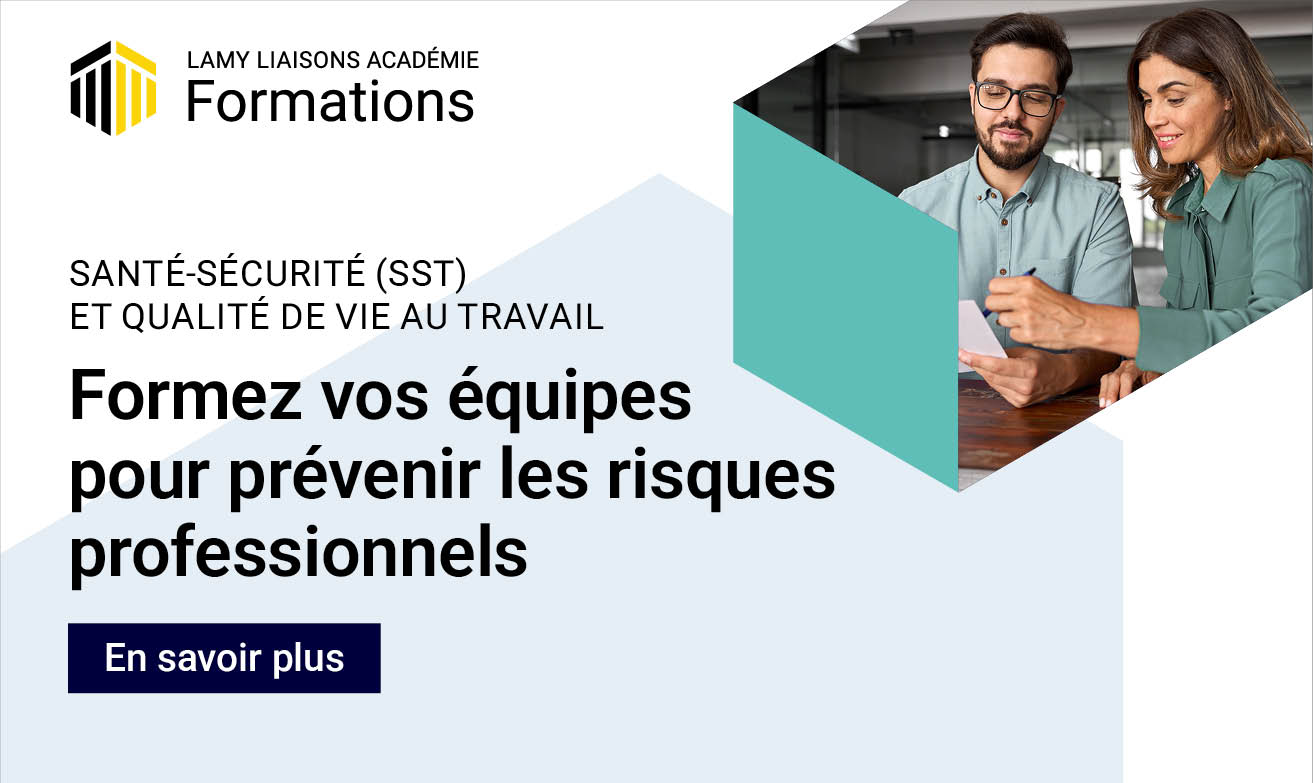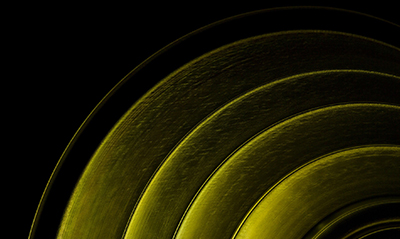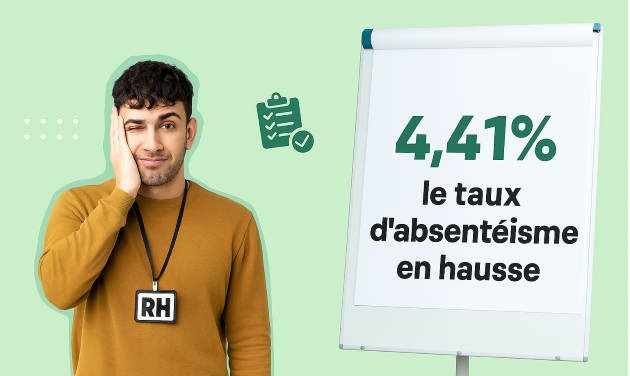L'étanchéité de toutes les surfaces d'un bâtiment exposées aux intempéries ainsi que leur isolation thermique implique de déposer des revêtements liquides en résine ou en bitume, des membranes bitumineuses,…sur des sols, sur des toits ou des façades nécessitant alors des travaux en hauteur : le métier d'étanchéiste comporte ainsi des risques à la fois chimiques et physiques.
L'étanchéité de toutes les surfaces d'un bâtiment exposées aux intempéries ainsi que leur isolation thermique implique de déposer des revêtements liquides en résine ou en bitume, des membranes bitumineuses,…sur des sols, sur des toits ou des façades nécessitant alors des travaux en hauteur : le métier d'étanchéiste comporte ainsi des risques à la fois chimiques et physiques. Des accidents par brûlures avec utilisation du chalumeau pour appliquer des matières bitumineuses en fusion, des troubles respiratoires par inhalation de vapeurs ou de particules et cutanés par contact, des chutes de hauteur depuis les toits, terrasses ou façades figurent parmi les risques spécifiques les plus graves des étanchéistes (ou étancheurs).
Mais les travaux d'étanchéité exposent aussi ce métier à de nombreux autres risques propres au BTP : l'activité s'exerce toujours à l'extérieur, donc au froid ou à la canicule, exposée aux rayons ultra-violets et au vent…, exige de soulever fréquemment de lourdes charges avec des postures de travail contraignantes, dans une position courbée et souvent en torsion, avec marche à reculons… La prévention des risques professionnels des étanchéistes (ou étancheurs) passe d'abord par une réflexion en amont sur l'organisation du chantier et sur son installation, le choix de produits et de procédés les moins dangereux, la mise en œuvre de moyens de protection individuels et collectifs, notamment pour le travail en hauteur en respectant les normes de sécurité (garde-corps…), la bonne utilisation des échelles et équipements de levage, des aides à la manutention etc...
A ces mesures de prévention, s'ajoutent le port impératif d'équipements de protection individuelle adaptés (vêtements, gants, masque et lunettes …) et une formation continue à la sécurité du travail et aux bonnes pratiques et gestes professionnels.
Les principaux risques des étanchéistes (ou étancheurs)
Les différents travaux de l'étanchéiste sont destinés à réaliser ou à restaurer l'étanchéité de tout type de bâtiment, résidentiel, tertiaire ou industriel, ou en revêtement de toute surface (parking, piscine…) à imperméabiliser et de permettre l'évacuation des eaux pluviales.
Il intervient sur les toitures, terrasses, acrotères et murs enterrés, façades, sous-sols des bâtiments tertiaires, des logements collectifs ou des maisons individuelles, ou sur des ouvrages d'art et de génie civil (ponts, tunnels, barrages, réservoirs…).
L'étanchéité est réalisée par application d'un revêtement continu imperméable suite à un nettoyage soigneux de la surface, et l'isolation thermique peut s'effectuer en même temps avec la pose de matériaux isolants après la première couche d'étanchéité. Les revêtements d'étanchéité sont constitués soit d'asphalte ou de résine de synthèse (polymères, élastomères thermoplastiques) élaborés sur place, soit de membranes bitumineuses préfabriquées collées ou soudées au chalumeau ou à l'air chaud. Les matériaux isolants sont constitués de panneaux en matières composites, de laine de verre ou de roche, ...
• Risques chimiques
Les produits utilisés par les étanchéistes comportent tous des risques chimiques, que ce soit les enduits d'imprégnation à froid, bitume en solution dans un solvant aromatique, répandus au balai, rouleau, raclette ou par pulvérisation, ou les enduits d'application à chaud obtenus par la chauffe de pains bitumineux dans un fondoir, répandus à la raclette, ou les feutres bitumineux, les plaques de laine de verre ou de roche, les membranes d'étanchéité, les bandes bitumineuses de renfort. De même, lorsqu'on enlève l'ancienne étanchéité par découpage et raclage, des vapeurs et des particules peuvent être émises.
Les produits des systèmes d'étanchéité liquide, utilisés par exemple dans les rampes de parking, contiennent des résines polymères polyuréthane, acrylique, polyester. Ces produits se présentent à l'état liquide ou pâteux à la mise en œuvre. Ils s'appliquent à froid ou à chaud en couches successives pour former, après séchage ou polymérisation, un système d'étanchéité.
La préparation mécanique du support peut être réalisée par sablage, rabotage, ou décapage avec jet Très Haute Pression, puis par repiquage, bouchardage pour remédier aux défauts de planéité à l'aide de mortier hydraulique ou de résine.
- Le bitume d'étanchéité génère d'abord la possibilité d'expositions cutanées, notamment aux Hydrocarbures Aromatiques Polycycliques (HAP), par contact direct avec le bitume et les vêtements ou outils souillés, pouvant provoquer des irritations de la peau. L'utilisation et la manipulation du bitume en fusion peut provoquer des irritations aux zones exposées mais également des troubles respiratoires, des irritations oculaires ou laryngo-pharyngées, lors du dégagement de fumées de bitume sous l'action du chalumeau. Par ailleurs, les fumées de bitume contiennent des substances cancérogènes probables (benzopyrène), ou possibles, et d'autres substances peuvent être mises en cause (naphtalène, polyaromatiques soufrés…) : toutefois, le bitume ou ses fumées ne sont pas classées comme cancérogènes, mais des études sont en cours pour évaluer une révision éventuelle de ce classement : les analyses du CIRC (Centre International de Recherche sur le Cancer ) n'ont en effet pas permis d'établir de lien entre l'exposition aux fumées de bitume et les différentes formes de cancers, et il n'y a pas de tableau de maladie professionnelle relatif aux bitumes à ce jour.
Alors que les relations entre cancers pulmonaires et exposition professionnelle aux bitumes n'ont pas été prouvées, l'exposition à ces fumées et aux ultraviolets, de même que la projection sur la peau de certains bitumes plus riches en hydrocarbures aromatiques polycycliques, peuvent être à l'origine de brûlures photo-toxiques, qui pourraient être par la suite à l'origine d'une cancérisation des zones brûlées.
La photo-toxicité des fumées du bitume est ainsi maximisée par l'utilisation de ces matières à l'extérieur, l'ensoleillement provoquant une réaction cutanée photochimique.
Par contre, dans les travaux en parkings couverts, c'est le confinement qui augmente la concentration atmosphérique en substances toxiques et les risques liés à leur inhalation.
Il existe une valeur limite d'exposition pour les fumées de bitume, fixée à 5 mg/m3 pour une durée d'exposition de 8 heures/jour, en pratique jamais atteinte car le taux d'exposition aux fumées de bitume lors de travaux d'étanchéité est beaucoup plus faible que lors de travaux routiers.
L'augmentation à l'exposition aux HAP est possible lors du recyclage de revêtements anciens au goudron ou d'utilisation du fondoir à bitumes à des températures trop élevées.
- Les fibres des laines d'isolation minérales de verre, de roche sont nocives par inhalation : elles sont responsables d'atteintes des voies respiratoires et lorsqu'une quantité importante de ces particules de poussière irritantes se logent dans le nez, elles peuvent causer une rhinite allergique ou une inflammation de la muqueuse nasale. Certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et à s'attaquer à la trachée et aux poumons, ou elles engendrent une inflammation des muqueuses de la trachée ou des bronches. L'inhalation constante dans les poumons de fibres peut causer une pneumopathie chronique et de l'asthme.
Les laines d'isolation provoquent aussi des irritations cutanées à leur contact qui se traduisent par des lésions plus ou moins importantes telles des rougeurs, des démangeaisons (prurit). Une dermite d'irritation, due à des contacts excessifs avec ces produits irritants, peut créer une prédisposition à l'urticaire et à l'eczéma.
Quant au risque cancérogène, les laines d'isolation sont classées en catégorie 3, c'est-à-dire substances préoccupantes pour l'homme en raison d'effets cancérogènes possibles, mais pour lesquelles les informations disponibles ne permettent pas une évaluation satisfaisante.
- Les colles et vernis d'adhérence ou d'imprégnation dans un mélange de solvants (xylène, toluène) qui doivent s'évaporer pour permettre la prise, génère des Composés Organiques Volatils (COV) provoquant des troubles neurologiques (céphalées, vertiges, agitation ou somnolence, …), des irritations pour les yeux et la peau et, aux fortes concentrations, des convulsions, des affections gastro-intestinales accompagnées de vomissements. Les résines des colles peuvent être à l'origine de dermatite de contact allergique (eczéma), avec sensibilisation progressive à ces produits de façon spécifique du fait de la multiplicité des contacts cutanés non protégés. Les isocyanates contenus dans les colles et résines primaires d'étanchéité, surtout en atmosphère confinée et/ou température ambiante élevée (augmentation de la concentration de vapeurs) constituent des facteurs de risque pour le développement d'un asthme et de dermatoses.
- L'exposition aux poussières d'amiante et de silice génère des risques de lésions pleurales, fibroses pulmonaires, cancer broncho-pulmonaire.
Le risque d'exposition à l'amiante existe dans les travaux de rénovation ou l'amiante se trouvent dans les plaques ondulées de fibrociment ou les produits de bardage dans les constructions datant d'avant 1978. Ce sont les opérations libératrices de fibres notamment le raclage qui sont les plus dangereuses.
Les différentes techniques de décapage mécanique (décapage à l'eau sous haute pression, sablage, hydro sablage, ponçage…) pour la préparation des supports, exposent à des aérosols de débris du revêtement et aux poussières des agents abrasifs utilisés : la présence, dans les vapeurs et brouillards générés lors du décapage, de particules toxiques telles que des poussières de revêtements pulvérisés par la projection abrasive contenant de la silice cristalline présente un risque respiratoire.
Toutes les poussières du chantier répandues par élimination des salissures et de la couche superficielle du revêtement, par le brassage d'air et le piétinement soulevant les particules tombées au sol, sont nocives par inhalation : elles sont responsables d'atteintes des voies respiratoires et lorsqu'une quantité importante de ces particules de poussière irritantes se logent dans le nez, elles peuvent causer une rhinite allergique ou une inflammation de la muqueuse nasale. Certaines particules très fines réussissent à traverser la cavité nasale et à s'attaquer à la trachée et aux poumons, ou elles engendrent une inflammation des muqueuses de la trachée ou des bronches.
- La toxicité cutanée du ciment est susceptible d'induire des problèmes dermatologiques pour les étanchéistes lors de l'utilisation de mortier hydraulique pour la réparation des supports. Les poussières de ciment peuvent être aussi responsables d'affections oculaires : conjonctivite, blépharoconiose ou blépharite (lésions de follicules pileux des cils de paupières).
• Risques physiques
Le travail en hauteur pour réaliser l'étanchéité des toits, balcons et terrasses, les températures élevées lors du travail au chalumeau, le travail à l'extérieur soumis aux aléas climatiques (froid ou canicule, vent et humidité), la manutention de lourdes charges, entrainent de nombreux risques physiques pour les étanchéistes.
- Les risques thermiques et de brulures ou des incendies de matières inflammables proches de la zone de travail ou des explosions dues à la présence de bouteilles de gaz peuvent survenir en présence du bitume en fusion et de l'utilisation du chalumeau. Le bitume en fusion peut monter jusqu'à 200 °C dans le fondoir : un déversement peut enflammer une charpente en bois et provoquer un incendie.
- Les risques liés aux postures et manutentions
Les postures de travail contraignantes (torsions, dos courbé, travail en équilibre instable, piétinement, travail accroupi ou à genoux …), des charges lourdes manutentionnées toute la journée (déplacement de rouleaux d'isolants, plaques bitumineuses, pains de bitume, bouteilles de gaz…) provoquent des hyper- sollicitations et entrainent des troubles musculo-squelettiques très fréquents à l'origine de nombreux accidents du travail.
Des aides à la manutention indisponibles ou insuffisantes, des manutentions manuelles non évitées par des mesures d'organisation appropriées, contribuent largement à la pénibilité physique et à la survenue de lésions articulaires et de lombalgies d'effort. Les lésions de la colonne vertébrale, les douleurs des poignets, des épaules, etc., ainsi que les traumatismes aux genoux et aux chevilles sont particulièrement fréquents chez les étanchéistes. - Les risques liés au travail en extérieur
Le travail en extérieur conduit les étanchéistes à être exposés aux ultraviolets (UV), aux intempéries, au froid ou à la chaleur, et à l'humidité. Ces conditions climatiques variables accentuent les risques liés aux postures de travail contraignantes et ne permettent pas de travailler en toute sécurité.
L'exposition fréquente aux UV peut être responsable de cancers de la peau, d'ophtalmies (brûlure de la cornée) particulièrement en altitude, et, en tout cas, d'érythème solaire (coup de soleil).
Les problèmes de santé dus à la chaleur et à l'action prolongée du rayonnement solaire sur la tête (effets de l'insolation, de la déshydratation…) génèrent des risques de malaise général, de crampes musculaires, de pertes de connaissance, qui peuvent être vitaux dans les cas extrêmes (coup de chaleur). Indirectement, le travail par fortes chaleurs augmente aussi les risques d'accidents du travail par la fatigue, la sudation, la diminution de la vigilance.
Pour des travaux en extérieur, le risque lié au froid est accru par une exposition au vent (refroidissement éolien) et à l'humidité. Le refroidissement des parties du corps peut provoquer des engelures, lésions cutanées qui deviennent rouge violacées, douloureuses, avec des crevasses et/ou des phlyctènes. Les mains et les pieds (surtout doigts ou orteils) ont tendance à se refroidir plus rapidement que le torse : l'exposition au froid est susceptible de déclencher le syndrome de Raynaud (doigts blancs et douloureux par vasoconstriction). Comme pour la chaleur, le froid entraine des risques indirects, favorisés par la diminution de la dextérité due au refroidissement des extrémités, à la diminution des performances musculaires et à l'incapacité à effectuer des mouvements fins. La vigilance mentale est également réduite en raison de l'inconfort causé par le froid. - Les risques de chute de hauteur
Les chutes de hauteur sont la source fréquente d'accidents graves, mortels dans certains cas. Le risque de chute de hauteur est évidemment inhérent aux métiers d'étanchéiste puisque le travail s'effectue en grande partie en hauteur sur des terrasses, balcons… avec des déplacements sur échelles, ...
Les causes des chutes de hauteur sont nombreuses :
o les accès en pente glissants,
o les obstacles de toute nature sur les plates-formes, passerelles ou planchers d'échafaudages surchargés et encombrés,
o les échelles mal entretenues, mal placées et/ou mal fixées, entrainant leur glissement ou renversement,
o le montage et démontage non conformes aux règles de sécurité des moyens de protection collective (filets de sécurité, points d'ancrage, lignes de vie…),
o les échafaudages vétustes, inadaptés, mal stabilisés,
o l'absence d'accès sécurisés, de garde-corps, de protections périphériques des plans de travail,
o l'absence de protection des balcons, …
o l'effondrement de la structure porteuse en construction ou en utilisation.
Les lésions causées par ces chutes sont habituellement graves (traumatismes crâniens, fractures du bassin ou de membres, …), exigeant de longues périodes de traitement et de convalescence, avec des séquelles pouvant être importantes, et dans certains cas, il s'agit d'accidents du travail mortels. - Les conditions d'utilisation des jets THP se caractérisent par une lourde charge physique : la pression et le débit élevés nécessitent de compenser continuellement l'effet de recul du pistolet, l'effort pour maintenir l'accessoire de projection et pour actionner l'organe de commande est permanent, les postures peuvent se révéler contraignantes dans un espace de travail restreint, de plus, il y a le risque de fouettement par rupture de flexible.
- Les travaux à proximité d'antennes relais exposent au rayonnement non ionisant des champs électromagnétiques : à part certains employés qui possèdent des dispositifs médicaux implantés qui sont particulièrement exposés à leur dysfonctionnement (stimulateur cardiaque…), il n'y a pas d'autres effets directs pathologiques significatifs à court terme, hormis ceux émanant de la sensibilité de chacun (nausées, vertiges, palpitations, effets visuels et nerveux) et ceux que ressentent les porteurs d'implants passifs (broches, plaques, prothèses de hanche…) réalisés dans des matériaux métalliques avec comme conséquence la sensation d'échauffement désagréable.
Les mesures de prévention des risques des étanchéistes (ou étancheurs)
Les moyens de prévention à mettre en œuvre pour pallier les risques professionnels des étanchéistes résident d'abord dans la prévention collective (organisation, installations, produits…) qui diminue fortement les expositions et la fréquence ces accidents, puis dans la prévention individuelle (équipements de protection) qui en diminue nettement la gravité, enfin dans la formation à la sécurité. La prévention collective concerne surtout le bon usage des installations de travail en hauteur, l'emploi de produits de substitution de moindre impact potentiel sur l'homme, des aides à la manutention et des outils adaptés, le respect des règles générales d'hygiène… Les différents risques professionnels doivent faire l'objet d'une évaluation pour permettre la rédaction du Document Unique de Sécurité (Décret du 5 novembre 2001) en appréciant à la fois l'environnement matériel et technique (outils, machines, produits utilisés) et l'efficacité des moyens de protection existants et de leur utilisation selon les postes de travail.
De manière aussi à ce que les salariés puissent être informés à propos des produits dangereux utilisés, les Fiches de Données de Sécurité (F.D.S.) doivent être mises à disposition et la connaissance de leurs risques expliquée au travers de la compréhension de leur étiquetage.
La vigilance des dangers chimiques auxquels sont exposés les étanchéistes est d'autant plus importante que la latence des effets nocifs respiratoires, leur caractère ténu au début de leur apparition, créent des conditions susceptibles de masquer longtemps la gravité de la situation.
• L'organisation du chantier
La première des mesures de prévention passe par une réflexion en amont sur l'organisation et l'installation du chantier : implantation, organisation des flux, circulation des opérateurs, et des approvisionnements.
La plupart des chutes de plain-pied et d'objets trouvent leur origine sur un chantier mal organisé et mal rangé.
A ce titre, le balisage, l'éclairage et la sécurisation des voies de circulation et des zones de stockage sont essentielles ainsi que le rangement en permanence du chantier (palettes, câbles, tuyauteries, matériaux et outils divers…) et la signalisation par des dispositifs visibles des obstacles de toute nature (antenne TV, lignes électriques aériennes…). Les ouvertures dans les surfaces de toits et les lucarnes doivent être protégées pour empêcher toute chute (recouvrement, garde-corps ou filet de recueil). La réduction de l'exposition des étanchéistes aux vapeurs de bitume ou de résine passe par de bonnes pratiques de mise en œuvre, comme par exemple travailler dos au vent.
La possibilité d'incendie nécessite d'assurer obligatoirement deux issues de repli aux opérateurs et de prévoir à proximité des extincteurs en nombre et en capacité suffisante.
Une bonne organisation du chantier permet aussi d'éviter des ports de charge et des mouvements répétés inutiles et d'avoir les matériaux à disposition et à la bonne hauteur, donc de réduire les risques physiques liés à la manutention. Le travail sur les chantiers d'étanchéité nécessite au préalable de prévoir le plan d'installation de chantier, d'assurer les vérifications des appareils, des moyens d'accès, des installations électriques.
En ce qui concerne l'exécution des travaux en hauteur, celle-ci doit s'effectuer en priorité à partir d'un plan de travail conçu, construit et équipé de manière à garantir la santé et la sécurité des travailleurs, et dans des conditions de travail ergonomiques (article R. 233-13-20 du Code du travail).
Des procédures de travail par temps chaud doivent être édictées et respectées de manière à réduire la contrainte thermique : absorption en quantité suffisante d'eau et de boissons renfermant des sels minéraux, rythme travail-repos aménagés en zone tempérée, débuter la journée de travail plus tôt. La fourniture d'eau potable suffisante sur le chantier est obligatoire (3 litres d'eau, au moins par jour et par travailleur (article R. 4534-143 du Code du travail) par temps caniculaire). Les intervalles de pause doivent prendre en compte les conditions atmosphériques (pluie, vent…).
Les moyens de prévention à mettre en œuvre pour pallier les risques professionnels des étanchéistes résident aussi dans les mesures organisationnelles visant à diminuer fortement le nombre de travailleurs exposés et la durée et l'intensité d'exposition.
Ces mesures concernent les zones de travail, leur accès et leur balisage, les modes opératoires limitant l'importance des manipulations et les efforts physiques qui augmentent la ventilation pulmonaire donc l'inhalation des vapeurs et des poussières.
Par ailleurs, des abris ou cantonnements doivent accueillir des vestiaires, des sanitaires et toilettes, voire des douches pour apporter les conditions d'hygiène nécessaires aux travailleurs. Des lavabos, postes de rinçage oculaire et des douches de sécurité doivent se trouver à proximité des postes de travail. Celles-ci permettent les mesures d'hygiène générale : lavage des mains fréquent avec moyens adaptés, douche en fin de poste... Loin d'être optionnelle, la présence de ces abris relève du domaine réglementaire (Code du travail, articles R4228). Le personnel doit avoir à sa disposition des vestiaires et des sanitaires correctement équipés et en nombre suffisant. Des vestiaires doubles doivent être mis à la disposition des travailleurs : l'entreposage des tenues de travail doit avoir lieu à l'abri de la poussière (le rangement des tenues de ville et des tenues de travail doit être séparé).
Il convient de limiter au strict minimum le nombre de travailleurs soumis au risque en restreignant l'accès des zones où se déroulent les activités et limiter la durée de travail de ces personnes dans les zones à risque. En particulier :
- Coordonner l'intervention des différents corps de métiers pour éviter leur présence simultanée sur le site, de façon à limiter le nombre de personnes susceptibles d'être exposées lors des tâches produisant des poussières et des fumées.
- Délimiter les zones d'utilisation à risque et apposer une signalisation claire d'avertissement et de sécurité.
• Le choix des produits, des machines et des procédés
La première étape consiste à repérer en particulier les agents chimiques cancérogènes ou dangereux dans le cadre de l'évaluation des risques du Document Unique de Sécurité (DUS). Les Fiches de Données de Sécurité (FDS), obligatoires pour tout produit chimique dangereux, comportent les renseignements relatifs à la toxicité des produits, donc notamment leur caractère cancérogène éventuel.
La suppression ou la substitution des produits cancérogènes ou dangereux est la mesure de prévention prioritaire qui s'impose : par exemple,
- Privilégier les produits sans bitume (le bitume doit être un matériau de moins en moins utilisé en terrasse), sans solvants en développant des produits exempts de Composés Organiques Volatils (COV) : remplacement des primaires solvantés par des primaires en phase aqueuse, suppression des solvants dans les résines d'étanchéité liquide.
- Proscrire l'utilisation de produits solvantés et les fondoirs dans les milieux confinés (parkings en sous-sol..), et choisir des revêtements sans bitume
• Le choix des procédés
- Mécaniser les opérations, par exemple utiliser les machines de soudage à l'air chaud pour les étanchéités.
- Supprimer de l'utilisation du chalumeau, en développant des systèmes d'étanchéité sans flamme : membranes d'étanchéité autocollantes, mise en œuvre à froid par autocollage, air chaud ou fixations mécaniques
- Aspirer les fumées et poussières lors de travaux en milieu confiné (sous-sols, parkings souterrains…).
- Dans le cas d'utilisation d'un fondoir, prévoir un capotage évitant les projections au chargement, un robinet de soutirage à fermeture automatique, un bac de rétention évitant tout écoulement ou débordement de bitume, une régulation thermique évitant que le bitume dépasse 230°C (le point éclair est de 260°C), éloigner les bouteilles d'alimentation en gaz du brûleur. Les fondoirs à bitume doivent être conformes à la norme NF P 93-331. Il faut respecter en particulier l'obligation de poser le fondoir à bitume dans un bac de rétention de capacité supérieure, permettant en cas de débordement de limiter la propagation du bitume à chaud.
- Privilégier les températures d'application d'asphalte les plus faibles 200°C, par ajout d'adjuvants.
• Les installations de travail en hauteur
Chaque fois que cela est possible, il est nécessaire de prévoir un maximum d'opérations au sol pour diminuer à la fois la charge à monter et le travail à réaliser en hauteur, afin de minimiser les occasions de risques de chute.
La prévention des chutes de hauteur est assurée par des dispositifs antichute dans les voies de circulation, protections périphériques temporaires, garde-corps fixés de manière sûre, rigides et résistants, surfaces de recueil tels des filets antichute au plus près de la structure.
Les échelles portables sont des outils exclusivement utilisés pour accéder à un niveau supérieur à défaut d'escalier ou d'échelle fixe ; c'est avant tout un moyen d'accès. Des mesures particulières de sécurité doivent être prises : l'échelle doit reposer sur des supports stables et résistants, leurs échelons ou marches doivent être horizontaux. Pour ne pas qu'elle glisse ou bascule, l'échelle est soit fixée dans la partie supérieure ou inférieure de ses montants, soit maintenue en place au moyen de tout dispositif antidérapant. L'échelle doit dépasser d'au moins un mètre le niveau d'accès.
Le choix de membranes d'étanchéité anti-glissance permet aussi de prévenir les chutes de plain-pied des étanchéistes.
• Les aides à la manutention
La manutention manuelle risque de rester importante et c'est pourquoi l'utilisation d'engins de levage et de manutention assistée doit être le plus systématique possible.
Les travaux d'étanchéité comportent en effet de nombreuses manutentions de charges lourdes qui entraînent des risques évidents de troubles musculo-squelettiques au niveau du dos et des articulations, qui peuvent être réduits par l'utilisation systématique de manutention assistée : treuils électrique de levage, monte-matériaux, potences, chariot porte-bouteilles, fondoir au sol équipé d'une pompe...
• La protection individuelle
Elle passe d'abord par le respect des règles d'hygiène personnelle : ne pas fumer, se laver les mains fréquemment (avec des savons, proscrire les solvants de type white-spirit) pour ne pas avoir les mains sales afin de ne pas ingérer par inadvertance un produit toxique, ne pas manger sur le lieu de travail, tenues de ville et tenues de travail distinctes et rangées séparément, boire de l'eau régulièrement et abondamment lors de fortes chaleurs, utiliser des crèmes protectrices des mains et des écrans solaires, prendre une douche après le travail.
Puis, pour travailler en toute sécurité, les étanchéistes doivent impérativement se protéger la tête, le corps, les mains, les voies respiratoires et les yeux et donc recourir impérativement à des équipements de protection individuelle communs, notamment adaptés aux conditions de travail à l'extérieur, ou spécifiques à certaines taches effectuées. Les équipements de protection individuelle des étanchéistes sont indispensables car les mesures de protection collectives précédentes ne suffisent absolument pas pour réduire suffisamment le risque d'exposition de travaux s'effectuant à l'extérieur.
- La protection du corps
Vêtements de travail ininflammables et intégrant une plaque protectrice amovible au niveau des genoux. Tenues de travail avec manches longues ajustées au cou, aux poignets et aux chevilles, adaptées aux travaux du bâtiment et aux conditions climatiques, à défaut des combinaisons à usage unique. - La protection des mains
Compte tenu des risques d'irritations cutanées, le port de gants, adaptés à chaque usage, est nécessaire : gants de manutention épais et renforcés pour la manutention, gants avec un revêtement intérieur en coton et des manchettes remontant haut sur les avants bras pour éviter la pénétration des produits à l'intérieur alliant la protection à la chaleur et la résistance aux produits pétrochimiques chauds. Il s'avère indispensable de porter des gants de protection adaptés à la tâche effectuée et au produit manipulé : il n'existe pas de gant de protection universel et il doit être adapté aux différents produits manipulés selon leur composition qui figure sur la Fiche de Sécurité (FDS). - La protection des yeux
Compte tenu des risques d'irritations et de projections oculaires, le port de lunettes équipées de protections latérales et anti UV est nécessaire. - La protection des voies respiratoires
La maîtrise des émissions de poussières lors des travaux de préparation des supports n'est jamais suffisante, et les étanchéistes doivent alors porter des masques anti-poussières fines de type FFP2, en papier ou cartonnés, légers, jetables, filtrant les particules (mais de durée d'efficacité limitée à quelques heures).
Il faut utiliser systématiquement des masques respiratoires à cartouche A2P3 pour les travaux en milieu confiné (filtre type P3 : protection pour les aérosols solides ou liquides). - La protection des pieds
- Chaussures ou bottes de sécurité antidérapantes, avec embout protecteur et semelle anti-perforation, avec semelle résistante à la chaleur et aux agressions chimiques
- Genouillères ou un pantalon à genouillère type « hygrovet » pour les travaux au sol.
• La formation à la sécurité
L'information et la formation des étanchéistes sur les risques et les techniques d'utilisation des équipements et des produits est absolument nécessaire pour diminuer de façon pérenne le niveau de criticité des travaux d'étanchéité :
- Formation à la sécurité des équipements (par exemple, pour l'utilisation des échelles, les techniques de levage),
- Formation PRAP (Prévention des Risques liés à l'Activité Physique) : l'OPPBTP a développé une démarche appelée ADAPT-BTP (Aide à la Démarche d'Amélioration des situations et des Postes de Travail) qui vise à prévenir les risques liés à l'activité physique. Il s'agit d'apprendre les bonnes postures de travail, les positions articulaires adéquates, en appliquant les principes de base de sécurité physique et d'économie d'effort.
- Formation sur le travail en hauteur,
- Formation à la lecture de l'étiquetage des produits,
- Formation aux premiers secours (en particulier pour les brulures),
- Formation aux risques chimiques, solvants, amiante, silice,...
• La surveillance médico-professionnelle
L'exposition à la silice, à l'amiante, aux solvants, bitume et résines impose une surveillance périodique des travailleurs au moins une fois par an (Surveillance Médicale Renforcée), instaurée par le médecin du travail, avec un suivi médical et toxicologique approprié obligatoire (analyses biologiques, radiographies pulmonaires et épreuves fonctionnelles respiratoires, …). Chaque salarié ainsi exposé à des produits chimiques dangereux ou cancérogènes doit faire l'objet d'une fiche d'exposition établie par l'employeur et bénéficier d'une surveillance médicale renforcée. A sa sortie de l'entreprise, il doit recevoir une attestation d'exposition qui lui permettra de continuer à se faire suivre médicalement.
Octobre 2012
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les avis des internautes
16/09/2020