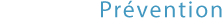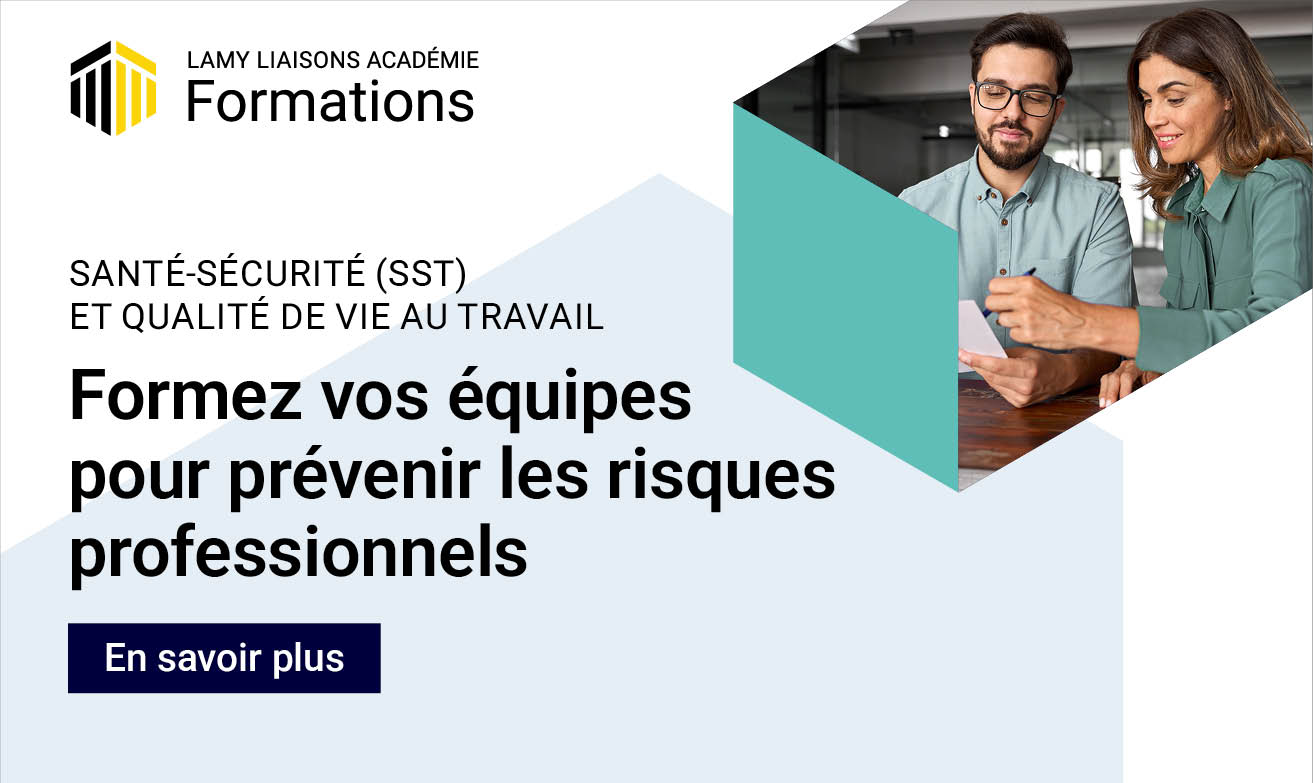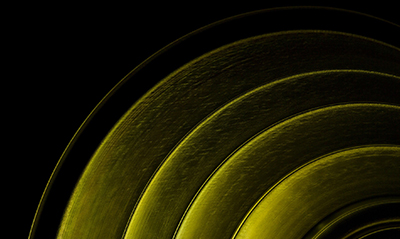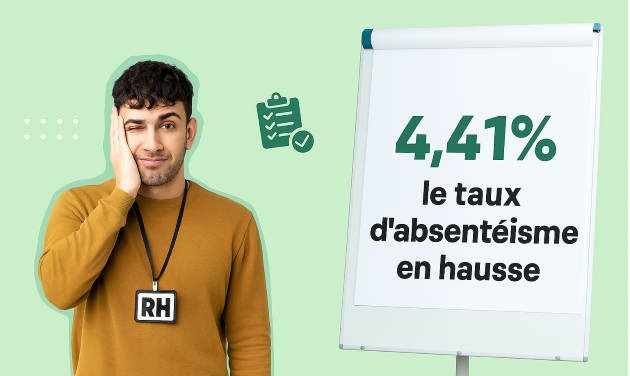La biotechnologie moderne concerne tout organisme vivant dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelle. Les risques professionnels, biologiques mais aussi chimiques, découlant de l'application des biotechnologies, y compris la gestion des déchets, peuvent affecter les travailleurs des biotechnologies et ces travailleurs sont particulièrement menacés lorsque les modes de transmission sont mal compris et que les équipements de protection collective ou individuelle ne sont pas adaptés ou disponibles.
La biotechnologie moderne concerne tout organisme vivant dont le matériel génétique a été modifié autrement que par multiplication ou recombinaison naturelle.
Les progrès du génie génétique ont permis le développement rapide des bio-industries : les biotechnologies représentent un enjeu économique majeur pour le futur en permettant des progrès remarquables en matière médicale (molécules à usage thérapeutique, thérapies géniques, vaccins), agricole (OGM), énergétique (biocarburants)… mais le génie génétique est une discipline très récente qui soulève des questions préoccupantes pour les personnes travaillant à l'élaboration de nouveaux produits et d'organismes génétiquement modifiés.
Le génie génétique apporte des possibilités de progrès tellement remarquables en médecine, en agriculture, en pharmacie et chimie fine, en production d'énergie, en dépollution des sols et des eaux, dans certaines applications agro-industrielles, qu'un développement rapide de la recherche, de la production et de l'utilisation de ces produits est certain, avec toutes ses promesses mais aussi tous ses risques environnementaux, sanitaires et professionnels.
Les risques professionnels, biologiques mais aussi chimiques, découlant de l'application des biotechnologies, y compris la gestion des déchets, peuvent affecter les travailleurs des biotechnologies et ces travailleurs sont particulièrement menacés lorsque les modes de transmission sont mal compris et que les équipements de protection collective ou individuelle ne sont pas adaptés ou disponibles. Il convient de mettre au point des évaluations et des mesures de contrôle appropriées des risques ainsi que de meilleurs outils pour la détection des risques des biotechnologies afin d'améliorer leur prévention, tout en sachant que la problématique de la charge de la preuve du rapport de cause à effet est difficile et coûteuse.
Les risques professionnels des biotechnologies
La biotechnologie utilise des systèmes biologiques, des organismes vivants ou leurs dérivés pour fabriquer ou modifier des produits ou des procédés : à ce titre, la fermentation traditionnelle de la bière, du pain, du fromage à l'aide de levures … fait partie des biotechnologies mais les biotechnologies nouvelles procèdent différemment, en franchissant les barrières naturelles de la physiologie de la reproduction : l'extraction de gènes précis issus d'organismes ou de cultures cellulaires et leur intégration dans une autre cellule, ou la fusion cellulaire d'organismes n'appartenant pas à une même famille taxonomique, franchit les barrières naturelles de la physiologie et la création artificielle d'organismes vivants ou de leurs dérivés est alors source de risques potentiels pour la santé humaine. Le risque biologique est généré par l'usage de vecteurs viraux ou bactériens introduisant les gènes vers leur cellule cible, par la présence de nouveaux microorganismes pathogènes ou allergènes virulents pour l'homme, et la gestion des déchets contaminés peut également constituer un problème sanitaire sérieux.
Par ailleurs, la fabrication de produits issus des biotechnologies implique l'utilisation constante de nombreuses substances chimiques, solvants, réactifs, colorants, …, qui peuvent parfois être utilisées à de très fortes concentrations et qui sont de nature à mettre en danger la santé ou la sécurité des opérateurs.
- Les risques biologiques des biotechnologies
Les risques professionnels liés aux techniques du génie génétique sont difficiles à évaluer a priori, car chacun des éléments mis en œuvre (l'organisme donneur, l'hôte, le vecteur et le fragment d'ADN inséré) et leur combinaison aboutissent à un organisme génétiquement modifié avec une multitude de possibilités de recombinaisons génétiques.
Les risques pour les travailleurs sont de nature biologique et allergique et sont induits par les modifications génétiques qui peuvent créer de nouvelles substances à la toxicité inconnue ou augmentée.
Dans la biotechnologie traditionnelle, on sait que le contact avec des levures peut provoquer une réaction allergique de la peau sous forme d'un eczéma et que les poussières contenant des parasites (acariens…) ou micro-organismes (moisissures…) peuvent être responsables de fréquentes réactions allergiques : de nombreux pneumallergènes sont retrouvés dans les poussières des lieux de travail, particulièrement les endotoxines des bactéries et des toxines fongiques de spores dont le rôle majeur dans l'inflammation de l'arbre respiratoire explique l'apparition de bronchites chroniques.
Dans la biotechnologie moderne, les risques nouveaux supplémentaires sont difficilement évaluables, exceptés pour le cas où la transgénèse provient d'une espèce connue pour ces effets allergiques. L'évaluation des risques allergiques est basée sur les similitudes structurales du produit de la transgénèse et les allergènes connus, et il faut développer la biovigilance pour mieux connaître et réduire le risque.
On peut craindre aussi une augmentation non prévue de la virulence de l'agent biologique modifié : l'incertitude existe avec un risque potentiel par exemple dans le transfert de gène dans les cellules bactériennes : la plupart des micro-organismes sont inoffensifs mais certains nouveaux micro-organismes génétiquement modifiés pourraient déclencher une infection, une allergie ou une intoxication ou avoir un caractère cancérogène. L'évaluation des risques prend en compte également les conditions de manipulation des agents biologiques (quantités manipulées, matériel utilisé, gestuelle…). - Les risques chimiques des biotechnologies
Dans les synthétiseurs et les cuves, lors du changement de réactifs, aux postes de purification et de préparation des gels, les travailleurs dans les laboratoires de biotechnologies ou dans les ateliers des bio-industries sont exposés à de multiples produits chimiques toxiques, par voie respiratoire, cutanée ou digestive.
La manipulation d'un ensemble de substances chimiques qui entrent dans la composition des préparations et des réactifs, induit :
- soit des risques aigus et immédiats dus à de fortes expositions (fuites, bris de flacons ou de bouteilles, …),
- soit des risques chroniques et tardifs dus à de faibles expositions, mais répétées (contenants et béchers ouverts…).
Si pour les effets aigus, le rapport de causalité est clairement identifié et assez facilement mesurable, il n'en est pas de même pour les effets chroniques qu'il est beaucoup plus malaisé de cerner avec précision, et ils sont plus fréquents.
Les effets peuvent être réversibles ou irréversibles : dans le premier cas, il y a totale récupération qui dépend évidemment du paramètre temps, dans le second cas, il y a des dommages définitifs. Les effets toxiques engendrés par la mutagenèse, la cancérogenèse, la tératogenèse, la sensibilisation allergique, la neurotoxicité sont généralement irréversibles et le dommage persiste même après la disparition du toxique et l'accumulation des effets aggrave la pathologie au cours du temps.
Les produits utilisés se présentent sous forme de principes de base actifs, catalyseurs, mais aussi des solvants, excipients, adjuvants, colorants et des désinfectants divers pour assurer l'hygiène des locaux et matériels :
- acides corrosifs (trifluoroacétique TFA, peracétique..),
- bases caustiques (ammoniac…),
- produits inflammables (solvants, alcools),
- solvants neurotoxiques, cancérogènes possibles
- colorants cancérogènes
- Les oxydants (agents chlorés…) utilisés pour leur propriétés désinfectantes des surfaces de travail sont à l'origine de dermites irritatives, notamment avec l'eau de Javel.
Les solvants organiques d'extraction utilisés dans les biotechnologies (dichlorométhane DCM, perchloréthylène, diméthylformamide DMF, dichloroéthane, acétonitrile …) affectent des organes cibles divers : irritations et brulures (DCM, DMF…) de la peau, des yeux et de la gorge, lésions des organes respiratoires (perchloréthylène), et presque tous les solvants organiques provoquent des troubles digestifs (nausées, …), du système nerveux central et périphérique, des maux de tête, des vertiges.
- Par leur action liposoluble, tous les solvants peuvent provoquer une dessiccation cutanée avec risque dermatites pour des contacts avec la peau répétés et prolongés.
- La toxicité sur le système nerveux central peut prendre la forme d'une narcose brutale et intense pour une forte exposition.
- Plusieurs solvants sont susceptibles de provoquer des hépatites lors d'inhalations ou ingestions massives : diméthylformamide (DMF) et … l'éthanol !
- Les effets reprotoxiques causés par les solvants peuvent produire ou augmenter la fréquence d'effets non héréditaires dans la progéniture (embryotoxiques ou foetotoxiques), ou porter atteinte aux fonctions ou capacités reproductives…. Par exemple, l'exposition aux solvants organiques, qui passent à travers la barrière placentaire, est spécialement dangereuse et concernent de nombreuses travailleuses féminines dont les laborantines : l'exposition à ceux-ci est tout particulièrement dangereuse chez la femme enceinte car ils peuvent aussi entraîner des malformations congénitales ou perturber la grossesse et le développement du fœtus (risque tératogène et d'intoxication fœtale) en franchissant la barrière placentaire.
- Le diméthylformamide (DMF), le dichlorométhane (DCM), le dichloroéthane, sont des cancérogènes et mutagènes possibles (classe 2B du CIRC).
Les gels de polyacrylamide pour réaliser des électrophorèses pour la séparation de molécules peuvent exposer à l'acrylamide, cancérigène possible, neurotoxique et reprotoxique.
Le formaldéhyde (formol), composé organique très volatil présent dans les laboratoires et ateliers de biotechnologie est très irritant et souvent responsable de réactions allergiques (asthme, rhinite) et de possibles cancers du nasopharynx.
Certains colorants, réactifs, catalyseurs utilisés dans les biotechnologies (pyridine, methylimidazole, benzidine …) sont aussi des substances toxiques avérées.
Les mesures de prévention des risques professionnels des biotechnologies
L'essentiel de la prévention consiste à supprimer ou employer des produits chimiques de substitution de moindre impact potentiel sur l'homme et l'environnement, à éviter la pénétration des agents biologiques dans l'organisme humain par des mesures d'hygiène et techniques, à diminuer la dispersion des produits biologiques ou chimiques sur le lieu de travail et dans l'environnement, en respectant des gestes et les règles de confinement, de ventilation et de stockage adaptés et en inactivant les déchets.
Ces mesures sont d'autant plus indispensables que de multiples cultures cellulaires et vecteurs viraux, de nouvelles substances biologiques compliquent l'évaluation des risques et rendent la prévention des risques professionnels particulièrement délicates dans les laboratoires et industries de génie génétique.
Les ateliers des usines et laboratoires des biotechnologies doivent faire l'objet d'une analyse poussée des risques pour permettre la rédaction du Document Unique de Sécurité en appréciant à la fois l'environnement matériel et technique (outils, machines, produits utilisés) et l'efficacité des moyens de protection existants et de leur utilisation selon les postes de travail.
Les analyses de risques sont confiées à des spécialistes de la sécurité au travail (hygiéniste, ingénieur sécurité). Les rapports d'intervention et de maintenance seront aussi intégrés à la documentation de sécurité au travail de l'entreprise et communiquées au médecin du travail et au CHSCT. Les salariés doivent être aussi informés à propos des produits dangereux mis en œuvre et formés aux pratiques professionnelles sécuritaires. Les Fiches de Données de Sécurité (FDS), obligatoires pour tout produit chimique dangereux, comportent les renseignements relatifs à la toxicité des produits. Par ailleurs, une surveillance médicale renforcée est obligatoire pour les salariés exposés aux risques biologiques ou chimiques.
- La réglementation relative aux biotechnologies
La loi 2008-595 du 25 juin 2008 relative aux organismes génétiquement modifiés et aux mesures techniques de prévention, notamment de confinement, relève du Code de l'environnement et a été suivie des arrêtés suivants :
- Arrêté du 28 mars 2012 relatif au dossier technique demandé pour les utilisations confinées d'organismes génétiquement modifiés prévu aux articles R. 532-6, R. 532-14 et R. 532-26 du code de l'environnement ;
- Décret n° 2011-1177 du 23 septembre 2011 relatif à l'utilisation confinée d'organismes génétiquement modifiés
Tout laboratoire, public ou privé, qui met en œuvre des micro-organismes génétiquement modifiés à des fins de recherche, de développement ou d'enseignement doit soumettre une demande de classement de ces activités au ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, qui l'instruit et qui la transmet au Haut Conseil des biotechnologies (HCB) et l'agrément est délivré pour une durée de 5 ans au plus pour l'utilisation agréée.
Il ne peut pas y avoir de listes de micro-organismes génétiquement modifiés puisque, en théorie, il y a une infinité de possibilités de recombinaisons génétiques.
Les niveaux de risques définis et les niveaux de confinement correspondants sont répartis en deux groupes :
- le groupe I correspond à des organismes et micro-organismes génétiquement modifiés non pathogènes (classe 1). Il ne présente aucun danger pour l'individu et l'environnement.
- le groupe II (classe 2,3 et 4) correspond à l'ensemble des autres organismes et micro-organismes, avec un risque croissant allant de 2 à 4. - La suppression / substitution des produits dangereux
La prévention la plus efficace est la prévention primaire avec la mise en place de technologies qui permettent des actions sur les produits (suppression ou emploi de produits de substitution de moindre impact potentiel sur l'homme et l'environnement) et/ou des actions sur les procédés (emploi de matériels ou de machines supprimant ou limitant au maximum les impacts sur l'environnement : très faibles rejets atmosphériques et volumes de déchets et d'effluents générés les plus faibles possibles).
La première étape consiste à repérer les produits cancérogènes ou dangereux dans le cadre de l'évaluation des risques du Document Unique de Sécurité (DUS). Les Fiches de Données de Sécurité (FDS), obligatoires pour tout produit chimique dangereux, comportent les renseignements relatifs à la toxicité des produits, donc notamment leur caractère cancérogène éventuel.
L'utilisation de certains solvants, colorants … est désormais interdite. La législation évolue en fonction des résultats des études toxicologiques qui peuvent être très longues car, si pour la toxicité aigue, le rapport de causalité est clairement identifié et assez facilement mesurable, il n'en est pas de même pour la toxicité chronique qui est beaucoup plus malaisée à cerner avec précision.
Des fiches d'aide à la substitution sont disponibles sur le site de l'INRS. - Les mesures techniques de prévention sont représentées à l'échelle du poste de travail dans les laboratoires par le PSM (poste de sécurité microbiologique) et à l'échelle des locaux par le confinement, la ventilation et le stockage des produits.
- Les Postes de Sécurité Microbiologique (PSM), utilisés dans les conditions requises, assurent la protection de l'opérateur et de l'environnement contre les dangers liés aux aérosols dans la manipulation de substances biologiquement actives, infectées ou dangereuses.
Il existe trois types de PSM en fonction des objectifs de protection souhaités.
Les filtres utilisés sont considérés comme des déchets biologiques et doivent être traités comme tels.
- Le niveau de confinement
Le confinement a pour objectif de protéger les travailleurs d'un risque présent dans l'air, micro-organismes pathogènes mais aussi vapeurs et gaz toxiques, et d'éviter qu'ils se diffusent à l'extérieur de la zone où ils sont utilisés.
Ce confinement est lié à toute opération au cours desquelles des organismes sont génétiquement modifiés ou au cours desquelles des organismes génétiquement modifiés sont cultivés, mis en œuvre, stockés, transportés, détruits, éliminés : ces mesures de confinement spécifiques sont prises pour limiter le contact de ces organismes génétiquement modifiés avec les travailleurs et l'environnement.
D'une manière générale, pour prévenir le risque infectieux dans un laboratoire, la manipulation des micro-organismes nécessite un niveau de confinement équivalent au groupe de classification des agents pathogènes identifiés ou suspectés d'être présents.
L'ensemble des mesures de protection (locaux, équipements, bonnes pratiques) doit être cohérent avec le niveau de confinement qui va de 1 à 4 en fonction du niveau du risque.
Les mesures techniques de confinement concernent la conception des locaux et les aménagements (locaux en dépression, traitement de l'air par ventilation et climatisation, conteneurs adaptés pour les produits souillés), mais aussi le respect de règles comportementales de sécurité (tenue, ouverture des portes, gestion des déchets, stockage réglementaire des produits dangereux).
Les panneaux d'avertissement avec un pictogramme de forme triangulaire sur fond jaune signalant le risque biologique sont obligatoires dans tout laboratoire à partir de niveau de confinement 2.
NIVEAU DE CONFINEMENTLOCAUXEQUIPEMENTSBONNES PRATIQUESL1Local isolé par une porte et des fenêtres fermées. Paillasses, murs et sols lisses et facilement lavablesAutoclaves dans le bâtimentVêtements de protection, paillasse propre et rangéeL2Accès règlementé pour les personnels autorisés, fermeture hermétique pour fumigation (facultatif), lavabos à commandes non manuelles, autoclaves dans le bâtiment.Poste de sécurité microbiologique (PSM).
Centrifugeuses sécurisésVêtements de protection (blouse, gants, lunettes), boîtes type tirelire incassable, matériel jetable, inactivation du matériel contaminé (eau de javel à 12°Chl, alcool à 70°) et des déchets.L3Les mêmes dispositions qu'en L2 ainsi que sas, filtration de l'air entrant et sortant, oculus, interphone (facultatif), pression négative avec système d'alarme, groupe électrogène, douche (facultatif).PSM de type II Autoclave à double entréeLes mêmes dispositions qu'en L2 ainsi que surbottes +surblousesL4Les mêmes dispositions qu'en L3 ainsi que système de ventilation secourue et interphone obligatoire, double sas, douche obligatoirePSM de type IIILes mêmes dispositions qu'en L3 ainsi que scaphandre
- La ventilation générale et l'aspiration à la source
Les multiples risques chimiques que présentent les biotechnologies ont conduit à de nombreuses réglementations, aboutissant à un ensemble complexe de mesures pour répondre aux normes d'exposition professionnelle.
La ventilation et l'aération des lieux de travail jouent un rôle essentiel pour limiter la concentration de l'ensemble des toxiques dans l'air ambiant et les évacuer des lieux de travail, de façon à respecter ces valeurs limites et éviter ainsi les conséquences sur la santé des travailleurs. Une ventilation et un appoint d'air appropriés sont aussi indispensables pour empêcher l'accumulation de mélanges inflammables dans l'air. Il est indispensable de limiter dans les ateliers la quantité de poussières, de vapeurs, sans aucune recirculation de l'air pollué, c'est à dire avec évacuation hors du milieu de travail. Pour ce faire, un système de ventilation générale d'une part et locale d'autre part à l'aide de captation à la source des vapeurs doivent impérativement être mises en œuvre, ainsi qu'un procédé en système clos lorsque c'est techniquement possible (ce qui n'est pas néanmoins une protection absolue du fait des fuites éventuelles et des ouvertures des appareils) : il convient d'assurer une concentration dans l'atmosphère de l'atelier la plus basse possible et pour éviter en tout cas l'exposition des travailleurs à une concentration supérieure à celle des limites de sécurité (valeurs limites et moyennes d'exposition VLE et VME). Il faut dimensionner les systèmes de ventilation et d'extraction avec des débits suffisants capables d'assurer en permanence une aération minimale afin d'éviter l'accumulation de substances nocives et les éventuelles fuites de gaz…, et d'évacuer les odeurs désagréables et les condensations.
Enfin, pour limiter les émanations et évaporations à l'air libre, les récipients doivent disposer d'un couvercle bien refermé après usage, ainsi que les bidons et autres conteneurs et cuves de produits chimiques.
• La ventilation générale repose sur une extraction et soufflage de l'air avec un système de collecte par des ventilateurs, avant son rejet à l'atmosphère après épuration dans des filtres : l'air est transporté dans le local par un ventilateur de soufflage et extrait du local par un ventilateur d'évacuation. L'extraction de l'air se fait grâce à un système de collecte par ces ventilateurs, des gaines de diffusion, et un réseau de conduits qui captent et concentrent les poussières et vapeurs jusqu'aux filtres et aux épurateurs qui permettent de nettoyer l'air, puis de l'évacuer à l'extérieur. Les composants aérauliques comme les ventilateurs, les conduits entre autres doivent être accessibles et faciles d'entretien et de nettoyage. En particulier, les réseaux s'encrassent rapidement avec de filtres hors d'usage, une évacuation des condensats obstruée…
• La ventilation locale repose sur des systèmes de captage des gaz et poussières au plus près de leur point d'émission, avant leur dispersion dans le local, au droit de tous les points de transfert ouverts : hottes aspirantes ou buses d'aspiration au dessus des malaxeurs, des balances de pesée et des bacs et cuves, des autoclaves, des zones de stockage, sorbonnes au laboratoire adaptées au besoin de la tâche (pesée, réaction) pour les produits volatils toxiques par inhalation ou pour toute réaction susceptible de dégager des gaz dangereux… La ventilation générale des ateliers doit être déterminée en fonction des aspirations locales pour ne pas perturber l'efficacité des captages à la source.
• avec surveillance régulière de l'atmosphère, pour vérifier l'efficacité des mesures d'aspiration par dosages atmosphériques. Ces analyses métrologiques sont confiées à des spécialistes de la sécurité au travail (hygiéniste, ingénieur sécurité). Les rapports d'analyses, d'intervention et de maintenance seront intégrés à la documentation de sécurité au travail de l'entreprise (Document Unique de Sécurité).
• Le travail en vase clos, avec de machines fermées avec chambre de travail étanche, autorise le confinement maximal des substances utilisées, tout contact entre les opérateurs et les produits concernés pouvant être évité à chaque opération, avec automatisation de la plupart des taches.
- Un stockage des produits chimiques rigoureux
Le stockage des produits chimiques présente des risques tels que l'incendie, l'explosion, le risque de chute ou de renversement ou de détérioration d'emballage … Toutes ces caractéristiques rendent nécessaire, outre les précautions lors de leur emploi, l'aménagement de locaux de stockage, avec des rayonnages métalliques, des planchers et des palettes normalisées. La réduction des risques existants passe par une réflexion sur la structure du local, sur les modalités de rangement et sur les incompatibilités entre les produits. Des procédures de stockage non adaptées peuvent entraîner une fragilisation des emballages à l'origine de fuites ou de ruptures accidentelles, de pollution, de réactions dangereuses ou d'accidents ou induire une modification ou une dégradation des produits qui le rendent plus dangereux car ils peuvent libérer des vapeurs inflammables ou nocives.
L'empilement doit être stable et sa hauteur ne doit pas affecter l'intégrité des emballages.
Le stockage des bidons et autres sacs ou récipients, doit se faire dans un local ventilé par un système de ventilation mécanique, à l'abri de la chaleur et de l'humidité, et tous les conteneurs de produits chimiques doivent toujours être bien refermés.
Les matériels de stockage doivent disposer de capacités de rétention pour prévenir et maîtriser les fuites accidentelles de liquides polluants : bacs de rétention et conteneurs pour fûts et petits récipients, armoires de sécurité…
L'installation électrique du local de stockage est à réaliser avec du matériel utilisable en atmosphère explosible.
Une bonne tenue des sols des locaux de stockage est essentielle pour éviter l'accumulation des matières déversées.
L'interdiction de fumer dans les locaux doit être absolument respectée et signalée de manière apparente (de même que toutes les autres consignes de sécurité).
Il faut stocker les plus faibles quantités de produits possibles car le risque d'incident ou d'accident croît avec la durée et le volume de stockage. - Les mesures individuelles de prévention
Les équipements de protection individuelle sont nécessaires pour réduire le risque d'exposition non totalement éliminé par les mesures de protection collectives précédentes, ou lorsque les mesures de prévention technique ne suffisent pas dans le cas d'incidents.
La prévention individuelle repose sur le port d'équipements de protection individuelle (EPI), adaptées au poste de travail : gants (latex, nitrile, vinyle), masques, masques à visière anti-projections, blouses, surblouses, surbottes, lunettes de sécurité. Le choix des équipements de protection du corps, des mains, des yeux ou du visage, est fait en fonction des produits manipulés et des opérations spécifiques.
- Le port d'une blouse ou combinaison, en coton ou en matière non inflammable, doit couvrir le corps et les bras et les effets personnels de manière à ce que le personnel ne soit pas en contact avec les produits et se protège contre les diverses projections et cette tenue vestimentaire est, selon les niveaux de protection :
• mise à l'entrée de la salle technique, portée fermée et enlevée à la sortie de la salle technique ou
• mise dans les placards des vestiaires à double compartiment : un côté pour la tenue de ville, un côté pour la tenue de travail.
- Le port de gants à usage unique est nécessaire pour toute manipulation présentant des risques d'exposition par contact avec des échantillons potentiellement contaminés (remplissage de capillaire, …). Ce risque de contamination est augmenté s'il existe de plaies ou micro-coupures sur les mains.
Il est nécessaire aussi pour toute manipulation présentant des risques d'exposition par contact mains-bouche avec des échantillons potentiellement contaminés par des agents biologiques entraînant des pathologies digestives. Les gants doivent être enlevés après la manipulation à risque et avant tout contact avec du matériel "propre" afin d'éviter de contaminer ce dernier.
L'emploi d'agents désinfectants, corrosifs, caustiques, la manipulation de verreries, nécessite des mesures de protection indispensables des mains, particulièrement lors de la dilution des produits concentrés et les transvasements.
Il s'avère indispensable de porter des gants de protection adaptés à la tâche effectuée et au produit manipulé. Il n'existe pas de gant de protection universel. Le type de gants conseillé, imperméables, à longues manchettes, pour éviter la pénétration des produits à l'intérieur, doit être adapté aux différents produits utilisés selon leur composition qui figure sur la Fiche de Sécurité (FDS). Il existe des gants de qualité supérieure pour le laboratoire et les salles propres.
- Le port de lunettes de protection est nécessaire pour toute manipulation présentant des risques d'exposition par projection d'échantillons potentiellement contaminés. Il convient de se protéger les yeux en portant des lunettes de sécurité enveloppantes dans les laboratoires, ou pour les opérations (prise d'échantillons, interventions sur les machines ou équipements) où des risques de projection sont possibles pour éviter les projections oculaires.
Le port de lentilles est déconseillé car cela augmente le risque en cas de projection oculaire, le produit restant au contact avec les yeux du fait de la présence des lentilles.
L'utilisation d'écrans de protection ou de masques à visière (polycarbonate) pour toute réaction inconnue présentant des risques potentiels doit être envisagée.
- Le port de masques de protection respiratoire est nécessaire pour toute manipulation présentant des risques d'exposition par inhalation d'aérosols provenant d'échantillons potentiellement contaminés par des agents biologiques entraînant des pathologies respiratoires ou lors du changement et rassemblement des réactifs. L'usage des masques ne peut s'envisager que pour des manipulations ponctuelles de courte durée.
Il est également nécessaire d'acquérir une gestuelle bien maîtrisée et respecter les bonnes pratiques : pas de pipetage à la bouche mais utilisation de poires aspirantes diverses ou seringues lors de l'aspiration de liquides, recapuchonnage des aiguilles après prélèvement, utilisation de hottes lors de la manipulation de produits dangereux et/ou contaminants, nettoyage des plans de travail et des appareillages avec respect des durées d'action des désinfectants et des décontaminants, lavage des mains après chaque manipulation (avec lavabos et distributeurs de savon à commande non manuelle). Il faut éviter tout particulièrement la création d'aérosols (centrifugation, agitations,...) en manipulant au calme et en milieu confiné. - Une surveillance médicale renforcée
Pour les travailleurs exposés aux produits chimiques dangereux et aux agents biologiques, il faut effectuer une traçabilité au travers de la rédaction d'une fiche d'exposition et d'une surveillance médicale régulière, à visée de dépistage, réalisées par le médecin du travail. A sa sortie de l'entreprise, le travailleur exposé doit recevoir une attestation d'exposition qui lui permettra de continuer à se faire suivre médicalement.
Les modalités générales de la surveillance des travailleurs exposés à des agents chimiques dangereux sont les suivantes :
- Suivi médical et toxicologique régulier, au moins annuel (exemples : tests respiratoires, hématologiques, allergiques …).
- En cas d'anomalie, tout le personnel concerné doit bénéficier d'un examen médical.
- Fiche d'aptitude avec mention de l'absence de contre-indications médicales à l'exposition au risque après étude du poste de travail.
- Le dossier médical doit stipuler la nature du travail effectué, la durée des périodes d'exposition et les résultats des examens médicaux. Ces informations sont indiquées dans l'attestation d'exposition et le dossier médical doit être conservé après la cessation de l'exposition. - La formation et l'information du personnel
La formation, par un organisme agréé, sur les dangers des produits utilisés et sur les moyens de se protéger, est indispensable : par exemple, comprendre les étiquettes du contenant des produits, connaître l'attitude à adopter en cas de fuite ou de déversement accidentel, savoir utiliser les E.P.I adéquats, formation aux premiers secours et incendie…
Pour aller plus loin
- Les risques liés aux techniques de génie génétique en laboratoire : édition INRS ED 6131, 2012, 32 pages.
Mars 2014
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.