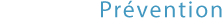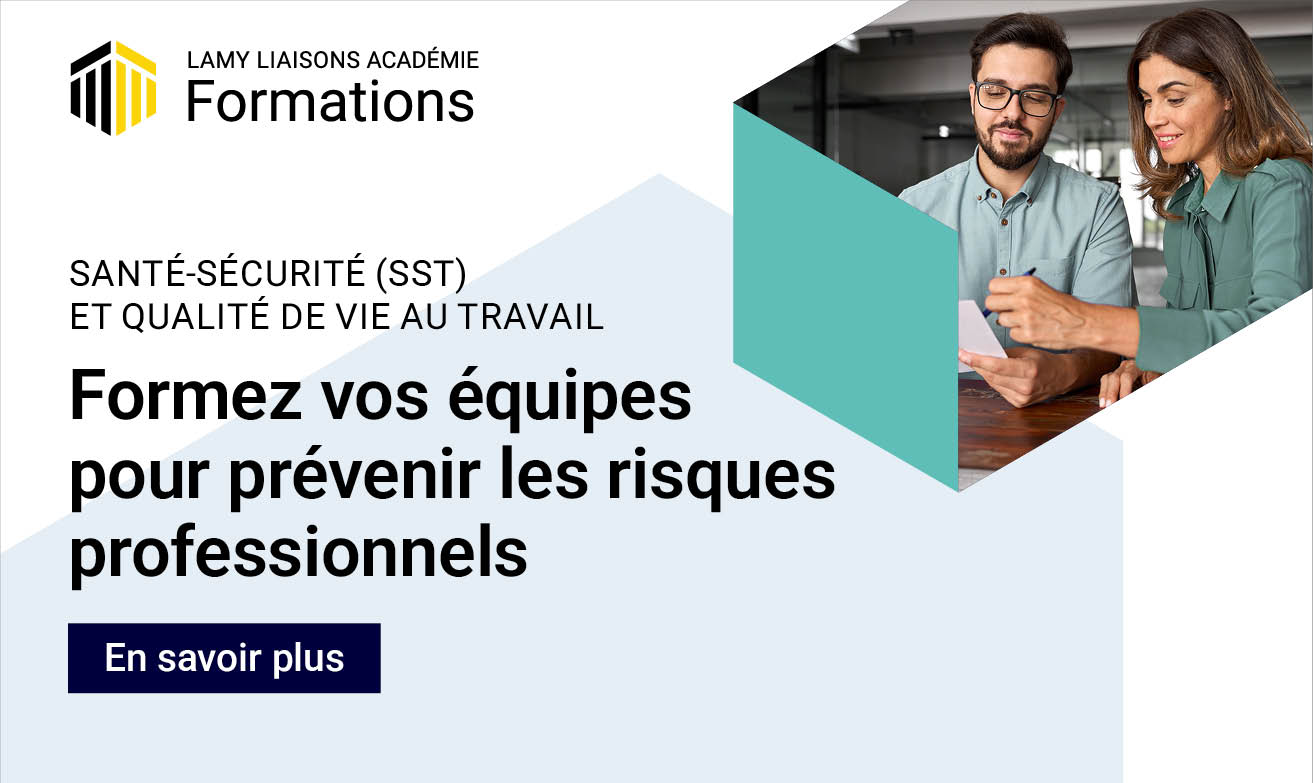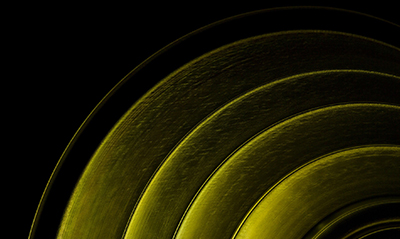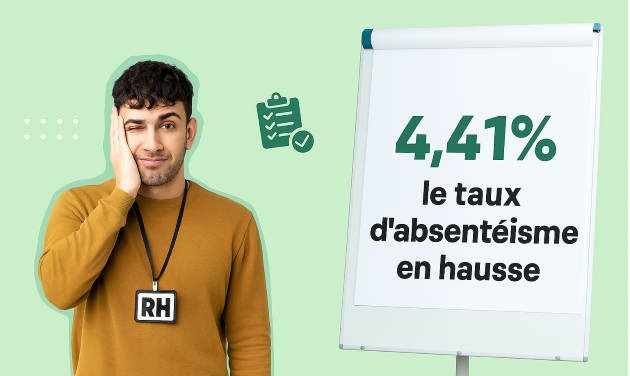L'utilisation de produits phytosanitaires pour la protection contre les parasites en agriculture, en entretien des espaces verts, des voiries ou des bâtiments est très fréquente et massive, mais les manipulations de ces produits phytosanitaires et leur épandage ou pulvérisation présentent des risques importants pour la santé des travailleurs exposés et pour l'environnement. Ce dossier aborde la protection et l'équipement du travailleur qui utilise un produit phytosanitaire.
L'utilisation de produits phytosanitaires pour la protection contre les parasites en agriculture, en entretien des espaces verts, des voiries ou des bâtiments est très fréquente et massive, mais les manipulations de ces produits phytosanitaires et leur épandage ou pulvérisation présentent des risques importants pour la santé des travailleurs exposés et pour l'environnement.
Ce dossier aborde la protection et l'équipement du travailleur qui utilise un produit phytosanitaire.
En effet, les produits de traitement phytosanitaire peuvent nuire à la santé de l'applicateur s'il n'est pas bien protégé. Une intoxication aiguë, lors d'une exposition accidentelle, se manifeste par des troubles cutanés, digestifs, respiratoires, musculaires, nerveux, cardiovasculaires. Plus néfastes sont les risques d'intoxication chronique, résultant d'une exposition fréquente et prolongée à des doses faibles. Ils peuvent provoquer des troubles du système nerveux, des effets cancérigènes et mutagènes, et des perturbations endocriniennes.
Les produits phytosanitaires sont des antiparasitaires ou pesticides à usage agricole ou de salubrité et ils se répartissent en plusieurs familles : les fongicides (contre les atteintes des champignons), les herbicides, les insecticides, les raticides (contre les atteintes des rongeurs).
Les principales situations à risques phytosanitaires
Les professions exposées sont très nombreuses :
- les agriculteurs, horticulteurs, arboriculteurs, viticulteurs...
- les ouvriers des parcs, cimetières et jardins du secteur privé ou des collectivités territoriales.
- les agents des services de voirie pour l'entretien du réseau routier.
- les agents des services de salubrité des bâtiments (travaux spécialisés de désinfection, de désinsectisation ou de dératisation des locaux)
Le risque de contamination direct correspond au risque du travailleur qui est exposé directement aux produits phytosanitaires, par exemple lors de la préparation ou de l'application du produit, du nettoyage et de la vidange de la cuve, de tout disfonctionnement du pulvérisateur (buses bouchées, rupture de tuyaux…).
Le risque de contamination indirecte correspond à tout contact avec un élément pollué, tel que le matériel, le végétal ...
Les principaux risques phytosanitaires
Les produits phytosanitaires pénètrent dans le corps humain par trois voies :
- orale (bouche, œsophage, appareil digestif),
La pénétration par cette voie se fait soit par ingestion accidentelle d'un produit ou par déglutition de produit, soit par contact direct, en portant des mains ou des objets souillés à la bouche.
- respiratoire (nez, trachée, poumons)
Ce type de pénétration se fait par inhalation de poussières, fumées, gaz ou vapeurs, particules fines émises à la préparation du traitement et lors de la pulvérisation du brouillard de produit.
Ce risque est ainsi fortement présent lors des différentes phases de traitement. Les poumons ont une grande capacité de contact, de rétention et d'absorption des produits toxiques.
De plus, les voies respiratoires sont constituées de telle sorte qu'elles facilitent une diffusion très rapide de ces substances dans le sang.
C'est pourquoi l'inhalation de produits toxiques produit une action très rapide.
- cutanée (y compris les yeux et les muqueuses).
C'est la voie principale de pénétration des produits. Certains produits peuvent être susceptibles de traverser la peau, puis de passer dans le sang pour se fixer sur certains organes (foie, rate…) ou tissus (nerveux, graisseux) et aboutir, par conséquent, à des intoxications parfois très graves.
D'autres produits peuvent causer des lésions sur la peau à l'endroit du contact (rougeurs, irritations, brûlures…).
De plus, la chaleur et la transpiration accélèrent très souvent ce phénomène de pénétration.
L'effet peut être local, c'est-à-dire au point de contact (brûlures, irritations) ou général si le produit pénètre à travers la peau ou les muqueuses.
Dans la plupart des cas, si la protection des voies respiratoires est importante, bien trop souvent le risque de pénétration par la peau ou les muqueuses est encore sous-estimé.
Conséquences pathologiques
Quelle que soit la voie de pénétration, le toxique se retrouve dans le sang (le passage est facilité dans le cas d'une blessure). Ces substances sont alors, soit transformées par le foie et éliminées (par la sueur, les selles, la bile et les urines), soit stockées dans l'organisme.
Les types d'intoxications qui en résultent sont de deux sortes :
• Intoxications aiguës: qui sont dues à une durée d'exposition courte, une absorption rapide
du toxique et l'apparition rapide de symptômes. Ces intoxications sont généralement
provoquées par l'absorption de produits liés à des maladresses ou des méprises, elles
entraînent des troubles importants:
- Troubles nerveux: vertiges, tremblements, convulsions, manque de coordination,…;
- Troubles digestifs: salivations importantes, nausées, vomissements, diarrhées, …;
- Troubles cardio-vasculaires: tachycardie,…;
- Troubles musculaires: contractions, crampes, paralysies,…
• Intoxications chroniques: qui sont dues à l'absorption progressive et répétée de petites
quantités de produits qui vont s'accumuler dans l'organisme jusqu'à provoquer des atteintes
graves. Au cours de l'exposition, l'opérateur ne ressent que des troubles mineurs (maux de
têtes et nausées) lorsqu'ils sont décelés, mais à terme, des pathologies plus importantes
peuvent apparaître. Certaines font l'objet de tableaux de maladies professionnelles du régime
général, notamment les tableaux n° 34 et 65.
Les troubles de contact sont les plus fréquents :
- le contact cutané va provoquer des allergies et des troubles caustiques : dermites, ulcérations
- le contact respiratoire est responsable de rhinites, d'asthmes professionnels
- le contact digestif par ingestion accidentelle (mains ou aliments souillés) peut entraîner des troubles digestifs
Le passage dans la circulation sanguine, quel que soit le mode de pénétration initial est responsable :
- d'intoxications aiguës ou chroniques (troubles neurologiques, circulatoires, respiratoires, sanguins, digestifs...)
- d'altération d'une ou de plusieurs fonctions vitales : rénales, hépatiques, cutanéo-muqueuses, digestives, respiratoires, neurologiques
- de cancers : cutanées, hépatiques, bronchiques
Protection de l'utilisateur de produits phytosanitaires
- Comme pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents chimiques dangereux, l'employeur doit procéder à une évaluation des risques encourus pour la sécurité et la santé des travailleurs. Cette évaluation doit être renouvelée périodiquement, notamment à l'occasion de toute modification importante ou avant une activité nouvelle.
- L'évaluation des risques inclut toutes les activités de l'entreprise, y compris l'entretien et la maintenance.
- Les résultats de l'évaluation des risques sont consignés dans le Document Unique de Sécurité (D.U.S).
- L'étiquetage du produit et la fiche de données de sécurité sont obligatoires et permettent de repérer les principaux risques. En fonction des risques mentionnés sur l'étiquette, le port de vêtements de protection peut s'avérer obligatoire. Il est essentiel de lire l'ensemble des indications reprises sur l'étiquette.
- En supplément de l'étiquetage, tout employeur doit obtenir de son fournisseur une Fiche de Données de Sécurité (F.D.S) plus complète pour mieux mesurer les risques, former ses salariés et mettre à leur disposition les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I) adéquats.
Les Equipements de Protection Individuelle de l'utilisateur de produits phytosanitaires
L'équipement du travailleur qui doit appliquer un pesticide sert à le protéger d'un contact avec le produit. L'exposition au produit peut se faire lors de la préparation (exemple : remplissage du pulvérisateur) ou durant le traitement. Même si le port de certains équipements peut être gênant, il est indispensable de les utiliser.
L'objectif est d'éviter au maximum toute exposition cutanée, respiratoire ou digestive. Il est primordial que l'utilisateur connaisse les phases les plus à risque et porte une protection (gants, masque, combinaison) à ces moments clefs (préparation, nettoyage, incidents lors de la pulvérisation).
En application ou en réentrée (intervention sur culture après que cette dernière ait été traitée), il est essentiel d'avoir une hygiène rigoureuse : se laver les mains après chaque intervention, prendre une douche immédiatement après le traitement, laver ses vêtement séparément, remplacer tout vêtement souillé par des projections. Les équipements de protection individuelle ne doivent pas sortir de l'entreprise. Il est important de rappeler que les vêtements de protection (bottes, combinaison, masque, gants) doivent être rangés en dehors du local de stockage des produits phytosanitaires afin d'éviter leur saturation par les éventuelles vapeurs toxiques pouvant être dégagées par les produits.
Les vêtements de travail et équipements de protection individuelle fournis et entretenus par l'employeur comportent : les combinaisons de protection, les masques avec filtre à gaz ou lunettes selon les cas, les gants, les bottes de sécurité ou de protection. L'employeur doit s'assurer que ces équipements de protection individuelle sont effectivement portés.
La combinaison : Le port d'une combinaison (jetable ou durable) prévue pour les traitements phytosanitaires est essentiel. Pour une protection optimale, il convient de porter une combinaison imperméable (vêtements de type 3 Etanchéité aux projections de liquides ou de type 4 Etanchéité aux aérosols, aux pulvérisations) et munie d'un capuchon. Les salopettes en textile n'offrent qu'une protection limitée. Lors de l'habillage, la combinaison devra être portée de manière à recouvrir les gants et les bottes.
Pour entretenir une combinaison de traitement durable, il faut impérativement limiter le nombre de lavage en machine. Pour ce faire, le vêtement encore porté doit être rincé à l'eau claire directement après traitement, puis seulement retiré et séché.
Quant à la combinaison jetable, d'usage plus fréquent en agriculture, elle doit être changée à temps, selon les prescriptions du fabricant. Les combinaisons jetables deviennent poreuses après une certaine durée, sans pour autant changer d'aspect. Elles sont perméables à l'air et réutilisables quelques fois si non déchirées.
Le masque et les lunettes : Le port de masque est nécessaire car certains produits plus volatiles sont fortement inhalés, de même lors de la manipulation de poudres. Il évite la pénétration par les voies respiratoires des gouttelettes et poussières de produits phytosanitaires. L'idéal est d'utiliser un masque avec une cartouche avec filtres combinés pour les solvants organiques et inorganiques ainsi que pour les poussières (poudres). Pour les produits phytosanitaires, l'utilisation d'un filtre à particules (P) additionné d'un filtre à charbon actif de catégorie A est suffisante et recommandée (cartouche du type A2P2). La cartouche accumule les substances actives jusqu'à saturation. La cartouche doit être changée dès que le travailleur commence à sentir l'odeur du produit malgré le port du masque. Un demi-masque suffit s'il est muni de filtres pour le gaz et la poussière et accompagné de lunettes : le port de lunettes permet de protéger l'applicateur contre les dégâts oculaires des éclaboussures de produits, certains produits phytosanitaires étant corrosifs ou irritants. Le remplacement du filtre doit être régulier. Les masques doivent être entretenus et nettoyés à l'eau savonneuse et rincés à l'eau claire. Pour les filtres, il est conseillé de les ôter après chaque utilisation et les fermer avec leur opercule. Ne pas les mouiller, ni les souffler (soufflette) : un filtre colmaté est un filtre à jeter, la force de l'air comprimé ne libère pas mais détruit les fines alvéoles du filtre, le rendant inefficace. Les essuyer avec un chiffon propre humide et les stocker dans une poche hermétique vidée d'air.
Les lunettes-masque doivent être conformes aux normes EN 166,168.
Les gants : le port de gants est absolument nécessaire. Imperméables aux produits chimiques, ils protègent les avant-bras. La pénétration cutanée des phytosanitaires est réduite de 90% par le port de gants adaptés résistants au risque chimique (sigle CE et symbole « éprouvette » selon la norme EN 374), en nitrile ou néoprène, en privilégiant l'étanchéité (gants couvrant les avant-bras) et le confort (souples, doublés d'un support textile).
Les gants en cuir, latex ou PVC sont à proscrire.
Il est impératif de ne jamais contaminer l'intérieur des gants. Beaucoup de cas d'exposition dermique sont la conséquence de contaminations internes de ces gants, quand l'utilisateur les enlève et les remet. Il est donc nécessaire de laver l'extérieur des gants à l'eau claire avant de les enlever. L'extérieur du gant sera ensuite séché puis aussi et surtout l'intérieur. Ne jamais réutiliser des gants craquelés ou déchirés.
La cuve lave-mains doit être considérée comme un complément au port des gants. Les mains doivent être lavées directement après la manipulation.
Les bottes de sécurité ou de protection : Le port de bottes ou bottines imperméables, réservées aux traitements phytosanitaires conformes aux normes CE EN345-346-347, marquage S5 ou P5 (Polymères naturels et synthétiques), est nécessaire. Les chaussures de travail en cuir ou les chaussures en toile ne sont pas imperméables et adaptées pour les traitements phytosanitaires.
La combinaison sera portée au-dessus des bottes et pas dans les bottes afin d'éviter la pénétration de liquide dans celles-ci.
Réglementation
- Loi d'orientation agricole n°99-574 du 9 juillet 1999
- Décret n°87-361 du 27 mai 1987
- Arrêté du 12 Septembre 2006
- Articles L.254-1 à L.254-10 du code rural
- Articles R.5162 et R.5170 du code de la santé publique
- Articles L.4121-1 à L.4121-4, R.4412-1 à R.4412-58, R.4412-152, R.4412-153 et R.4624-4,
R.4411-74 à R.4411-82 du code du travail
Arrêté ministériel du 20 octobre 2004 fixant la liste des travaux effectués dans les entreprises agricoles et nécessitant une surveillance médicale.
Aller plus loin
- INRS Prévention et port des équipements de protection individuelle. 4. L'utilisation de produits phytosanitaires Référence : NS 213 Année de publication : 2002
- INRS L'applicateur de produits phytosanitaires ED 867 Année de publication : 2001
Partagez et diffusez ce dossier
Laissez un commentaire
Votre adresse de messagerie ne sera pas publiée.
Les avis des internautes
28/04/2023